Agir ensemble – Rapport annuel de 2025 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable
Sur cette page
- Avant-propos
- Sommaire et introduction
- Méthodologie
- Perspective statistique : Aperçu au niveau macro des progrès réalisés des objectifs de développement durable
- Objectif de développement durable 3 : Bonne santé et bien-être
- Objectif de développement durable 5 : Égalité entre les sexes
- Objectif de développement durable 8 : Travail décent et croissance économique
- Objectif de développement durable 14 : Vie aquatique
- Objectif de développement durable 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
- Prochaines étapes
Formats substituts

Agir ensemble - Rapport annuel de 2025 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable [PDF - 2 943 KB]
Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.
Liste de figures
- Figure 1 : Progrès du Canada à l'égard du Cadre d'indicateurs canadien pour les objectifs de développement durable, progrès réalisés depuis 2015, à jour le 28 février 2025
- Figure 2 : Indicateur national 3.8.1 : Pourcentage des Canadiens qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente, selon le groupe d'âge, Canada
- Figure 3 : Indicateur national 3.13.1 : Taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants, Canada et provinces et territoires sélectionnés
- Figure 4 : Indicateur national 5.4.1 : Temps moyen consacré par jour à des soins et travaux domestiques non rémunérés, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2022
- Figure 5 : Indicateur national 5.5.1 : Ratio du salaire horaire médian entre homme et femme, par groupe d'âge, Canada
- Figure 6 : Indicateur national 8.2.1 : Taux d'emploi, personnes âgées de 15 ans et plus, selon le sexe, Canada
- Figure 7 : Indicateur national 8.3.1 : Proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation, selon le sexe, Canada
- Figure 8 : Indicateur national 14.1.1 : Proportion d'aires marines et côtières conservées, Canada
- Figure 9 : Indicateur national 14.2.1 : Proportion des principaux stocks de poissons qui se trouvent dans la zone de prudence et la zone saine
- Figure 10 : Indicateur national 17.2.1 : Soutien public total au développement durable, par type de décaissement, Canada
- Figure 11 : Indicateur mondial 17.9.1 : Valeur en dollars de l'aide financière et technique versée aux pays en développement, Canada
Avant-propos
Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est bien plus qu'un cadre mondial : c'est un appel à l'action visant à bâtir un Canada plus fort et plus résilient et un monde meilleur pour tous.
Le Canada accomplit des progrès significatifs à l'égard de nombreux objectifs de développement durable (ODD) grâce à des mesures nationales et internationales. Qu'il s'agisse de promouvoir l'égalité entre les sexes, de protéger nos océans ou d'offrir de meilleures possibilités à tous, nous prenons des mesures pour aborder les inégalités systémiques et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.
Parallèlement, les incertitudes mondiales, y compris les tensions géopolitiques et les perturbations commerciales, posent des défis supplémentaires du point de vue de la stabilité économique et du développement durable. Malgré les obstacles que nous devrons surmonter à l'avenir, les ODD représentent notre espoir commun d'un avenir plus pacifique, plus prospère et plus durable, tant pour notre population que pour la planète. Dans cet esprit, c'est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2025 sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable.
Le rapport de cette année fait état des efforts déployés collectivement par les Canadiens dans l'ensemble des secteurs, qui stimulent l'innovation, contribuent à bâtir des collectivités résilientes et font la promotion des ODD au pays et à l'étranger. Les histoires recueillies dans le cadre d'un vaste processus de mobilisation des Autochtones, des jeunes, de la société civile, des municipalités, des universités et des particuliers mettent en lumière les réalisations, les leçons apprises et le travail qu'il reste à accomplir.
Nous travaillons avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour appuyer les enfants et les familles grâce à des services de garde à 10 $ par jour, à la création de nouvelles places en garderie et au Programme national d'alimentation scolaire. Des programmes comme le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse du Canada aident les jeunes à acquérir de l'expérience professionnelle utile, tandis que le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones aide les membres des Premières Nations, les Inuit, les Métis et les Autochtones vivant en milieu urbain à atteindre leurs objectifs de carrière à long terme.
L'an dernier, le Programme de financement des ODD a financé 30 projets axés sur l'action en faveur du climat, le renforcement communautaire, la mobilisation des jeunes et la réconciliation avec les Autochtones. Le Canada a aussi participé à la conférence nationale Together | Ensemble, qui a réuni des centaines de délégués pour faire un suivi des progrès accomplis vers l'atteinte des ODD.
En 2025, le Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale puisqu'il préside le G7 ainsi que le Conseil économique et social des Nations Unies. Le Canada est déterminé à faire progresser les ODD dans l'exercice de ces rôles en mettant l'accent sur une collaboration internationale inclusive et axée sur les droits.
En 2023 à 2024, l'aide internationale canadienne a permis d'appuyer plus de 40 millions de personnes et a donné lieu à des efforts visant à s'attaquer à la violence fondée sur le sexe, à la prévenir et à l'éliminer, y compris lutter contre les pratiques préjudiciables, comme les mariages d'enfants ainsi que la mutilation des organes génitaux féminins. Depuis plus de 2 décennies, le Canada est l'un des principaux défenseurs de la santé à l'échelle mondiale et investit 1,4 milliard de dollars par année dans le cadre de son engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde; la moitié de ce financement appuie la santé et les droits sexuels et reproductifs complets.
Grâce à des programmes phares comme le Programme Voix et leadership des femmes, le Fonds Égalité et l'Alliance pour les mouvements féministes, le Canada a également appuyé plus de 3 000 organismes de défense des droits des femmes dans plus de 30 pays, contribuant ainsi à la refonte de plus de 200 lois et politiques discriminatoires, ce qui a renforcé le rôle joué par notre pays à titre de champion de l'égalité des sexes et des droits de la personne à l'échelle internationale.
L'avancement des ODD est un parcours collectif. Dans le contexte actuel, où d'importants défis se posent à l'échelle mondiale, les Canadiens continuent de s'unir pour améliorer la vie des gens et bâtir un avenir plus équitable, inclusif et durable.
La force réside dans l'unité. Et c'est grâce à des partenariats forts et à un but commun que nous parviendrons à relever les défis actuels.
Nous remercions toutes les personnes dévouées partout au pays qui travaillent sans relâche pour faire progresser les ODD. Continuons de travailler ensemble pour façonner un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prometteur pour toutes les générations.
- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.
- L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)
Sommaire et introduction
Le Programme 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) constituent un plan pour un monde plus inclusif et durable. Ils ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies (ONU) en 2015, et le Canada maintient son engagement à les mener à bien.
Le présent rapport porte sur les mesures prises en 2024 par des personnes et des organismes qui collaborent à l'avancement des ODD au Canada et dans le monde entier. Les statistiques permettant de mesurer et de quantifier les progrès du Canada sont présentées parallèlement à des histoires relatées sous forme d'articlesNote de bas de page 1, qui ont été soumises par voie de questionnaire ouvert au public et à la suite de la mobilisation des jeunes, des organismes autochtones, des organisations de la société civile, des municipalités, du milieu universitaire, d'autres ordres de gouvernement et des particuliers.
Le rapport commence par un aperçu statistique des progrès réalisés à l'égard des 17 ODD, puis il est ensuite axé sur les 5 ODD ci-dessous, qui font l'objet d'une évaluation dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies (disponible en anglais seulement) de 2025 :
- ODD 3 - Bonne santé et bien-être
- ODD 5 - Égalité entre les sexes
- ODD 8 - Travail décent et croissance économique
- ODD 14 - Vie aquatique
- ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs
Le gouvernement fédéral a pris d'importantes mesures à l'égard de ces ODD en 2024. Voici quelques exemples :
- il demeure l'un des plus importants donateurs internationaux au titre des dépenses en santé mondiale, octroyant des fonds annuels totalisant 1,4 milliard de dollars pour la santé mondiale;
- il a collaboré avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis pour améliorer l'accès à des services de santé mentale et de bien-être de grande qualité. Le budget de 2024 prévoyait 630,2 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2024 à 2025, pour renouveler le financement d'une série de programmes de soutien en matière de santé et de culture qui tiennent compte des traumatismes, des lignes d'écoute téléphonique et des services de bien-être mental fondés sur les distinctions;
- il a mis en œuvre une stratégie renouvelée pour lutter contre la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales
- il a financé des projets communautaires visant à améliorer la santé mentale de jeunes Canadiens et de leurs proches aidants. Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale investit 4,9 millions de dollars par année et, depuis 2019, ses projets sont venus en aide à 324 901 enfants, jeunes, familles et praticiens dans plus de 209 collectivités au Canada;
- il a continué de promouvoir l'égalité entre les sexes pour faire en sorte que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+Note de bas de page 2 puissent s'épanouir dans tous les aspects de la vie au Canada et dans le monde entier. Par exemple, en 2024, un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fonds de projets 2ELGBTQI+ a été lancé, mettant jusqu'à 25 millions de dollars à la disposition des organismes 2ELGBTQI+ partout au pays.
- il a aidé les jeunes et les Autochtones à améliorer leurs compétences et à acquérir de l'expérience sur le marché du travail. Par exemple, de 2023 à 2024, la Stratégie emploi et compétences jeunesse a offert des services à plus de 105 000 jeunes, y compris de nombreux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi ou sous-représentés sur le marché du travail;
- il a été témoin de la lente réduction de l'écart de rémunération entre les sexes. Les femmes ont touché 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes en 2024, une hausse de 0,02 $ par rapport à 2023Note de bas de page 3;
- il a continué d'établir de nouvelles zones de protection marine et de se rapprocher de l'objectif national de conservation de 30 % des zones marines et côtières du Canada d'ici 2030. La proportion de zones marines et côtières de conservation représentait 14,7 % du territoire marin du Canada ou 842 849 km2 en 2023, une augmentation d'environ 22 km2 par rapport à 2022Note de bas de page 4.
Même si le Canada a pris des mesures pour faire progresser le Programme 2030, il reste encore du travail à faire. À l'échelle mondiale et ici, au Canada, nous avons été confrontés en 2024 à de nombreux défis communs liés aux changements climatiques, à l'augmentation du coût de la vie, à l'insécurité alimentaire, à l'accès à des logements abordables, à l'inégalité, à la santé mentale et aux méfaits associés à la consommation de substances. Par exemple, un peu moins de la moitié (49,9 %) des femmes estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente, comparativement à 57,7 % chez les hommesNote de bas de page 5. Parallèlement, le taux d'emploi au Canada a diminué, passant de 62,2 % en 2023 à 61,3 % en 2024Note de bas de page 6.
Malgré les reculs observés pour certains ODD, les histoires relatées par des personnes issues des différents secteurs de la société confirment que les Canadiens continuent d'entretenir de l'espoir et témoignent de leur engagement à l'égard de la collaboration. Compte tenu des défis importants auxquels elles sont confrontées, des personnes de partout au pays continuent d'unir leurs efforts pour améliorer la vie des résidents de leur collectivité.
L'objectif transversal ultime, et la promesse transformatrice centrale du Programme 2030, est de ne laisser personne de côté. Au Canada, il est essentiel de mener un travail constructif en vue de la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour concrétiser cette promesse, et il en est question dans les articles figurant dans le présent rapport. Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, des progrès ont été accomplis en 2024 pour concrétiser les ODD à l'étude, notamment les partenariats avec les communautés autochtones pour établir de nouvelles zones de protection marine, les cadres de mieux-être mental dirigés par les Autochtones et la collaboration à l'égard de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones.
Le gouvernement du Canada ne peut à lui seul remplir la promesse formulée dans le Programme 2030. Comme le montrent les articles, les Canadiens ont conjugué leurs efforts en 2024 de manière inspirante. Vous trouverez plus loin des articles à propos d'un jeune innovateur qui s'efforce de réduire les plastiques dans les océans, de produits menstruels gratuits distribués à plus de 3,5 millions de personnes éprouvant de la difficulté à y accéder, et d'une initiative de durabilité qui crée des emplois intéressants pour des personnes aux capacités diverses. À l'échelle internationale, le Canada a appuyé les efforts mondiaux en matière de santé et de soins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il s'est principalement consacré à l'autonomisation économique des femmes, à leur croissance inclusive et à leur résilience économique en répondant aux besoins des communautés lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et autres ainsi que des mouvements féministes du monde entier. Lorsque vous lirez les articles, n'oubliez pas que même s'ils figurent sous un ODD à l'étude, la plupart pourraient se rapporter à plusieurs autres ODD en raison de leur nature interreliée.
Voici des améliorations à apporter en ce qui concerne les 5 ODD examinés dans le rapport :
- fournir aux Canadiens le soutien en santé et en mieux-être dont ils ont besoin;
- mettre fin à la violence fondée sur le sexe;
- promouvoir une répartition égale des responsabilités non rémunérées en matière de soins pour que les femmes puissent participer pleinement au marché du travail;
- garantir la durabilité, l'inclusivité et la protection des travailleurs dans l'industrie agroalimentaire canadienne;
- tenir compte de la proportion réduite des principaux stocks de poissons dans les zones saines et de prudence;
- soutenir concrètement les personnes et les familles touchées par la crise des surdoses.
Alors que nous relevons collectivement les défis de notre époque, il demeure évident que le Canada se concentre sur la mise en œuvre le Programme 2030 de façon inclusive dans la société entière, au pays et à l'étranger.
Méthodologie
Le présent rapport énonce les activités menées en 2024 pour faire progresser les 5 objectifs de développement durable (ODD) étudiés par l'ONU. Les 3 objectifs transversaux suivants, qui figurent dans le Plan de mise en œuvre fédéral du Canada, sont intégrés à l'ensemble du rapport :
- ne laisser personne de côté : cela veut dire faire progresser l'égalité des genres, autonomiser les femmes et les filles et faire avancer la diversité et l'inclusion.
- faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones : pour cela, il faut travailler en partenariat pour appuyer les voix autochtones, les connaissances traditionnelles et l'autodétermination.
- assurer la cohérence des efforts internationaux du Canada : cela veut dire qu'il faut harmoniser les efforts internationaux et nationaux pour contribuer à l'atteinte des ODD.
Mesurer les progrès au moyen de statistiques
Les analyses statistiques figurant dans le présent rapport utilisent 2 indicateurs retenus par ODD, qui proviennent du Cadre mondial d'indicateurs et du Cadre d'indicateurs canadien. Le Cadre mondial d'indicateurs, qui a été adopté en 2017 par l'Assemblée générale des Nations Unies, prévoit un premier ensemble d'indicateurs pour mesurer les progrès liés aux ODD. Le Cadre d'indicateurs canadien comprend les ambitions, les cibles et les indicateurs propres au Canada.
Le présent rapport s'attarde aux progrès réalisés en 2024. Des données ne sont pas recueillies pour tous les indicateurs chaque année. Dans les cas où il n'y avait pas de données disponibles pour 2024, les données de l'année la plus récente disponible ont été incluses.
Consultation
Le rapport comprend les commentaires recueillis au cours de la consultation des intervenants et des partenaires de l'ensemble de la société et de la collaboration avec eux.
Un questionnaire en ligne, accessible du 8 décembre 2024 au 28 février 2025, a permis à tous les ordres de gouvernement, aux organisations autochtones nationales, aux organisations de la société civile, au milieu universitaire, aux entreprises et aux particuliers de communiquer leurs activités et leurs travaux visant à faire progresser les ODD. On a mis de l'avant la possibilité de formuler des commentaires dans le cadre de séances d'information et d'événements publics ainsi que dans les médias sociaux. Plus de 150 personnes et organismes et tous les ordres de gouvernement ont fourni des renseignements sur la façon dont leur travail a contribué à faire progresser les ODD et sur les obstacles qu'ils ont dû surmonter en cours de route. Parmi les autres activités de mobilisation, mentionnons la sensibilisation ciblée auprès des organisations autochtones nationales, des provinces, des territoires, des jeunes et des organisations de la société civile.
Perspective statistique : Aperçu au niveau macro des progrès réalisés des objectifs de développement durable
Des renseignements fiables sont essentiels pour mesurer, suivre et comprendre les progrès du Canada vers l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Plus précisément, il est essentiel de suivre les progrès du Canada à l'égard des ODD pour comprendre les domaines où les progrès sont en voie de répondre aux ambitions ou d'atteindre les cibles, et ce suivi sert à souligner les domaines où les progrès peuvent être plus lents ou au point mort. Vous pouvez consulter l'évaluation complète des progrès du Canada dans le carrefour de données pour le Cadre d'indicateurs canadien pour les ODD.
Il est essentiel d'assurer la pertinence continue du cadre en ce qui concerne ses ambitions, ses cibles et ses indicateurs afin de refléter l'évolution des priorités et de la société. Parallèlement, la continuité du cadre est importante pour permettre l'évaluation des tendances. Afin d'équilibrer le besoin de stabilité et la mise à jour du Cadre d'indicateurs canadien, celui-ci fait l'objet d'examens stratégiques tous les 3 ans, le dernier ayant pris fin en 2024.
À la suite de cet examen, 2 nouvelles ambitions et 15 indicateurs ont été modifiés ou ajoutés au cadre afin de mieux mesurer les progrès par rapport aux priorités émergentes. De plus, 10 cibles du cadre ont été mises à jour pour en maintenir la pertinence et 5 indicateurs ont été supprimés pour tenir compte des limites des données et tirer parti des données plus récentes ou plus détaillées.
Par exemple, des indicateurs mesurant le niveau d'endettement des Canadiens, l'accès aux soins de santé, le recours aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et la proportion de déchets de plastique rejetés en permanence dans l'environnement ont été ajoutés pour évaluer plus précisément les progrès.
Parmi les 86 indicateurs du Cadre d'indicateurs canadien, le Canada a atteint ses cibles pour 5 % des indicateurs liés à 4 objectifs (ODD 3, 9, 11 et 15) et est en voie d'atteindre les cibles pour 21 % d'indicateurs de plus d'ici 2030. Toutefois, les progrès ont ralenti ou se sont détériorés pour certains indicateurs associés aux 17 ODD. Par exemple, 14 % des indicateurs ont démontré que des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire pour atteindre la cible, tandis que 13 % des indicateurs montrent des progrès limités. Enfin, une tendance au ralentissement de l'atteinte de la cible a été observée pour 38 % des indicateurs, et on ne sait pas si des progrès ont été accomplis pour 9 % des indicateurs en raison des limites actuelles des données.
La figure 1 illustre les progrès accomplis par le Canada vers l'atteinte des objectifs de 2015 au 28 février 2025, selon le Cadre d'indicateurs canadien. Les progrès sont illustrés au moyen d'une série de barres, chacune représentant l'un des 17 objectifs. Chaque barre est ensuite divisée en couleurs, chacune représentant un différent état de progression, indiqué ci-dessous :
- gris rayé : Non disponible
- rouge : Détérioration
- orange : Progrès limités
- jaune : Des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire
- vert solide : Sur la bonne voie
- vert à pois : Cible atteinte
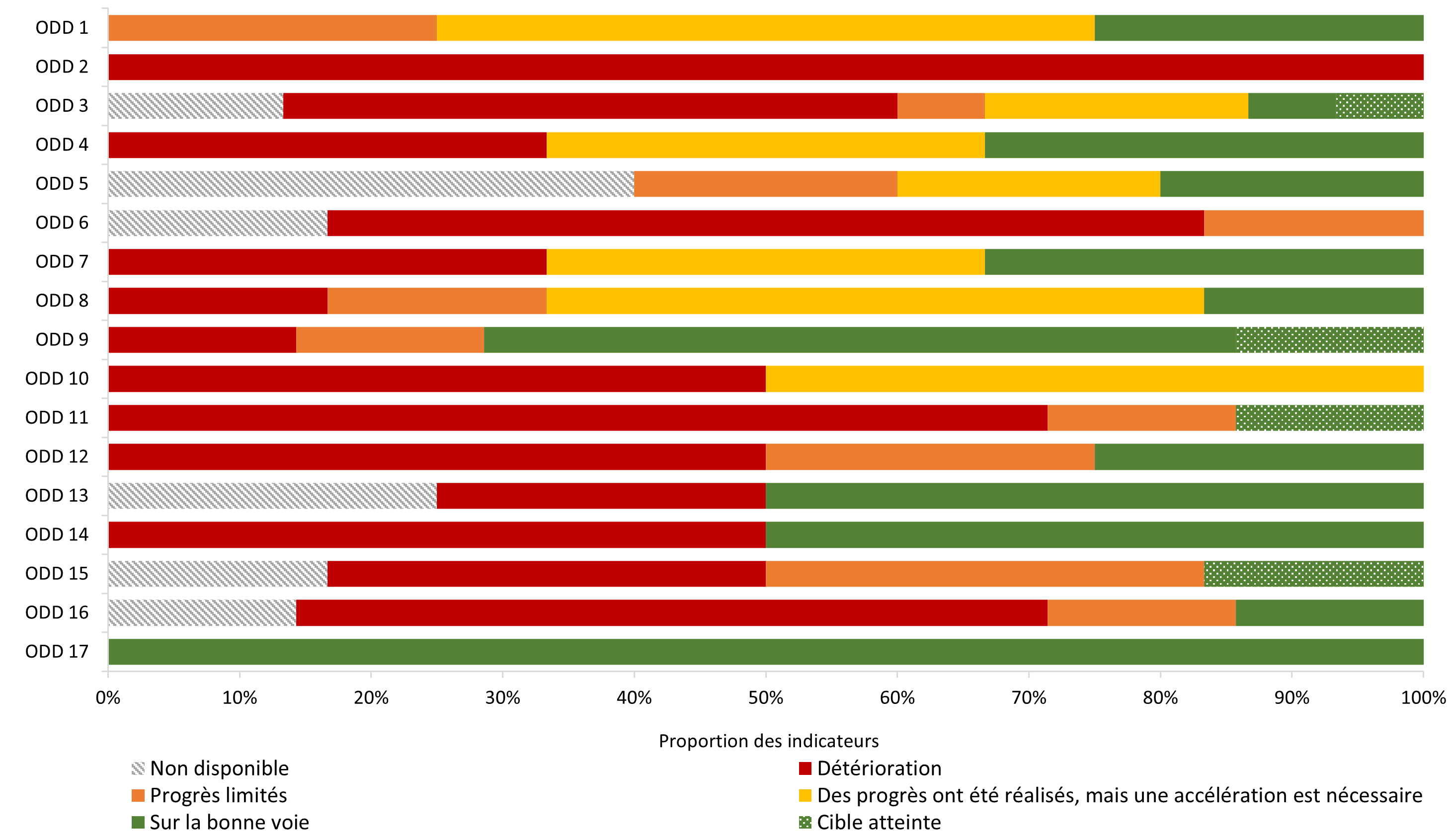
Source : Statistique Canada, Cadre d'indicateurs canadien pour les objectifs de développement durable
Description textuelle de la figure 1
| Objectif | Non disponible | Détérioration | Progrès limités | Des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire | Sur la bonne voie | Cible atteinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD 1 | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% |
| ODD 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ODD 3 | 13% | 47% | 7% | 20% | 7% | 7% |
| ODD 4 | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% |
| ODD 5 | 40% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| ODD 6 | 17% | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| ODD 7 | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% |
| ODD 8 | 0% | 17% | 17% | 50% | 17% | 0% |
| ODD 9 | 0% | 14% | 14% | 0% | 57% | 14% |
| ODD 10 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| ODD 11 | 0% | 71% | 14% | 0% | 0% | 14% |
| ODD 12 | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% |
| ODD 13 | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| ODD 14 | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| ODD 15 | 17% | 33% | 33% | 0% | 0% | 17% |
| ODD 16 | 14% | 57% | 14% | 0% | 14% | 0% |
| ODD 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Légende
- ODD 1 : Pas de pauvreté
- ODD 2 : Faim « zéro »
- ODD 3 : Bonne santé et bien-être
- ODD 4 : Éducation de qualité
- ODD 5 : Égalité entre les sexes
- ODD 6 : Eau propre et assainissement
- ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable
- ODD 8 : Travail décent et croissance économique
- ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- ODD 10 : Inégalités réduites
- ODD 11 : Villes et communautés durables
- ODD 12 : Consommation et production responsables
- ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
- ODD 14 : Vie aquatique
- ODD 15 : Vie terrestre
- ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
- ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Objectif de développement durable 3 : Bonne santé et bien-être
Contexte stratégique
La prévention des décès prématurés, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la promotion de comportements sains et de vies saines et satisfaisantes sont des ambitions clés énoncées sous l'objectif de développement durable (ODD) 3.
Soins de santé au Canada
Le gouvernement fédéral applique la Loi canadienne sur la santé pour garantir des systèmes de santé et de soins de santé publics universels et équitables financés par l'État, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les partenaires autochtones. Le Canada est fier de son système de santé universel et prend des mesures pour veiller à ce que tous les Canadiens aient un accès équitable aux soins. La réduction des inégalités en santé et des obstacles systémiques, tant au pays qu'à l'étranger, est une priorité fédérale.
Résorber les inégalités en matière de bien-être mental
Les efforts du gouvernement du Canada pour réduire les inégalités et les obstacles en matière de bien-être mental auxquels sont confrontés les Autochtones sont fortement orientés par des cadres dirigés par les Autochtones, comme le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Honorer nos forces et la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit (disponible en anglais seulement). Le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis pour faciliter l'accès à des services de santé mentale et de mieux-être de grande qualité, améliorer le bien-être dans les collectivités autochtones et aider les Autochtones à assumer le contrôle de la prestation des services de leur choix.
Le troisième Sommet national sur le mieux-être mental des Autochtones a eu lieu en octobre 2024 à Calgary, en Alberta. Il a réuni des représentants des collectivités des Premières Nations, des Inuit et des Métis, des organisations et des chefs de file en matière de mieux-être mental, ainsi que des fournisseurs de services directs et des chercheurs travaillant avec les populations autochtones pour échanger des connaissances et établir des liens en ce qui concerne les mesures qui permettent d'améliorer le mieux-être mental des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
Par l'entremise du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale, le gouvernement du Canada finance des projets communautaires de promotion de la santé mentale destinés à des populations diversifiées dans le but d'établir les facteurs de protection, de définir les conditions sous-jacentes nécessaires à une bonne santé mentale et de promouvoir l'équité en matière de santé au moyen d'innovations axées sur le changement systémique.
Combattre les méfaits associés à la consommation de substances
Les méfaits de la consommation de substances et la crise des surdoses continuent d'avoir des répercussions dévastatrices partout au Canada, touchant les personnes, les familles et les collectivités. La réduction des méfaits associés à la consommation de substances et la lutte contre la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales sont des priorités du gouvernement canadien.
La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est axée sur l'ensemble des substances ainsi que la santé et la sécurité publiques et couvre à la fois les substances légales et illégales comme le tabac, le cannabis, l'alcool, les stimulants et les opioïdes. Elle repose sur 4 éléments interreliés : la prévention et la sensibilisation, les services et les soutiens liés à la consommation de substances, les données probantes et le contrôle des substances. La Stratégie applique les principes d'équité, de compassion, de collaboration et d'intégralité pour orienter les mesures fédérales visant à enrayer la crise des surdoses.
Soutenir la santé à l'échelle mondiale
D'importants défis persistent malgré les progrès substantiels réalisés au cours des 3 dernières décennies dans le renforcement des résultats mondiaux en santé. Les conflits et les crises en cours, la hausse de l'inflation et des prix des aliments et les changements climatiques ont eu des répercussions considérables sur le bien-être physique, social et économique des personnes les plus démunies et les plus vulnérables, en particulier les femmes, les adolescents et les enfants. Les systèmes de santé, qui ressentent encore les effets de la pandémie de COVID-19, sont confrontés au défi d'être mieux préparés et de répondre aux menaces posées par les maladies infectieuses existantes et émergentes et à leurs conséquences.
Les efforts à l'appui de l'aide internationale en matière de santé déployés par l'ensemble du gouvernement du Canada sont orientés par une approche, inclusive et axée sur les droits de la personne. Les priorités énoncées dans les politiques de santé mondiale comprennent un accès amélioré aux services de santé de qualité pour les personnes les plus marginalisés (ODD 3.8), l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs (ODD 3.7) et un meilleur accès à des services de nutrition adaptés au genre (ODD 3.8 et 2.1).
Depuis 20 ans, le Canada est un chef de file de l'avancement de la santé et de la nutrition à l'échelle mondiale, se classant au sixième rang des donateursNote de bas de page 7 pour ce qui est de ses dépenses totales en santé mondiale. En ce moment, le Canada fait preuve de leadership en matière de santé mondiale en s'appuyant sur son engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde, et le financement annuel de la santé mondiale a été relevé à 1,4 milliard de dollars, dont 700 millions consacrés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs complets.
Les programmes du Canada sont mis en œuvre en étroite collaboration avec les gouvernements, les initiatives de santé mondiale, les organisations de la société civile canadiennes et internationales, les banques multilatérales de développement, les organismes des Nations Unies ainsi que les organismes du secteur privé et les établissements d'enseignement. Les principaux partenaires comprennent entre autres le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; Gavi, l'Alliance du Vaccin; le Fonds des Nations Unies pour la population; UNICEF; Grands Défis Canada; Nutrition International; Plan International Canada; et Oxfam Canada.
Analyse statistique
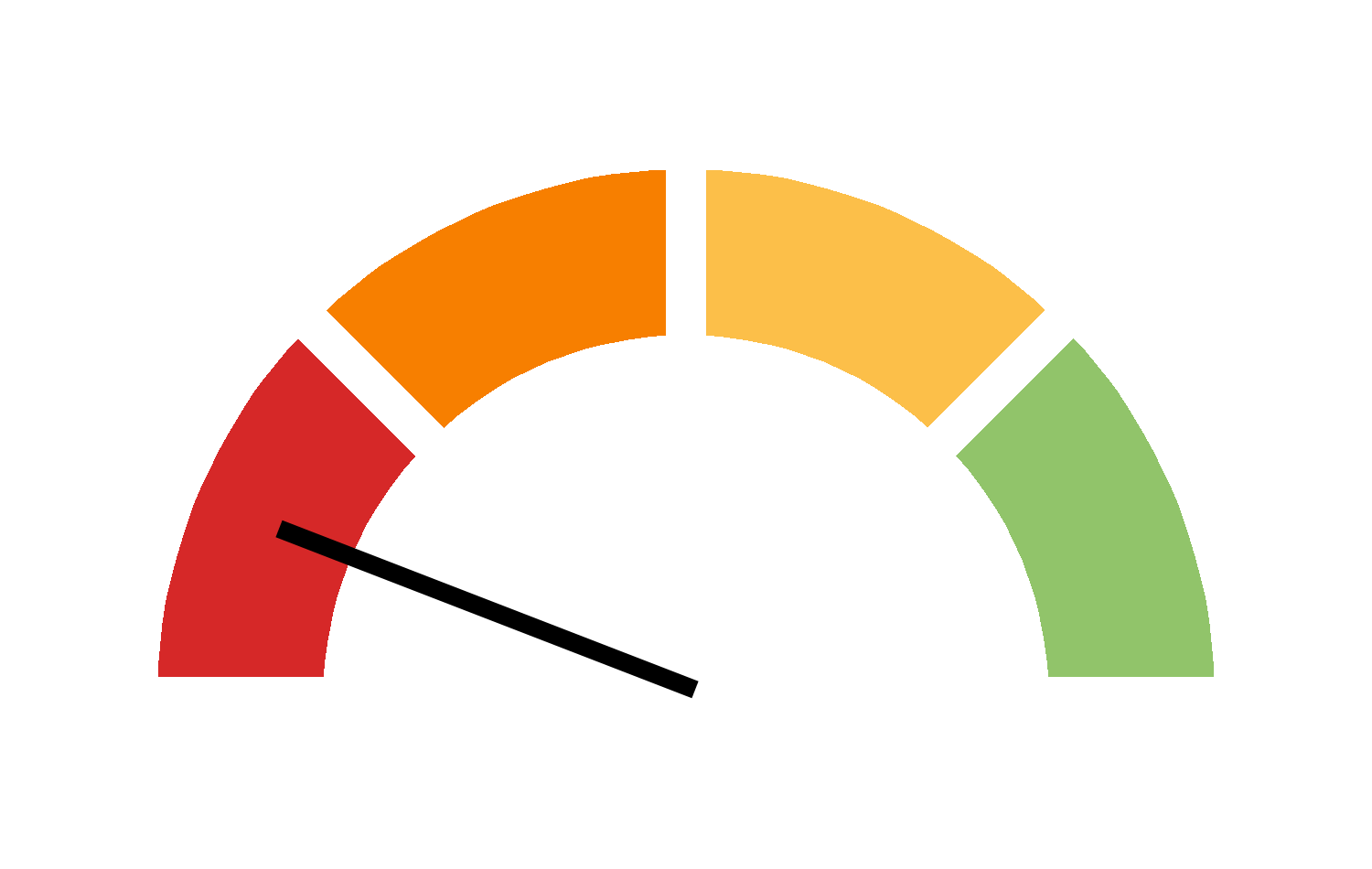
Indicateur national 3.8.1 : Pourcentage des Canadiens qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente
Dans l'ensemble, 53,8 % des Canadiens estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023, une baisse comparativement à 54,8 % en 2022. Par conséquent, une plus faible proportion de Canadiens estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023 par rapport aux années précédentes, ce qui montre une détérioration des progrès vers la réalisation de l'ambition selon laquelle les Canadiens ont des vies saines et satisfaisantes (figure 2).
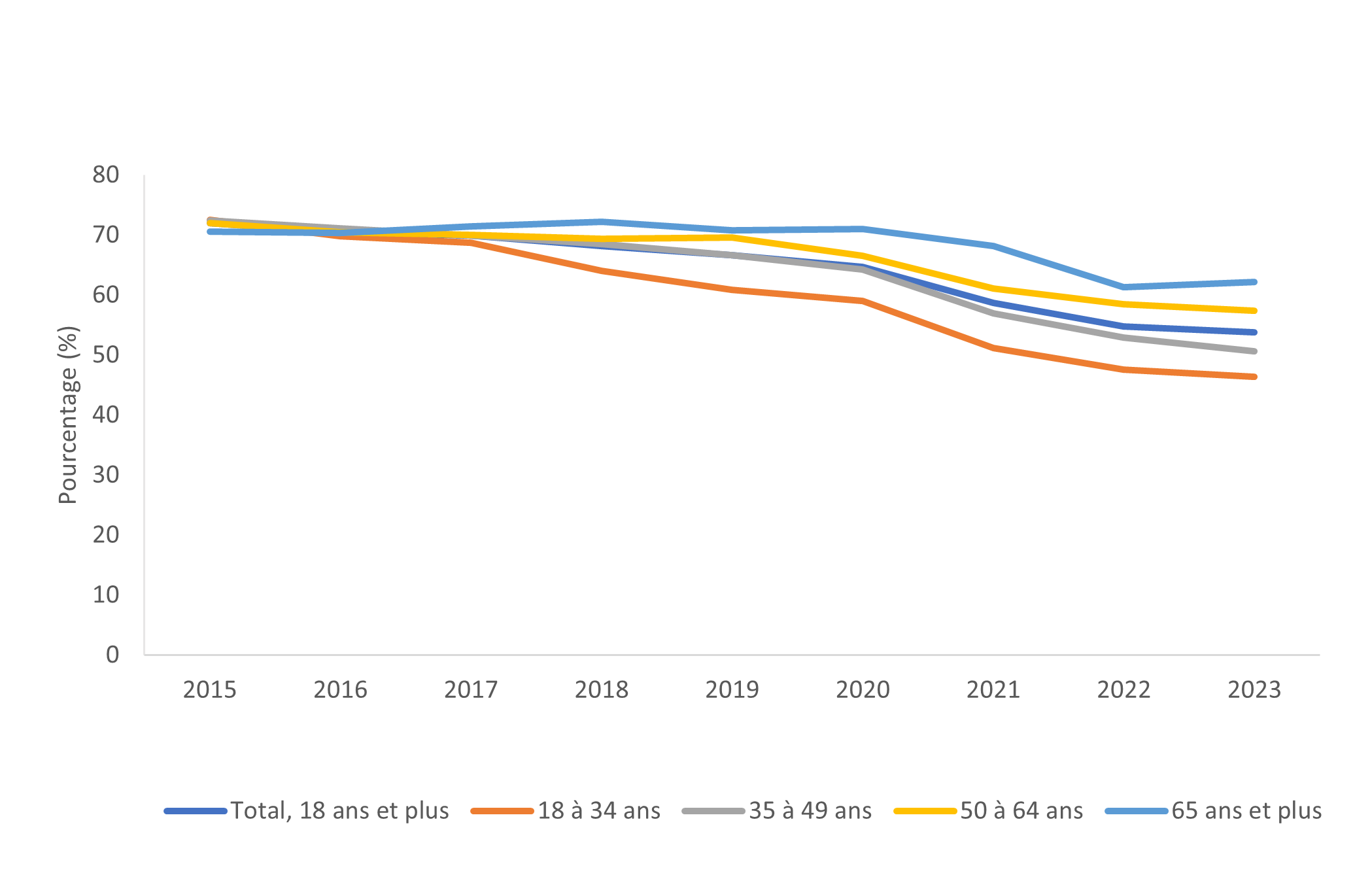
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
Description textuelle de la figure 2
| Détail | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, 18 ans et plus | 72 | 70.4 | 69.9 | 68.2 | 66.6 | 64.7 | 58.7 | 54.8 | 53.8 |
| 18 à 34 ans | 72.5 | 69.8 | 68.7 | 64 | 60.8 | 59 | 51.1 | 47.6 | 46.4 |
| 35 à 49 ans | 72.4 | 71.1 | 69.9 | 68.5 | 66.6 | 64.2 | 56.9 | 52.9 | 50.6 |
| 50 à 64 ans | 72 | 70.4 | 70 | 69.4 | 69.6 | 66.5 | 61.1 | 58.5 | 57.4 |
| 65 ans et plus | 70.5 | 70.3 | 71.4 | 72.2 | 70.8 | 71 | 68.2 | 61.3 | 62.2 |
Alors que le Canada subissait les répercussions de la pandémie de COVID-19, la proportion de Canadiens percevant leur santé mentale comme très bonne ou excellente a chuté de près de 12 points de pourcentage de 2019 à 2022. Néanmoins, la plus récente réduction observée de 2022 à 2023 constitue une réduction substantielle par rapport à 2015, lorsque 72 % des Canadiens considéraient leur santé mentale comme très bonne ou excellente.
Les femmes étaient moins susceptibles de déclarer que leur santé mentale était très bonne ou excellente. En 2023, un peu moins de la moitié (49,9 %) des femmes estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente, comparativement à 57,7 % chez les hommes. Cela accentue l'écart en matière de santé mentale entre les sexes observé depuis 2015, mais qui s'est creusé en 2020 lorsque les femmes ont connu des difficultés économiques et sociales uniques pendant la pandémieNote de bas de page 8.
De plus, la perception de la santé mentale varie considérablement entre les groupes d'âge au Canada. En 2023, les jeunes Canadiens ont continué de déclarer des niveaux de santé mentale inférieurs à ceux des groupes plus âgés, une tendance constatée depuis 2018. Chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans, 46,4 % estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023, en baisse par rapport à 47,6 % en 2022.
La santé mentale des jeunes Canadiens diffère considérablement selon le sexe. Chez les jeunes femmes de 18 à 34 ans, 40,2 % ont déclaré avoir une très bonne ou une excellente santé mentale en 2023, en baisse par rapport au taux de 42,4 % observé en 2022. Il s'agissait de la plus faible proportion de Canadiens ayant déclaré une très bonne ou une excellente santé mentale parmi tous les groupes d'âge en 2023, et elle est inférieure de 12 points de pourcentage à la proportion d'hommes âgés de 18 à 34 ans (52,2 %) ayant déclaré la même chose. Par ailleurs, la proportion de Canadiens âgés de 65 ans et plus qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente a augmenté, passant de 61,3 % en 2022 à 62,2 % en 2023.
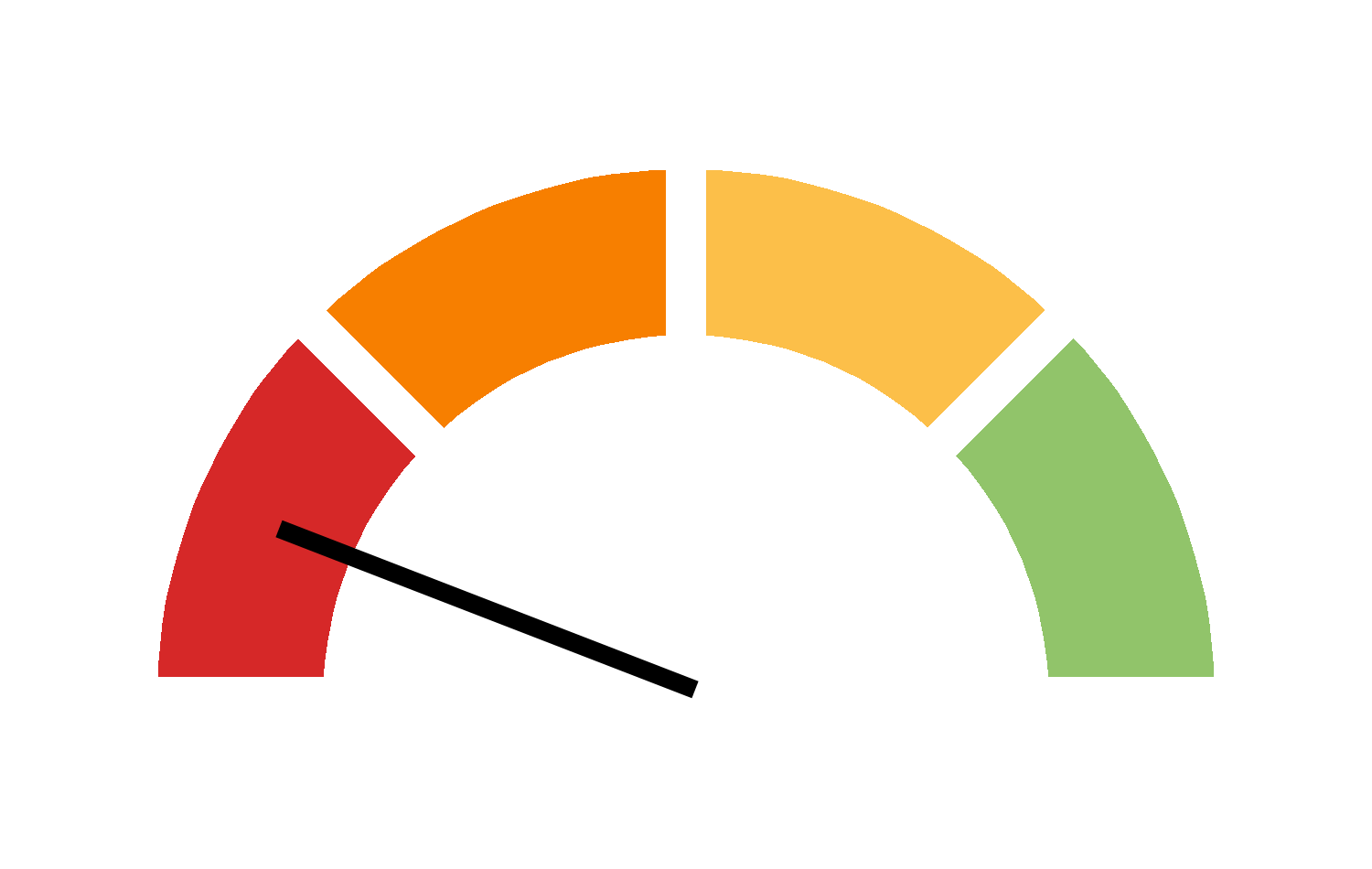
Indicateur national 3.13.1 : Taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants
La crise des opioïdes représente l'une des plus graves menaces pour la santé publique de l'histoire récente, et elle s'ajoute à d'autres difficultés, comme l'instabilité en matière de logement, les problèmes de santé mentale et le coût de la vie. De plus, la plupart des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des opioïdes impliquent également un stimulant ou une autre substance psychoactive. Depuis 2016, l'approvisionnement en drogues illégales est de plus en plus contaminé par le fentanyl et d'autres opioïdes très puissants, ce qui augmente le risque de surdose accidentelle et de décès lié à une surdoseNote de bas de page 9.
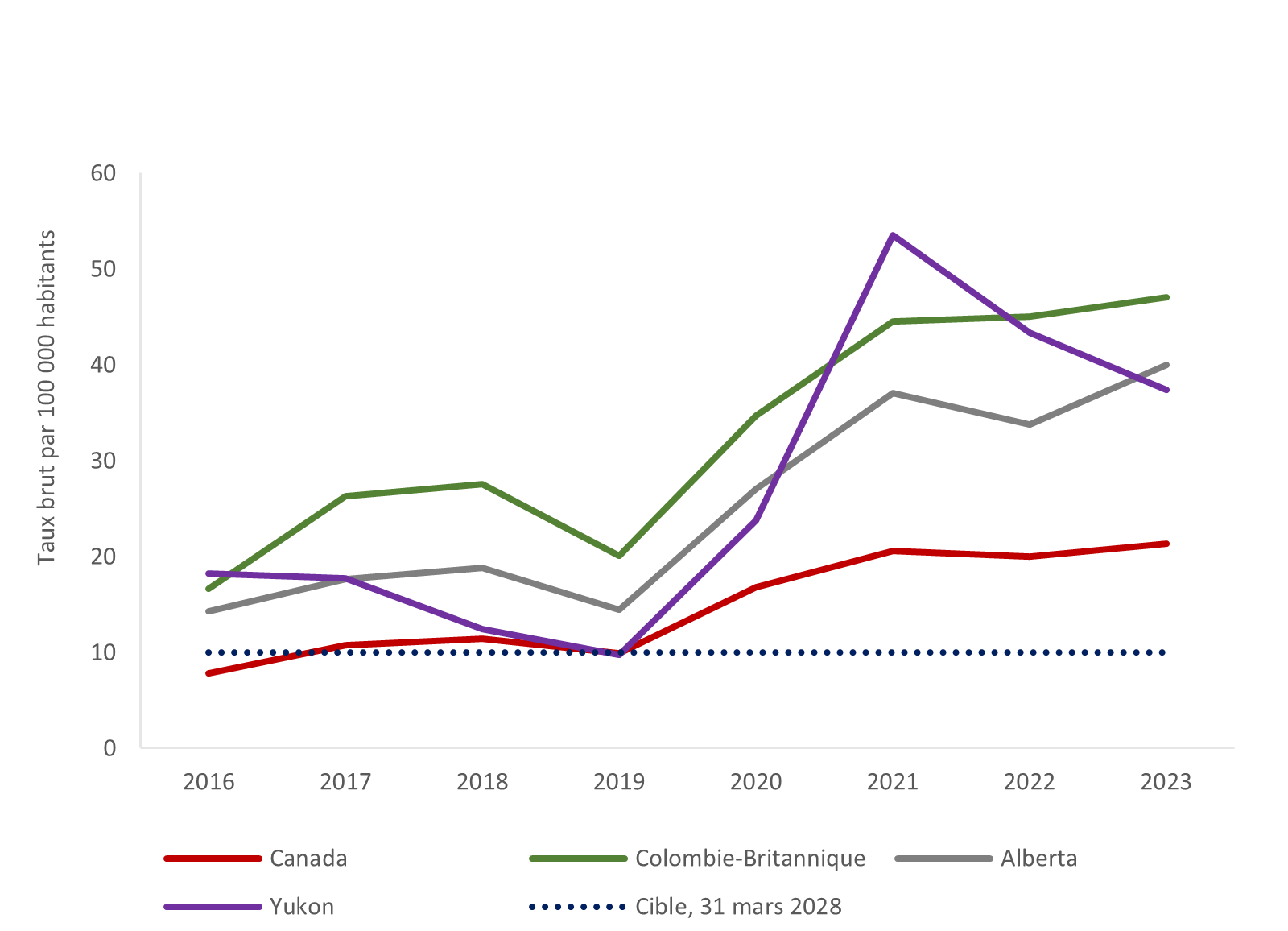
Source : Agence de la santé publique du Canada
Description textuelle de la figure 3
| Année | Canada | Colombie-Britannique | Alberta | Yukon | Cible, 31 mars 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7.8 | 16.6 | 14.3 | 18.2 | 10 |
| 2017 | 10.7 | 26.3 | 17.6 | 17.7 | 10 |
| 2018 | 11.4 | 27.5 | 18.8 | 12.4 | 10 |
| 2019 | 9.9 | 20.1 | 14.4 | 9.7 | 10 |
| 2020 | 16.8 | 34.7 | 27 | 23.8 | 10 |
| 2021 | 20.6 | 44.5 | 37 | 53.5 | 10 |
| 2022 | 20 | 45 | 33.8 | 43.3 | 10 |
| 2023 | 21.3 | 47 | 40 | 37.4 | 10 |
Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants mesure les décès dus à une intoxication aiguë aux opioïdes lorsqu'une ou plusieurs des substances en cause étaient un opioïdeNote de bas de page 9.
Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes a commencé à augmenter en 2016; cette augmentation était plus marquée au début de la pandémie en 2020. Depuis, elle est demeurée élevée avec 21,3 décès par 100 000 habitants en 2023, en hausse par rapport au taux de 20,0 en 2022 (figure 3). On observe donc une tendance à la détérioration des progrès vers la cible de 10,0 décès par 100 000 personnes d'ici le 31 mars 2028, et ce taux est plus de 2,5 fois plus élevé qu'en 2016, année où le suivi national a commencé.
Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes était plus élevé dans l'Ouest canadien puisque la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Yukon, la Saskatchewan et le Manitoba ont tous enregistré des taux supérieurs à la moyenne nationale en 2023. Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes en Colombie-Britannique a augmenté pour la quatrième année consécutive, se situant à 47,0 décès par 100 000 habitants en 2023, ce qui représente le taux le plus élevé à l'échelle nationale et une hausse par rapport au taux de 45,0 l'année précédente. En 2023, l'Alberta affichait le deuxième taux en importance de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes, soit 40,0 par 100 000 habitants, après avoir enregistré la plus forte augmentation à l'échelle nationale par rapport à 33,8 en 2022. Entre‑temps, le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes au Yukon a diminué pour la deuxième année consécutive, passant d'un sommet de 53,5 décès par 100 000 habitants en 2021 à 37,4 en 2023.
Les hommes continuent d'enregistrer le plus grand nombre de décès imputables à la toxicité des opioïdes, représentant 72,0 % de tous ces décès en 2023Note de bas de page 9. Les hommes qui exercent un métier dans les secteurs de la construction ou de l'exploitation minière ou forestière ont affiché des taux plus élevés que ceux qui travaillent dans d'autres secteurs, probablement en raison de la nature exigeante et stressante de leur travailNote de bas de page 10. Puisque les blessures et la douleur sont courantes dans ce secteur d'activité, cela peut mener à la consommation d'alcool ou d'autres substances pour soulager la douleur, ce qui est l'une des façons dont les personnes découvrent les opioïdes.
Les adultes de 30 à 39 ans ont affiché le nombre le plus élevé de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes parmi tous les groupes d'âge, représentant 29 % de tous ces décès en 2023. Venaient ensuite les adultes de 40 à 49 ans (24 %) et ceux de 50 à 59 ans (19 %). Ensemble, les Canadiens âgés de 30 à 59 ans représentaient 72 % de tous les décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes en 2023.
Articles de fond
La crise des surdoses : Bien en vue
La crise des surdoses a des répercussions dévastatrices sur les personnes, les amis, les familles et les collectivités partout au pays. La série audio sur les opioïdes Bien en vue de Santé Canada raconte les histoires au-delà des chiffres.
Cette crise a un visage. C'est le visage d'un ami, d'une collègue, d'un membre de la famille. Le fait de rencontrer le regard d'une personne et d'y voir notre propre reflet est la première étape pour mettre fin à la stigmatisation qui empêche souvent les consommateurs de drogues de recevoir de l'aide.
La série Bien en vue explore les histoires personnelles des personnes touchées par la crise des surdoses. Le but est de démontrer, à l'aide d'histoires personnelles, que cette crise se produit à la vue de tous et qu'elle peut avoir des répercussions sur n'importe qui.
L'une des histoires est celle d'Elsa, travailleuse sociale dans un organisme de réduction des méfaits. Elle offre soutien et compassion aux personnes atteintes de troubles de toxicomanie. Dans le cadre de ses fonctions, elle fournit divers services de réduction des méfaits, y compris l'aiguillage vers des services de traitement, et du matériel propre et stérile, comme des trousses d'injection et de naloxone. Elsa décrit comme suit son rôle auprès des consommateurs de drogues : « On se rend directement dans leur milieu, toujours dans le but d'améliorer leurs conditions de vie puis de répondre à leurs besoins au niveau de la distribution puis du matériel qu'ils ont besoin. La personne est vraiment au cœur de nos interventions et de notre mission, l'intérêt de la personne soutenue demeure la priorité. »
Les services de réduction des méfaits, comme les centres de consommation supervisée et l'administration de naloxone, font partie de la stratégie globale de santé publique du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Les centres de consommation supervisée offrent un endroit sûr et propre aux personnes, où elles peuvent apporter leurs propres drogues à injecter, en présence de personnel qualifié, et où elles peuvent jeter adéquatement le matériel usagé. Ils peuvent offrir une gamme de services de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, y compris la vérification des drogues, en plus d'autres services médicaux comme le soin des plaies, le counseling, le dépistage des maladies ainsi qu'un aiguillage vers d'autres services sociaux et de santé, comme un traitement aux personnes prêtes à le recevoir. Ces centres aident à prévenir les surdoses accidentelles et à réduire la propagation de maladies infectieuses, comme le VIH, la consommation publique de drogues et la pression sur les services de santé d'urgence.
Dans son travail, Elsa continue de contribuer aux efforts de réduction de la stigmatisation. Elle affirme : « La stigmatisation de la consommation et du même fait des consommateurs est probablement la plus grande barrière dans notre travail ». Il est important de poursuivre les efforts de réduction de la stigmatisation, qui décourage les personnes de demander de l'aide.
Pour en savoir plus sur la crise des surdoses, consultez la page Web sur les opioïdes.
La transcription intégrale de l'histoire d'Elsa et d'autres histoires vécues se trouvent sur le site Galerie de la stigmatisation - Expériences Santé Canada. Les opinions exprimées et le langage utilisé sont ceux des personnes participant à ce programme et non de Santé Canada. Santé Canada n'a pas vérifié l'exactitude des déclarations faites par les participants au programme.
Outils de défense des intérêts conçus par des Inuit pour améliorer la santé et le bien‑être
L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont des facteurs importants qui influent sur la capacité d'une personne à vivre une vie saine et prospère. Cela démontre à quel point les objectifs de développement durable (ODD) sont interreliés. Si l'ODD 1 (Pas de pauvreté) et l'ODD 2 (Faim zéro) ne sont pas menés à bien, les gens ne peuvent pas profiter de l'ODD 3 (Bonne santé et bien-être).
L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont vécues différemment par les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat (disponible en anglais seulement) et les affectent beaucoup plus que le reste de la population canadienne. Le revenu médian des Inuit dans l'Inuit Nunangat figure parmi les plus faibles au pays. En effet, 37 % des familles inuites ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, comparativement à 6,4 % des Canadiens vivant dans le sud du pays (2020)Note de bas de page 11.
En 2024, l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisme national représentant les Inuit, s'est efforcé de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat grâce à la mise en œuvre continue de la stratégie de réduction de la pauvreté dans l'Inuit Nunangat. La stratégie est un appel à l'action et une feuille de route reposant sur une approche globale de réduction de la pauvreté, élaborée par les Inuit pour les Inuit. La stratégie, dont la publication est prévue au cours de la prochaine année, sera la première du genre à définir la pauvreté dans une perspective inuite et à proposer les mesures clés nécessaires pour réduire la pauvreté dans les collectivités inuites.
L'ITK poursuit également la création et la mise en œuvre d'un programme complet d'alimentation scolaire à l'échelle de l'Inuit Nunangat. Un autre outil de sensibilisation élaboré par l'ITK est le rapport sur les ateliers inuits d'alimentation scolaire, qui comprend les réussites et les défis des initiatives d'alimentation scolaire dans les régions inuites; la vision collective d'un programme universel d'alimentation scolaire dans l'Inuit Nunangat; les mesures pour élaborer un programme universel d'alimentation scolaire propre aux Inuit, qui tient compte de leur culture, de leur alimentation et de leurs valeurs; et les moyens d'améliorer l'accès au financement et aux ressources pour mieux soutenir les programmes existants d'alimentation scolaire.
Le rapport fait suite à un atelier sur le Programme inuit d'alimentation scolaire, qui a été appuyé par le Programme de financement des ODD et a réuni des détenteurs du savoir issus des 4 régions inuites.
Le manque de données et d'information sur la population inuite est l'un des défis que doit surmonter l'ITK pour concevoir des outils de sensibilisation : c'est pour cette raison que la recherche et la collecte d'information dirigées par les Inuit sont essentielles.
L'importance de la collecte de données dirigée par les Inuit
La Qanuippitaa? Enquête nationale sur la santé des Inuits, ou QENSI (disponible en anglais seulement), est une enquête en cours sur la santé et le bien-être des Inuit qui est élaborée et menée par les Inuit et coordonnée par l'ITK. À l'heure actuelle, une grande partie de l'information sur la santé des Inuit est désuète et ne reflète pas fidèlement leur état de santé et de bien-être. La QENSI recueille des renseignements à jour qui permettront aux responsables des programmes et des politiques aux échelons local, régional et national de s'informer de l'état de santé des Inuit et d'orienter l'élaboration des programmes et politiques sur ce sujet.
Jaylene Ukpatiku, une jeune Inuk de Qamani'tuaq (Baker Lake, Nunavut), est assistante de recherche affectée à la QENSI. Elle s'emploie spécifiquement à recueillir des renseignements sur la santé des populations inuites dans la région de la capitale nationale. L'objectif est d'orienter la prise de décisions, les politiques fondées sur des données probantes et les comparaisons avec les Inuit vivant dans la patrie inuite, l'Inuit Nunangat.
L'enquête portera sur de nombreux facteurs, dont la sécurité alimentaire, la culture et les identités, le mieux-être mental, l'éducation et le soutien familial, le logement et le milieu de vie, les activités terrestres et le temps passé dans la nature.
Jaylene explique : « Je veux mieux servir la communauté inuite. Je veux aider les gens et savoir comment le faire, c'est pourquoi j'aime le travail que je fais. Il me donne l'occasion de trouver des façons d'aider mon peuple et mes cousins des Premières Nations et métis. »
Lorsqu'on lui pose des questions sur les leçons retenues, Jaylene répond : « Je repense à ce que mes parents, mes grands-parents et ma communauté m'ont appris. Je veux m'assurer que le travail est ancré dans le respect culturel et les valeurs inuites. »
La collecte de données autodéterminées est essentielle pour atténuer les inégalités de santé et orienter les politiques au moyen des expériences vécues et des priorités des Inuit. Les travaux de l'ITK et de Jaylene contribuent à concrétiser la promesse de transformation centrale du Programme 2030 : ne laisser personne de côté.
Renforcer les soins à domicile tout en favorisant un sentiment d'appartenance
De nombreuses personnes âgées et en situation de handicap ont besoin de soutien pour garder leur maison en bon état. Aider les gens à continuer à vivre chez eux peut améliorer leur santé et leur bien-être et renforcer leur autonomie dans la collectivité.
Solidarité de L'Ange-Gardien est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de L'Ange-Gardien, au Québec. En 2022, il a lancé le Service AIDE‑MOI!, une initiative qui jumelle des bénévoles à des citoyens ayant besoin d'aide pour des travaux mineurs d'entretien intérieur ou extérieur sur leur propriété.
Pour commencer, l'organisme a lancé une campagne de sensibilisation pour recruter des bénévoles et informer les citoyens du service. Il a ensuite établi des partenariats afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le programme. Ces collaborations ont permis de mettre en place un réseau accueillant et inclusif, qui a obtenu d'excellents résultats.
En 2023, des citoyens ayant besoin de soutien, dont 50 % étaient âgés de 71 ans et plus, ont bénéficié de plus de 800 heures de bénévolat. De plus, 51 % étaient des femmes vivant seules qui n'étaient plus en mesure d'accomplir les tâches d'entretien de leur maison. Un bénéficiaire du programme a affirmé : « Je suis seul et âgé. Sans cela, je ne serais plus capable de vivre chez moi. »
Un autre a dit : « Avant, quand il neigeait, je ressentais de l'anxiété. Je détestais l'hiver. Maintenant, je ne me sens plus anxieux parce que je sais que quelqu'un m'aidera avec le déneigement. »
Le fait de sortir de la solitude et de l'isolement contribue grandement à une bonne santé et au bien-être. Le Service AIDE-MOI! permet aux bénévoles et aux personnes qui ont besoin d'aide de tisser des liens de confiance et d'empathie. Il crée des liens intergénérationnels qui contribuent au mieux-être mental et à un sentiment fort et sain d'appartenance à la communauté.
Reconstruire les nations grâce à la prise en charge des naissances
La naissance et la période prénatale préparent le terrain pour la vie d'un enfant, le parcours de parent d'une personne et le début de la vie en famille. Des collectivités fortes et saines sont construites par des familles fortes et saines.
Cela dit, trop souvent, les personnes des Premières Nations, inuites et métisses doivent s'éloigner de leur collectivité pour accoucher. En raison des effets persistants de la colonisation, elles peuvent accoucher à des endroits où leur culture, leur langue, leur lien avec la terre et leurs cérémonies ne sont pas reconnus et où elles peuvent être confrontées au racisme pendant leurs moments les plus vulnérables. Pour ne laisser personne de côté, il est important que les soins de santé reproductive offerts à une personne autochtone et à son enfant soient adaptés à leur culture, offerts à proximité de la maison, fondés sur la tradition et prodigués avec compétence.
C'est ce que font les sages-femmes autochtones chaque jour et chaque longue nuit lors d'un accouchement.
Les soins prodigués par une sage-femme ont réduit le nombre d'interventions pendant l'accouchement, augmenté la probabilité d'un accouchement vaginal spontanéNote de bas de page 12 et haussé les taux d'allaitementNote de bas de page 13.
En 2023, à l'occasion de la conférence de la Confédération internationale des sages-femmes en Indonésie, les participantes au programme inuit de formation des sages-femmes Inuulitsivik ont présenté des données sur les répercussions de leur travail dans la région du Nunavik, au Québec, où des sages-femmes accompagnent 85 % des naissances, dont 97 % sont des accouchements vaginaux spontanésNote de bas de page 14.
Les sages-femmes autochtones jouent un rôle essentiel dans les collectivités. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus de sages-femmes, car la majorité des Autochtones au Canada n'ont pas accès aux soins que celles-ci offrent.
Selon Alisha Julien Reid, coprésidente du National Council of Indigenous Midwives (disponible en anglais seulement), « s'il n'y a pas assez de sages-femmes, il est difficile d'encourager la natalité dans les communautés. Dans de nombreux cas, les Autochtones doivent s'éloigner pour faire des études sur les soins de santé reproductive, emportant leurs compétences et leurs connaissances. »
Le National Council of Indigenous Midwives s'efforce de changer cette situation.
Il a créé plusieurs ressources (disponibles en anglais seulement) pour que les naissances soient de nouveau prises en charge, notamment un guide sur l'état de préparation des collectivités, un cadre de compétences et un manuel sur le rétablissement de la profession de sage‑femme et la prise en charge des naissances. Il a aussi lancé un projet pour favoriser l'apprentissage au sein et à partir d'une collectivité. Par exemple, une étudiante pourrait d'abord obtenir des titres de compétence en travaillant dans sa collectivité comme conseillère en allaitement ou doula et en suivant, en cours de route, des cours en ligne en vue d'obtenir une reconnaissance professionnelle comme sage-femme. Cette approche offre de la souplesse, tout en conservant des compétences importantes dans la collectivité.
Interrogée sur les leçons apprises dans le cadre du travail du National Council of Indigenous Midwives, Alisha Julien Reid cite les paroles de son père : « Les alliés sont plus nombreux que tu ne le penses ». Elle explique qu'un changement est en cours et qu'il profitera à tout le monde. Lorsque des naissances ont de nouveau lieu dans les collectivités, les répercussions se font sentir bien au-delà de la salle d'accouchement et de la famille immédiate.
Chaque collectivité a le droit d'entendre les cris d'un nouveau-né et de l'accueillir avec amour, entouré de sa langue et de sa culture.
Les sages-femmes autochtones représentent une option sécuritaire et viable.
Répondre au besoin mondial en oxygène thérapeutique
L'oxygène thérapeutique est la pierre angulaire de la préservation de la vie et du traitement des maladies chroniques. Pourtant, pour des millions de personnes dans le monde, l'accès à l'oxygénothérapie est un besoin essentiel insatisfait.
Grands Défis Canada appuie les solutions novatrices d'oxygénothérapie qui aident à combler les lacunes mondiales en matière d'oxygène. Cet organisme a investi dans une vaste gamme de solutions pour relever les défis immédiats et à long terme liés à la distribution d'oxygène.
Voici 2 de ses innovations remarquables :
- le concentrateur d'oxygène à énergie solaire (SPO2) a été mis au point à l'Université de l'Alberta en collaboration avec Global Health Uganda pour mettre à l'essai l'utilisation de systèmes d'oxygène à énergie solaire dans les hôpitaux ruraux de l'Ouganda. L'objectif est de réduire le nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans en fournissant une alimentation électrique plus fiable pour la distribution d'oxygène. Initialement mise à l'essai en Ouganda, ce projet a ensuite été déployé à plus grande échelle en Somalie par l'Organisation mondiale de la santé. L'équipe du SPO2 a rapidement étendu ses activités dans plus de 20 établissements hospitaliers en Ouganda et a offert un soutien à l'Organisation mondiale de la santé pour l'installation dans 3 établissements en Somalie.
- l'entreprise Hewatele a été créée au Kenya pour accroître l'accès à l'oxygène thérapeutique grâce à un modèle d'affaires novateur qui combine une technologie rentable produite localement avec des services de soutien pour les établissements de santé. Hewatele s'associe aux administrations de comté pour installer ses stations d'oxygène à absorption par variation de pression dans des hôpitaux publics régionaux très fréquentés, qui fournissent ensuite de l'oxygène à d'autres établissements de santé dans la région qu'ils servent. L'entreprise offre des services à plus de 400 établissements au Kenya, a sauvé plus de 20 900 vies et en a amélioré plus de 33 400 grâce à l'oxygénothérapie essentielle.
De nombreux obstacles empêchent les gens d'avoir accès à l'oxygène thérapeutique partout dans le monde. Par exemple, la pneumonie continue d'être l'une des principales causes de mortalité infantile, et de nombreux pays n'ont pas accès à l'oxygène thérapeutique.
L'approche de Grands Défis Canada consiste à collaborer avec des partenaires mondiaux et à les soutenir, et à mettre l'accent sur les innovations à fort impact afin de répondre aux besoins de régions et de milieux particuliers. Avec l'appui du gouvernement du Canada, Grands Défis Canada continue d'investir dans l'innovation en matière d'oxygène et demeure résolu à collaborer avec des partenaires du monde entier pour déployer des solutions efficaces.
Objectif de développement durable 5 : Égalité entre les sexes
Contexte stratégique
Le Canada s'emploie à faire progresser l'égalité entre les sexes au pays et à l'étranger pour promouvoir l'égalité à l'échelle mondiale et veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+Note de bas de page 15 réussissent dans tous les aspects de la vie.
Soutenir les femmes, les filles et les organismes 2ELGBTQI+
En 2024, le gouvernement du Canada a continué de financer des organismes qui font progresser l'égalité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ et qui favorisent leur pleine participation à tous les aspects de la société canadienne ainsi qu'à l'échelle internationale par l'entremise du Fonds Égalité et en soutenant l'Alliance pour les mouvements féministes.
Les investissements au Canada comprennent : 140 millions de dollars pour des projets pluriannuels à compter de 2024 afin d'éliminer les obstacles et accroître la sécurité économique et la prospérité des femmes et des filles; 32,6 millions de dollars pour des projets pluriannuels à compter de 2024 afin d'éliminer les obstacles à l'égalité auxquels se heurtent les personnes 2ELGBTQI+ et leurs communautés; et 1,5 million de dollars octroyés à Fierté Canada Pride pour répondre aux besoins en sécurité pour la saison de la Fierté 2024. Depuis septembre 2023, le Canada a investi 27,9 millions de dollars dans un projet pilote national dans le cadre du Fonds d'équité menstruelle pour éliminer les obstacles liés à l'abordabilité et à la stigmatisation que doivent surmonter certaines personnes au Canada pour accéder aux produits menstruels.
En 2024, le gouvernement du Canada a poursuivi son partenariat avec la Rainbow Refugee Society (disponible en anglais seulement) pour aider les Canadiens et les résidents permanents à parrainer des réfugiés LGBTQI+ qui souhaitent se réinstaller au Canada. Il a également lancé un appel de propositions pour mettre des fonds à la disposition de nouveaux arrivants qui se heurtent à des obstacles à l'établissement et à l'intégration, y compris les femmes, les populations 2ELGBTQI+ et les nouveaux arrivants racisés, et pour s'attaquer à des problèmes comme la violence sexuelle et fondée sur le sexe et les troubles de santé mentale.
Le Canada continue aussi de consacrer des fonds aux associations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones dans le cadre du Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones. De 2024 à 2025, 7,36 millions de dollars ont été accordés à des projets à long terme menés par des associations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones partout au pays.
Adopter une approche inclusive en matière d'élaboration de politiques
En 2024, le gouvernement fédéral a continué d'utiliser l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) pour élaborer ses politiques et initiatives. Pour en savoir plus sur l'ACS Plus, visitez la page Web de l'ACS Plus.
Le Canada a continué de renforcer sa relation avec les associations de femmes autochtones par l'entremise d'ententes pangouvernementales conclues avec 3 organismes nationaux de femmes autochtones : l'Association des femmes autochtones du Canada (disponible en anglais seulement), Pauktuutit Inuit Women of Canada (disponible en anglais seulement) et Les Femmes Michif Otipemisiwak (disponible en anglais seulement). Ces ententes établissent la façon dont le Canada et les organismes collaborent pour inclure les priorités des femmes autochtones et des personnes 2ELGBTQI+ dans les politiques, les lois et les programmes fédéraux.
Accroître l'accès à des services de garde inclusifs, abordables et de grande qualité
Le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada afin que chaque famille ait accès à des services de garde abordables, inclusifs, souples et de grande qualité, peu importe son lieu de résidence au Canada. L'un des objectifs du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada est de réduire les frais des services de garde réglementés à 10 $ par jour ou moins en moyenne partout au pays.
En février 2025, 8 provinces et territoires offraient des services de garde réglementés à 10 $ par jour ou moins en moyenne, y compris le Québec et le Yukon (qui offraient déjà des services à ce coût avant la mise en place du système pancanadien). Dans les autres provinces et territoires, les frais des services de garde réglementés ont été réduits d'au moins 50 % en moyenne, y compris en Ontario, où les frais moyens s'élèvent à 19 $ par jour, et en Alberta, où les frais quotidiens moyens se chiffrent à 15 $.
Le gouvernement fédéral finance également la création de 250 000 nouvelles places en service de garde au pays d'ici mars 2026. Les provinces et les territoires font d'importants progrès et, à ce jour, ont annoncé des mesures qui favoriseront la création de plus de 150 000 nouvelles places.
Des études indiquent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'économie en général reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retourNote de bas de page 16. Selon des recherches externesNote de bas de page 17, les investissements provinciaux et fédéraux dans les services de garde abordables se traduiront par une augmentation du produit intérieur brut de 0,075 à 0,078 point de pourcentage, soit entre 2,25 et 2,48 milliards de dollars (2023). En 2021, on estimait que les investissements fédéraux appuyant un meilleur accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de haute qualité pouvaient faire en sorte que jusqu'à 240 000 travailleurs intègrent le marché du travail.
De 2019 à 2024, le taux de participation au marché du travail des femmes de 25 à 54 ans ayant de jeunes enfants de 0 à 5 ans a augmenté de 3,3 points de pourcentage. Cette augmentation représente environ 74 200 femmes de plus qui travaillent ou cherchent activement un emploi. En 2024, un nombre record de mères de jeunes enfants, soit 1,2 million, participaient au marché du travailNote de bas de page 18 . D'autres recherches doivent être menées pour confirmer l'incidence des investissements fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sur la participation au marché du travail des mères.
Le gouvernement fédéral continue de travailler en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis pour mettre en œuvre le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui a été élaboré conjointement avec ces organismes, et pour améliorer l'accès aux programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dirigés par des Autochtones et adaptés à leur culture.
Quelle que soit l'option choisie par les parents en matière de services de garde, l'Allocation canadienne pour enfants représente un soutien direct non imposable qui aide chaque année environ 3,5 millions de familles, dont plus de 6 millions d'enfants. Même si les familles peuvent utiliser cette prestation comme bon leur semble, pour un grand nombre d'entre elles, elle permet de réduire de beaucoup le fardeau des dépenses associées à la garde d'enfants, et parfois, d'éliminer entièrement ces dépenses grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à réduire les frais de garde dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.
Mettre fin à la violence fondée sur le sexe
Le Canada s'engage à créer une société qui est exempte de violence fondée sur le sexe et qui soutient les victimes, les survivantes et leur famille, peu importe leur lieu de résidence. Les mesures prises de 2023 à 2024 comprennent la signature de 13 ententes bilatérales de financement avec les provinces et les territoires pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans; la tenue de la deuxième table ronde fédérale, provinciale, territoriale et autochtone sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées; le soutien des ententes de financement dans les 13 provinces et territoires pour fournir des avis juridiques indépendants et une représentation juridique aux victimes et aux survivantes d'agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes; et la poursuite de la collaboration avec les réseaux de refuges et les organismes autochtones pour prévenir la violence fondée sur le sexe et soutenir les survivantes. Le Programme pour la prévention de la violence familiale de Services aux Autochtones Canada appuie les activités de prévention de la violence et de sensibilisation à celle-ci qui sont conformes à la culture, y compris des services intégrés améliorés pour la clientèle des refuges. La collaboration se poursuit entre le Programme et la Société canadienne d'hypothèques et de logement en ce qui concerne l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, dans le cadre de laquelle 69 projets ont été retenus à ce jour, dont ceux se rapportant à 37 refuges et à 32 maisons de transition.
Chaque année, le gouvernement fédéral publie un rapport d'avancement sur la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Les points saillants de 2023 à 2024 peuvent être consultés sur la page Web du rapport d'avancement annuel de la Voie fédérale. La Voie fédérale repose sur une approche fondée sur les distinctions et constitue la contribution du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Des options sont en cours d'élaboration pour la création d'un poste d'ombudsman national des droits de la personne et des Autochtones, comme l'indique l'appel à la justice 1.7.
Le Canada est un chef de file de la promotion du soutien des organismes de défense des droits des femmes et des mouvements féministes. Il se classe parmi les principaux donateurs bilatéraux appuyant les efforts de financement visant à promouvoir l'égalité entre les sexes et à combattre la violence sexuelle et fondée sur le sexe, y compris les pratiques préjudiciables comme le mariage forcé et les mutilations génitales féminines.Le Canada appuie des organismes et collabore étroitement avec eux, notamment le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, afin de mettre en œuvre des initiatives visant à prévenir et à contrer la violence sexuelle et fondée sur le sexe, à soutenir les survivantes et à améliorer les systèmes juridiques et sociaux à l'échelle mondiale pour protéger les femmes et les filles. En novembre 2024, le Canada et la Zambie ont codirigé une résolution des Nations Unies pour mettre fin aux mariages d'enfants, précoces et forcés.
Analyse statistique
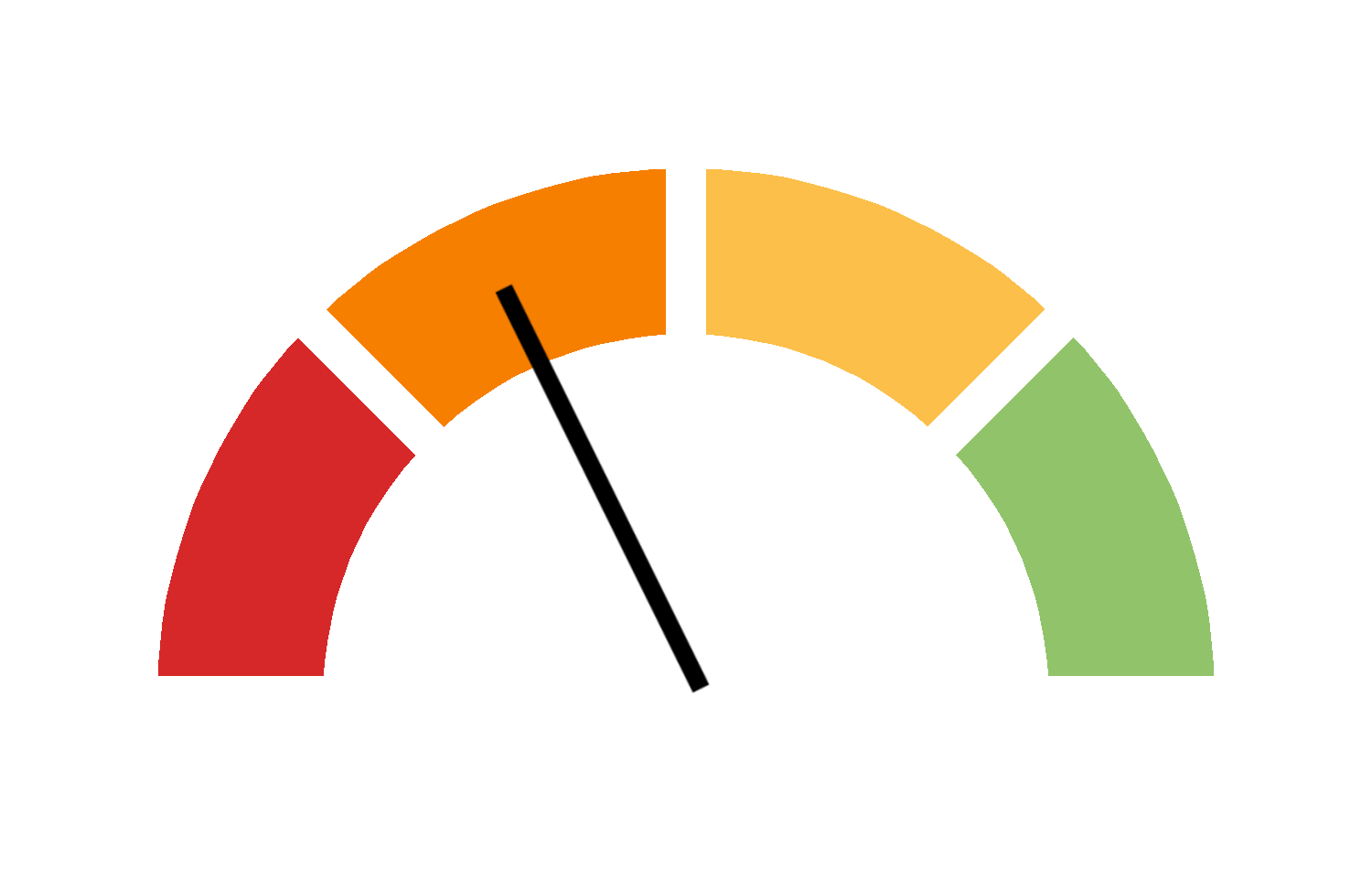
Indicateur national 5.4.1 : Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés
Les occupations auxquelles vaquent les Canadiens pendant leur journée varient considérablement selon les sexes et les groupes d'âge, ce qui est particulièrement évident lorsqu'on examine la proportion du temps qu'ils consacrent aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés. En 2022, les Canadiens ont consacré, en moyenne, 13,3 % ou 3,2 heures de leur journée aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés, notamment à des activités comme les tâches ménagères, les soins aux enfants ou aux adultes du ménage et les achats de biens et de services. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 3,0 heures enregistrées en 2015. Puisque la proportion de Canadiens qui travaillent surtout à domicile a augmenté depuis le début de la pandémie en 2020 et s'est maintenue jusqu'en 2022, une partie du temps qui n'est maintenant plus consacré aux déplacements est maintenant réservé à d'autres activités, comme les travaux et les soins domestiques non rémunérésNote de bas de page 19.
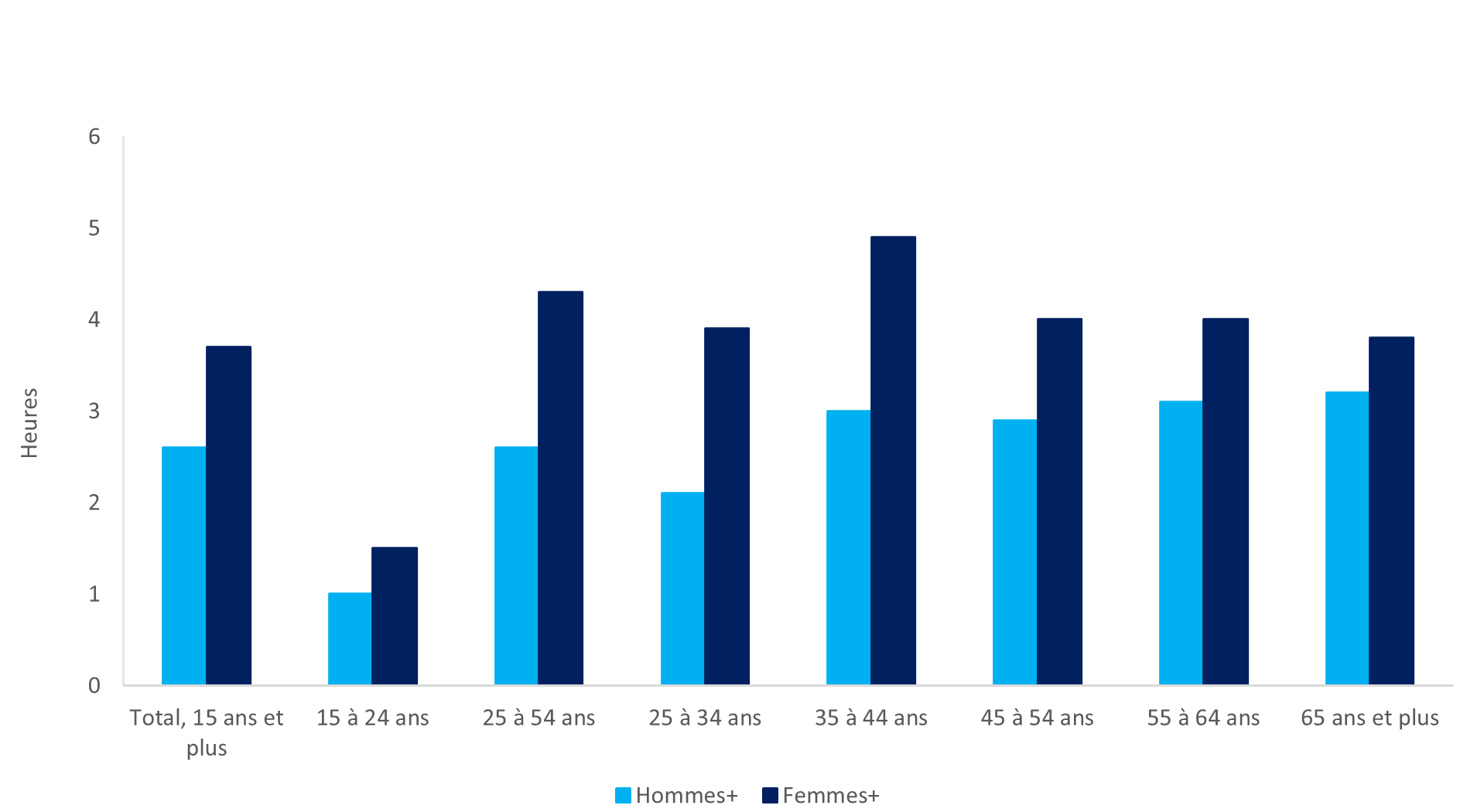
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi du temps
Description textuelle de la figure 4
| Groupe d'âge | Hommes+ | Femmes+ |
|---|---|---|
| Total, 15 ans et plus | 2.6 | 3.7 |
| 15 à 24 ans | 1 | 1.5 |
| 25 à 54 ans | 2.6 | 4.3 |
| 25 à 34 ans | 2.1 | 3.9 |
| 35 à 44 ans | 3 | 4.9 |
| 45 à 54 ans | 2.9 | 4 |
| 55 à 64 ans | 3.1 | 4 |
| 65 ans et plus | 3.2 | 3.8 |
La proportion du temps consacré aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés différait entre les hommes et les femmes, mais l'écart a légèrement diminué, passant de 5 points de pourcentage en 2015 à 4,6 points en 2022, ce qui montre des progrès limités vers l'atteinte de l'objectif de partage égal des responsabilités parentales et ménagères. Les femmes consacraient en moyenne 3,7 heures par jour, soit 15,4 % de leur journée, à des travaux et à des soins domestiques non rémunérés en 2022, en hausse par rapport aux 3,6 heures par jour en 2015 (figure 4). Parallèlement, les hommes consacraient environ une heure de moins que les femmes aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés en 2022 (2,6 heures par jour).
Les différences entre les hommes et les femmes s'accentuent lorsqu'on compare le temps consacré aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés chez les groupes d'âge qui sont plus susceptibles d'avoir de jeunes enfants à domicile. Par exemple, en 2022, les femmes de 35 à 44 ans consacraient 4,9 heures par jour à des travaux et à des soins domestiques non rémunérés, ce qui représente le nombre d'heures le plus élevé parmi tous les groupes d'âge et 1,9 heure de plus que les hommes du même âge. De même, les femmes de 25 à 34 ans consacraient beaucoup plus de temps aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés en 2022 que les hommes du même âge (3,9 heures par rapport à 2,1 heures). Ensemble, ces groupes d'âge ont affiché l'écart le plus important entre les sexes pour ce qui est des travaux et des soins domestiques non rémunérés en 2022, car les femmes ont continué d'assumer une plus grande part des tâches comme les soins aux enfants de moins de 18 ans, l'achat de biens ou de services, la préparation ou le service des repas et le nettoyage.
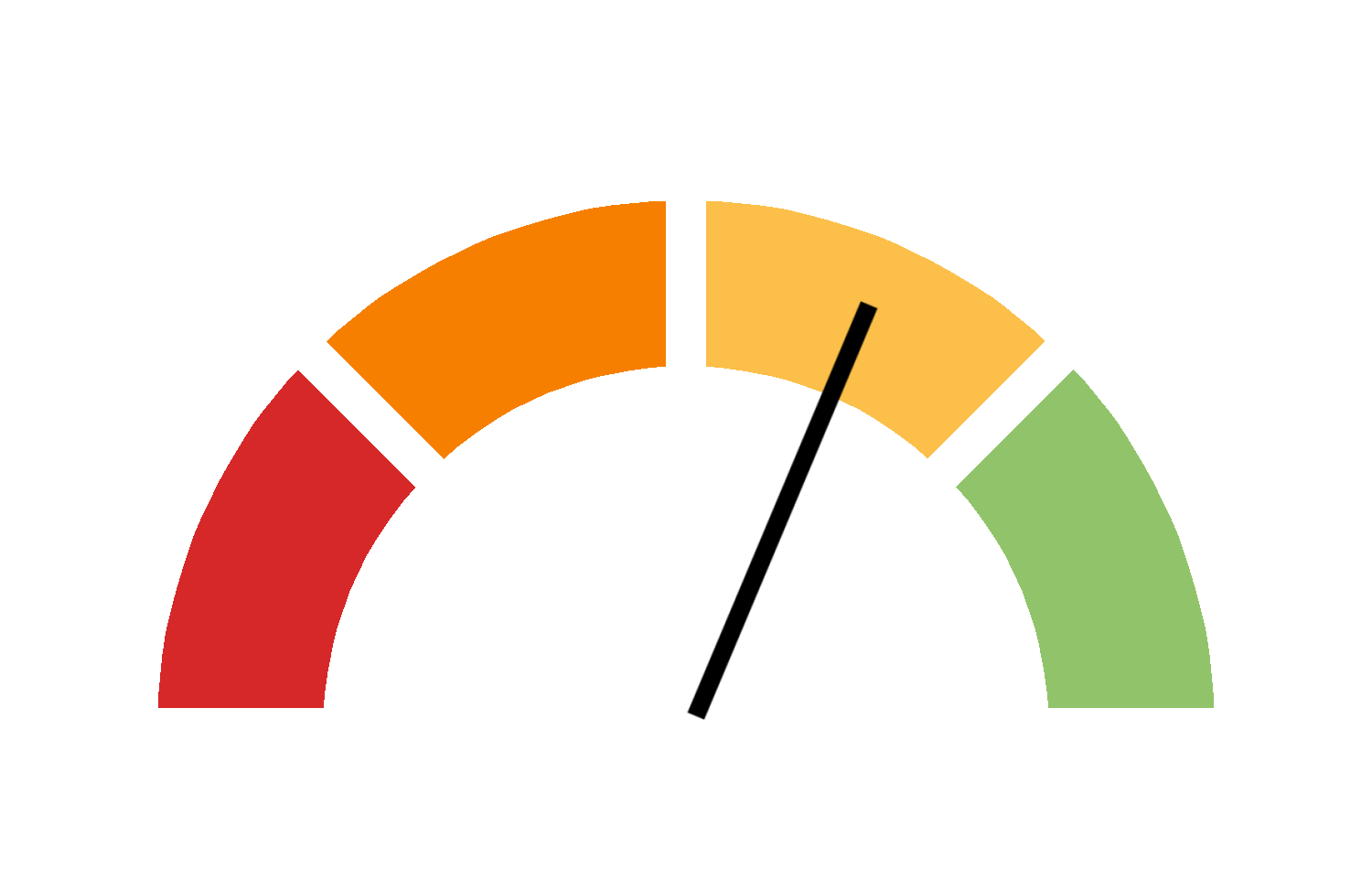
Indicateur national 5.5.1 : Ratio du salaire horaire médian entre homme et femme
Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme mesure la proportion d'un dollar que gagnent les femmes pour chaque dollar gagné par les hommes. Cet indicateur aide à mesurer les progrès liés à l'égalité entre les sexes sur le marché du travail.
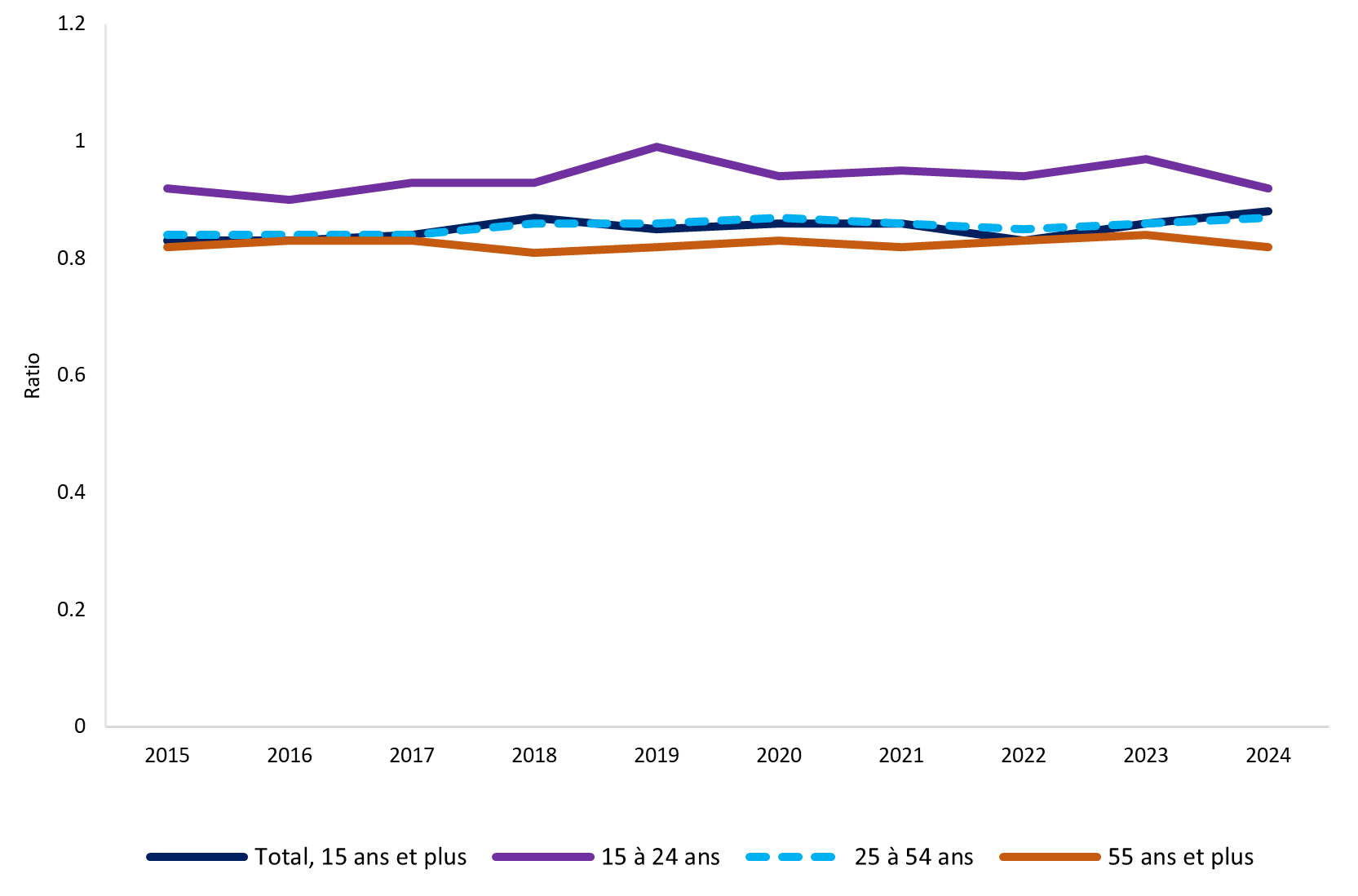
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active
Description textuelle de la figure 5
| Année | Total, 15 ans et plus | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
| 2016 | 0.83 | 0.9 | 0.84 | 0.83 |
| 2017 | 0.84 | 0.93 | 0.84 | 0.83 |
| 2018 | 0.87 | 0.93 | 0.86 | 0.81 |
| 2019 | 0.85 | 0.99 | 0.86 | 0.82 |
| 2020 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.83 |
| 2021 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.82 |
| 2022 | 0.83 | 0.94 | 0.85 | 0.83 |
| 2023 | 0.86 | 0.97 | 0.86 | 0.84 |
| 2024 | 0.88 | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme, à la fois des employés à temps plein et à temps partiel âgés de 15 ans et plus, est passé de 0,86 en 2023 à 0,88 en 2024, ce qui représente l'écart salarial horaire médian entre les sexes le plus étroit depuis que des données comparables étaient disponibles en 1997 (figure 5). Cela signifie que les femmes gagnaient 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes en 2024, une hausse de 0,02 $ par rapport à 2023. Cette réduction de l'écart salarial entre les genres montre que des progrès ont été réalisés vers la réalisation de l'ambition canadienne, mais qu'une accélération est encore nécessaire pour résorber cet écart.
Bien que le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme soit passé de 0,86 en 2023 à 0,87 en 2024 pour l'ensemble des employés âgés de 25 à 54 ans, la situation des autres groupes d'âge est différente. Par exemple, le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme chez les employés âgés de 15 à 24 ans a diminué, passant de 0,97 en 2023 à 0,92 en 2024. Malgré cette baisse, les femmes de 15 à 24 ans étaient celles qui étaient les mieux rémunérées par comparaison à leurs homologues masculins en 2024, ce qui s'explique en partie par la prévalence du travail à temps partiel chez les femmes de ce groupe d'âgeNote de bas de page 20. Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme des employés à temps partiel était de 1,11 en 2024, ce qui signifie que les femmes travaillant à temps partiel gagnaient 0,11 $ de plus l'heure que les hommes. Par ailleurs, les femmes de 55 ans et plus ont connu une baisse de leur rémunération par rapport aux hommes, car le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme pour ce groupe d'âge a diminué, s'établissant à 0,82 en 2024, ce qui représente le plus faible ratio parmi tous les groupes d'âge.
Parmi les provinces, l'Île-du-Prince-Édouard affichait le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme le plus élevé. Le ratio entre les femmes et les hommes était de 1,0 en 2024, ce qui dénote la parité. Cela fait suite à un ratio de 1,04 l'année précédente. Le Nouveau-Brunswick (0,94) a affiché le deuxième ratio en importance en 2024, suivi de la Nouvelle-Écosse (0,93). Par ailleurs, les 2 plus faibles ratios du salaire horaire médian ont été enregistrés dans les Prairies en 2024. Le ratio du salaire horaire médian de l'Alberta a augmenté, passant de 0,76 en 2023 à 0,78 en 2024, tandis que la Saskatchewan a connu la seule autre baisse parmi les provinces, car son ratio a diminué, se situant à 0,82 en 2024 par rapport à 0,83 l'année précédente.
Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme a augmenté dans la plupart des professionsNote de bas de page 21 en 2024 comparativement à 2023. Les professions de la santé, à l'exclusion des postes de direction, ont enregistré un ratio du salaire horaire médian entre homme et femme inférieur en 2024 (0,94) par rapport à 2023 (0,98). Malgré cette diminution, les professions de la santé, à l'exclusion des postes de direction, étaient le type de profession dont l'écart de salaire horaire médian entre homme et femme était le plus faible. Parallèlement, plusieurs types de professions présentaient des écarts de salaires horaires médians entre homme et femme nettement inférieurs à la moyenne nationale. Par exemple, les femmes occupant des postes ne faisant pas partie de la catégorie des postes de gestion dans les domaines de l'éducation, du droit et des services sociaux, communautaires et gouvernementaux sont celles qui ont gagné le moins par comparaison à leurs homologues masculins en 2024 (0,75), tout comme les femmes occupant des postes ne faisant pas partie de la catégorie des postes de gestion dans les domaines des ressources naturelles, de l'agriculture et de la production connexe (0,75).
Articles de fond
Les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones collaborent pour soutenir les éducatrices de la petite enfance
Pour les familles canadiennes, les services de garde d'enfants abordables, adaptés, inclusifs et de qualité ne sont pas un luxe, mais une nécessité. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral adhère à la vision sous-tendant le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, qui créera 250 000 nouvelles places en service de garde partout au pays d'ici mars 2026.
Les responsabilités en matière de garde d'enfants non rémunérée constituent un obstacle à la participation des femmes au marché du travail. De 2019 à 2024, le taux d'activité des femmes de 25 à 54 ans ayant de jeunes enfants d'au plus 5 ans a augmenté de 3,3 points de pourcentage au CanadaNote de bas de page 22. D'autres recherches devront être effectuées pour confirmer l'incidence des investissements fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sur la participation des mères au marché du travail, mais on s'attend à ce que ces investissements augmentent à long terme.
Pour pouvoir offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, il faut pouvoir compter sur des éducatrices de la petite enfance. Ces personnes offrent un environnement sûr, enrichissant et stimulant, en plus de planifier, d'organiser et de diriger des programmes pour les enfants. Leur travail aide les enfants à acquérir des compétences afin de s'épanouir dans un monde en évolution rapide. En 2016, le personnel des services de garde d'enfants était surtout composé de femmes (96,3 %) et près de 1 femme sur 3 (32,7 %) était immigrante ou résidente non permanenteNote de bas de page 23.
Comme c'est le cas dans d'autres secteurs de l'économie des soins, où les femmes et les personnes racisées sont surreprésentées de manière disproportionnée, celles qui travaillent dans le secteur de l'éducation de la petite enfance ne reçoivent souvent pas la reconnaissance qu'elles méritent pour leur contribution inestimable au bien-être des enfants et à l'économie du pays. Les faibles salaires, les mauvaises conditions de travail, les possibilités d'avancement limitées et le peu d'hommes qui travaillent dans ce domaine ont entraîné des pénuries constantes de main-d'œuvre dans le secteur canadien de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.
Grâce au soutien fédéral, les provinces et les territoires du Canada mettent en œuvre des mesures pour soutenir le personnel des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sur leur territoire, notamment les grilles salariales, les régimes de retraite, les régimes d'avantages sociaux et les stratégies relatives à l'effectif. Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux travaillent également à l'élaboration d'une stratégie relative à l'effectif axée sur le recrutement, le maintien en poste et la reconnaissance.
Ces difficultés sont amplifiées dans le secteur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, particulièrement en ce qui concerne la gestion des pénuries de main-d'œuvre, l'établissement de grilles salariales concurrentielles et l'élimination des obstacles à l'éducation et à la formation, de même que la gestion des effets persistants de la colonisation. Les partenaires autochtones s'emploient à élaborer des modules de formation adaptés à la culture et à renforcer les capacités humaines, en s'appuyant sur la culture et la revitalisation de la langue.
En collaboration, les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones ont élargi l'accès aux services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les familles. En mars 2025, les familles d'environ 900 000 enfants bénéficiaient de services de garde de grande qualité partout au paysNote de bas de page 24. Les investissements fédéraux servent à financer 35 000 places abordables dans près de 1 000 établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones ainsi que l'ouverture de plus de 10 nouveaux centres dans les collectivités métisses, et plusieurs autres devraient ouvrir au cours des 2 prochaines années. D'ailleurs, 8 provinces et territoires offrent des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à un coût moyen de 10 $ par jour, alors que les autres ont réduit les frais d'au moins 50 %Note de bas de page 25.
En mars 2024, l'engagement du Canada à offrir aux familles et aux enfants l'accès à des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité a été concrétisé dans une loi lorsque la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada a reçu la sanction royale.
Un appel à l'aide
Si une personne de votre entourage vous confiait qu'elle est victime de violence, sauriez-vous quoi faire pour l'aider? Plus de 11 millions de Canadiens ont subi une forme quelconque de violence psychologique, physique ou sexuelle aux mains d'un partenaire intime ou d'un ex-partenaire depuis l'âge de 15 ansNote de bas de page 26.
Des Canadiens vivent la violence chaque jour en raison de leur sexe, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur genre présumé. C'est ce qu'on appelle la violence fondée sur le sexe, et statistiquement, les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre courent un risque plus élevé d'en subir. Les victimes de violence fondée sur le sexe sont souvent humiliées, réduites au silence et stigmatisées, et peu de personnes estiment avoir la confiance ou les connaissances nécessaires pour soutenir les survivantes.
L'initiative Appel à l'aide de la Fondation canadienne des femmes, financée par Femmes et Égalité des genres Canada, a été conçue et lancée en avril 2020 pour parer au risque accru de violence fondée sur le sexe pendant la pandémie de COVID-19. L'appel à l'aide est un simple geste de la main qu'une personne peut faire pour communiquer silencieusement qu'elle souhaite que quelqu'un la contacte et lui vienne en aide, en toute sécurité. Cet outil simple est devenu viral peu après son lancement et a été partagé partout dans le monde, dans plus de 50 pays et en 20 langues.
Pour aider les gens à apprendre comment soutenir une personne confrontée à la violence fondée sur le sexe, la Fondation canadienne des femmes a élaboré un guide d'action gratuit pour répondre à un appel à l'aide et un parcours d'apprentissage par courriel, un mini-cours gratuit sur la façon de répondre à un appel à l'aide et la série de balados Appel à l'aide comprenant des entrevues avec des survivantes et des experts. Aujourd'hui, 47 % des Canadiens reconnaissent l'appel à l'aide, 10 % l'ont utilisé ou l'ont vu être utilisé, et plus de 89 000 personnes ont répondu à un appel à l'aide.
Une personne qui a répondu à un appel à l'aide a raconté son histoire : « Pendant la rencontre en ligne de notre groupe de 4 personnes, nous avons entendu, au milieu de notre conversation, un bruit derrière l'une des femmes [...] J'ai compris par son regard qu'elle était surprise d'entendre ce bruit, et elle avait un regard craintif [...] Son attitude a rapidement changé, puis elle a fait le geste de la main. Nous savions toutes ce que ça signifiait et nous avons figé sur notre chaise pendant une seconde parce que nous ne nous attendions tout simplement pas à ça [...] Nous avons continué à parler. J'avais son numéro de téléphone cellulaire, alors je lui ai envoyé un texto pour lui demander si elle avait un plan de sécurité [...] Nous avons fini par composer le 911 en son nom parce qu'elle nous l'a demandé dans le clavardage. »
L'appel à l'aide ne sauve pas seulement des vies; il transforme aussi les mentalités entourant la violence fondée sur le sexe. Ainsi, au lieu d'entretenir les préjugés et de garder le silence, on se concentre maintenant plutôt sur la sensibilisation, le soutien et l'autonomisation. Lorsque vous savez ce qu'est la violence fondée sur le sexe et comment réagir aux signes de violence, vous pouvez changer la situation.
Des hommes et des garçons ont recours au théâtre pour combattre la violence fondée sur le sexe
À Halifax, un groupe de jeunes hommes et de garçons issus de communautés de nouveaux arrivants se sont réunis dans une modeste salle de théâtre. Bon nombre d'entre eux étaient alors devant l'inconnu : ils ne connaissaient pas la scène et n'avaient aucune idée des conversations qu'ils auraient bientôt. Ils étaient là pour faire face à l'un des problèmes sociaux les plus épineux : la violence fondée sur le sexe.
Pour de nombreux jeunes hommes et garçons, les occasions de participer de façon significative aux efforts de prévention de la violence fondée sur le sexe peuvent sembler hors de portée. Pourtant, de plus en plus de données probantes montrent que lorsque les hommes et les garçons participent aux efforts déployés pour remettre en question les normes rigides en matière de genre et promouvoir l'égalité entre les sexes, ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la transformation des comportements nuisibles et la création de collectivités plus fortes et plus sécuritairesNote de bas de page 27.
Le programme de prévention de la violence fondée sur le sexe du YMCA d'Halifax a réuni un groupe diversifié de participants en appliquant une approche novatrice. En partenariat avec Adeb Arianson, directeur et fondateur du mouvement Growth Initiative for Dedicated LGBTQ+ Advocacy, ou GIDA, ils se sont tournés vers le théâtre et en ont fait un outil de changement. Au cours de l'atelier, la scène s'est transformée en espace d'exploration et d'apprentissage - un lieu pour souligner l'importance de la prévention de la violence fondée sur le sexe, pratiquer des interventions en toute sécurité et promouvoir la sensibilisation.
Au début, on sentait l'hésitation. Le sujet était très personnel et, pour beaucoup, inconfortable. Cela dit, Adeb et les animateurs savaient à quel point il était important de libérer les participants de ce sentiment d'inconfort. Ils ont donné le ton avec respect et empathie et ont ménagé avec soin les sensibilités culturelles et religieuses, en mettant l'accent sur des valeurs communes comme la sécurité et l'égalité. Cette approche a favorisé la confiance et le dialogue au sein du groupe.
Au moyen d'exercices interactifs sous forme de jeux de rôle, les jeunes hommes se sont exercés à réagir à des scénarios conformes à la réalité. Ils ont acquis des compétences pratiques pour intervenir de façon sécuritaire et efficace et ont gagné en confiance grâce à leur capacité à dénoncer les comportements préjudiciables. « Je n'ai jamais réalisé à quel point de petits gestes pouvaient faire une si grande différence. Maintenant, je sais comment agir en toute sécurité », a déclaré un participant. De nombreux participants ont fait écho à ce sentiment, se sentant mieux outillés et motivés à la fin de l'atelier pour promouvoir l'égalité dans leurs communautés.
Conscients du vaste potentiel du projet, les organisateurs ont filmé les ateliers pour sensibiliser le public et encourager une participation communautaire accrue. En montant sur scène, ces jeunes hommes et garçons ont choisi d'intervenir dans la vraie vie - une conversation, un geste et une collectivité à la fois.
Lutter contre la précarité menstruelle au Canada
Personne ne devrait être obligé de choisir entre la santé menstruelle et une alimentation adéquate. Pourtant, c'est ce qui arrive chaque jour au Canada. La précarité menstruelleNote de bas de page 28 touche des millions de personnes menstruées au paysNote de bas de page 29.
Dans les 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires soutenus par Banques alimentaires Canada, le personnel et les bénévoles constatent qu'un trop grand nombre de personnes sont obligées de choisir entre l'achat de produits menstruels ou d'aliments en quantité suffisante. Ils voient des familles dont les adultes s'absentent du travail ou les adolescentes s'absentent de l'école parce qu'elles n'ont pas les moyens de se procurer suffisamment de produits menstruels.
En 2023 et 2024, Banques alimentaires Canada a distribué 72,7 millions de produits menstruels gratuits à près de 3,5 millions de personnes qui ont habituellement de la difficulté à s'en procurer. Le réseau a également octroyé 2,5 millions de dollars à des organismes pour qu'ils intensifient leurs activités d'information et de sensibilisation, qui réduisent la stigmatisation liée aux règles et aident les personnes à gérer leurs menstruations de manière à préserver leur santé et leur confort.
Dans le cadre du programme pilote, près de 400 banques alimentaires et autres organismes communautaires dans l'ensemble des provinces et territoires ont servi de points de distribution. De plus, 2 000 autres organismes ont participé en distribuant des produits menstruels à partir de ces établissements. En raison de la diversité des mandats de ces organismes, des réfugiés, des personnes en situation d'itinérance, des communautés autochtones, des personnes transgenres et non binaires et des résidents des régions rurales et éloignées ont pu participer au projet.
« Tout le monde a reconnu qu'il s'agissait d'un besoin et était heureux de distribuer des produits ou d'en recevoir », a souligné Community Bridge, un organisme participant de Fort St. John, en Colombie-Britannique, dans un rapport.
Certaines personnes ont mentionné que le programme les avait aidées à faire face à la stigmatisation entourant les menstruations. Citons une personne qui a recours aux services de la banque alimentaire Just Friends de Stanley, au Nouveau-Brunswick : « Je suis non binaire, et le fait que [Just Friends] me fournit des produits menstruels sans poser de questions et sans porter de jugement réduit grandement mon anxiété. »
De nombreuses personnes ont dit se sentir soulagées parce qu'on avait répondu à leurs besoins essentiels. Comme l'a dit une cliente de la banque alimentaire de Cambridge, en Ontario : « Mes règles sont abondantes et le fait de pouvoir obtenir suffisamment de serviettes hygiéniques et de tampons m'a permis d'économiser plus de 40 $ ce mois-ci. Cela peut paraître insignifiant, mais comme je reçois des prestations d'invalidité, ce montant représente une semaine d'épicerie. »
Les produits menstruels gratuits n'ont pas seulement allégé le fardeau financier des personnes ayant de la difficulté à boucler leurs fins de mois, ils ont aussi amélioré leur bien-être à d'autres égards. Par exemple, selon Tereena Donahue, directrice générale de la section Cariboo-Chilcotin en Colombie-Britannique de l'Association canadienne pour la santé mentale, le fait d'avoir éliminé l'obstacle lié au coût a permis aux « personnes de gérer leur hygiène menstruelle avec dignité ».
« Les clients n'ont plus à s'inquiéter de la disponibilité des produits ni à compromettre leur hygiène, a-t-elle ajouté. Cela a non seulement amélioré leur bien-être physique, mais a aussi contribué à leur santé émotionnelle et mentale. »
Promouvoir la participation politique des femmes des Premières Nations et contrer la violence fondée sur le sexe
L'Assemblée des Premières Nations (APN) est un organisme national de défense des intérêts qui s'emploie à répondre aux priorités collectives des membres et des collectivités des Premières Nations partout au Canada entourant des questions et préoccupations de nature nationale ou internationale.
En 2024, l'APN a dirigé les travaux nationaux de sensibilisation afin d'appuyer la réponse aux 231 appels à la justice émanant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle a présenté des mémoires au Parlement pour appuyer l'établissement d'un cadre sur les droits de la personne des Autochtones et a milité à l'échelle internationale pour éliminer la violence fondée sur le sexe.
L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a exposé 4 façons dont la violence coloniale se perpétue à l'endroit des femmes autochtones : les traumatismes historiques, multigénérationnels et internationaux; la marginalisation sociale et économique; le maintien du statu quo et le manque de volonté de la part des institutions; et le fait de ne pas tenir compte de la volonté d'action et de l'expertise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Par conséquent, les femmes et les filles des Premières Nations sont représentées de façon disproportionnée dans les situations de violence et les établissements correctionnels et vivent à la fois la pauvreté et l'itinérance.
Les perturbations causées par les politiques coloniales dans les sociétés des Premières Nations ont également éloigné les femmes des Premières Nations de leurs rôles de leadership traditionnels au sein de leur nation. En 2024, l'APN s'est efforcée d'améliorer la participation politique des femmes des Premières Nations et a constaté une augmentation de la représentation féminine dans les postes de direction.
En 2024, l'APN a organisé une série de conférences virtuelles en 3 parties à l'intention des dirigeantes des Premières Nations, notamment des élues communautaires, la cheffe nationale, des cheffes régionales et des députées. La série de conférences a créé un espace pour autonomiser les femmes en tant que dirigeantes par la présentation des réflexions et des expériences des dirigeantes des Premières Nations. À la suite des conférences, un rapport intitulé Conseils de dirigeantes aux aspirantes dirigeantes des Premières Nations a été rédigé pour résumer les discussions. Le rapport sera un outil de soutien pour les dirigeantes actuelles et futures des Premières Nations. De même, l'APN a organisé un dîner sur le leadership exercé par les femmes à l'occasion du Caucus national des femmes dirigeantes afin de faciliter le réseautage et la création de liens.
Les travaux de l'APN ont été et continueront d'être orientés par son Conseil des femmes ainsi que par les survivants et les familles des Premières Nations. Par exemple, le Conseil des femmes et le Conseil des personnes 2ELGBTQQIA+ de l'APN ont fourni de précieux commentaires sur le rapport d'étape sur les appels à la justice de l'APN, qui a été publié en juin 2024. Le rapport de 2024 porte sur les progrès réalisés au cours des 5 dernières années par tous les ordres de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, en réponse aux 231 appels à la justice.
L'APN continue de militer pour la criminalisation de la stérilisation forcée et contrainte. Lors de l'assemblée générale annuelle de l'APN en juillet 2024, le Conseil des femmes a rencontré le Cercle national des survivants pour la justice reproductive afin de discuter du projet de loi S‑250.
Lors de son assemblée extraordinaire des chefs en décembre, l'APN a réuni un groupe d'experts sur la question de la traite des personnes et du trafic sexuel touchant les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre des Premières Nations. Il est important d'accroître la sensibilisation en réunissant des groupes d'experts de ce genre, car la première étape consiste à poursuivre les discussions sur ce sujet.
Prévenir la violence et promouvoir la cohésion sociale en Asie du Sud-Est
Le projet visant à autonomiser les femmes pour une paix durable et à prévenir la violence et promouvoir la cohésion sociale au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (disponible en anglais seulement), ou ANASE, vise à faire progresser le programme Femmes, paix et sécurité au sein de l'ANASE. Il met l'accent sur la prévention de la violence faite aux femmes et la promotion de la cohésion sociale régionale. ONU Femmes, le partenaire de la mise en œuvre du projet, soutient les initiatives de l'ANASE, comme le carrefour régional du savoir et de l'innovation sur les femmes, la paix et la sécurité.
L'impact du projet est déjà évident. Par exemple, en août 2024, le Vietnam a lancé son premier plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, marquant une étape importante de son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en matière de paix et de sécurité.
ONU Femmes a fourni un soutien technique au ministère des Affaires étrangères du Vietnam pour élaborer le plan, avec l'appui du gouvernement du Canada, du Royaume-Uni et de la Corée du Sud. Parmi les principaux facteurs de réussite du Vietnam, mentionnons une forte participation dans divers ministères et un partenariat avec des partenaires externes. Le plan d'action a permis de renouveler l'engagement en faveur de l'égalité entre les sexes et pourrait transformer la vie des femmes et des filles et favoriser une contribution significative des femmes à la prévention des conflits et au maintien de la paix au Vietnam, dans les pays membres de l'ANASE et ailleurs.
Le plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité du Vietnam est un exemple de ce qui peut être accompli en élargissant les partenariats et en tirant parti des ressources pour s'assurer qu'aucune femme ou fille n'est laissée pour compte.
Objectif de développement durable 8 : Travail décent et croissance économique
Contexte stratégique
Les ambitions du Canada rattachées à cet objectif sont de veiller à ce que les Canadiens aient accès à des emplois de qualité et qu'ils contribuent à une croissance économique durable et en tirent parti.
Approche du Canada en matière d'emplois durables
En 2024, la Loi canadienne sur les emplois durables est entrée en vigueur. La Loi favorisera la création d'emplois durables, soutiendra les travailleurs, les industries et les collectivités partout au pays et aidera les travailleurs à acquérir des compétences et des outils et à suivre une formation pour bénéficier de nouvelles possibilités d'emplois durables.
La Loi prévoit la publication d'un plan d'action tous les 5 ans, à compter de 2025, qui expose la façon dont le gouvernement fédéral appuiera les travailleurs dans une économie à faibles émissions de carbone.
De plus, la Loi établit le Conseil du partenariat pour des emplois durables, qui réunira des intervenants de partout au Canada et formulera des conseils indépendants à l'intention du gouvernement fédéral sur la meilleure façon de soutenir les travailleurs et les collectivités et de favoriser une croissance économique à faibles émissions de carbone. Le Conseil veillera à l'harmonisation des mesures en matière d'emplois durables du Canada avec les réalités locales et à ce qu'elles reflètent les besoins et les expériences des partenaires et des intervenants, notamment les autres ordres de gouvernement, les syndicats, les travailleurs, l'industrie, la société civile et les organismes autochtones.
Stratégie emploi et compétences jeunesse
La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative horizontale du gouvernement du Canada dirigée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et offerte en collaboration avec 11 autres ministères, organismes et sociétés d'État. La SECJ offre du soutien aux jeunes âgés de 15 à 30 ans pour les préparer à intégrer le marché du travail et à acquérir de l'expérience de travail dans des secteurs clés de l'économie. De 2023 à 2024, la SECJ a offert des services à plus de 105 000 jeunes, dont 93 000 qui ont reçu du soutien dans le cadre du programme SEJC et du programme Emplois d'été Canada d'EDSC. Les programmes offerts dans le cadre de la SECJ favorisent l'inclusivité. Par exemple, 14 % des participants au programme SECJ d'EDSC se sont identifiés comme de jeunes Autochtones, 39 % comme des jeunes issus de minorités visibles et 21 % comme des jeunes en situation de handicap.
La SECJ appuie également les jeunes récemment arrivés au pays en leur offrant des services comme de la formation et des stages professionnels. De 2023 à 2024, plus de 4 600 jeunes récemment arrivés au pays ont reçu du soutien.
Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat
La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat finance des initiatives qui accroissent l'accès des entreprises appartenant à des femmes au financement, aux réseaux et à l'expertise nécessaires pour que les entreprises démarrent, se développent et percent de nouveaux marchés. De 2023 à 2024, plus de 20 900 entrepreneures ont reçu de l'aide pour accéder aux réseaux, à la formation et au mentorat; 400 entrepreneures issues de communautés diversifiées ont reçu 10 millions de dollars en prêts; 2 200 entrepreneures ont bénéficié de fonds de capital de risque; et 28 900 femmes ont participé à des événements de réseautage parrainés.
Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones
Le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones (PFCEA) aide les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les Autochtones vivant en milieu urbain ou non affiliés à améliorer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs de carrière à long terme. De 2023 à 2024, le PFCEA a financé plus de 115 organismes de prestation de services autochtones pour offrir de la formation axée sur les compétences et l'emploi et d'autres mesures de soutien aux Autochtones. Ces organismes ont la souplesse nécessaire pour concevoir et offrir des programmes en fonction des besoins uniques de leurs collectivités. Plus de 54 000 participants autochtones ont suivi une formation et ont eu accès à d'autres mesures de soutien. Ainsi, plus de 19 000 Autochtones ont trouvé un emploi et plus de 6 500 sont retournés aux études pour bénéficier d'autres possibilités de formation et de perfectionnement. Le PFCEA contribue aux efforts du gouvernement fédéral visant à renouveler les partenariats avec les Autochtones et à faciliter la réconciliation.
Le Fonds pour les compétences et les partenariats, qui vient compléter le PFCEA, finance des projets qui soutiennent les partenariats entre les organismes autochtones et les employeurs afin de fournir aux Autochtones une formation axée sur les compétences pertinente pour les débouchés économiques aux échelons local, régional et national. De 2023 à 2024, une formation et d'autres soutiens ont été offerts à 1 773 Autochtones, dont près de 500 ont trouvé un emploi.
Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants
Le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants finance des organismes de services aux jeunes pour qu'ils offrent des mesures de soutien à ceux qui sont les plus susceptibles d'abandonner leurs études, de ne pas occuper d'emploi ou de ne pas suivre une formation. Il aide les jeunes à terminer leurs études secondaires, à faire la transition vers les études postsecondaires et à intégrer le marché du travail avec les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir.
Rapports sur les écarts salariaux et réglementation
En juin 2024, le Canada a adopté 2 ensembles de règlements à l'appui de la Loi sur l'équité salariale. Il s'agit notamment de règlements visant à encourager la conformité à la Loi et à faciliter son application par les cabinets des ministres.
En vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale comptant 100 employés ou plus doivent recueillir et déclarer des données cernant les lacunes en matière de rémunération et de représentation dans leur milieu de travail qui ont une incidence sur les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. En 2024, le site Web Equi'Vision a été lancé pour fournir des renseignements comparatifs en ligne sur les écarts salariaux des groupes désignés et les taux de représentation des employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale.
Soutenir l'emploi des femmes à l'échelle internationale
Le Canada appuie l'ODD 8 en concentrant ses efforts de développement international sur l'autonomisation économique des femmes, la croissance inclusive et la résilience économique. Ce soutien comprend la formation axée sur les compétences, l'entrepreneuriat, la finance inclusive et les possibilités d'emploi décent pour les femmes, les filles et les personnes les plus vulnérables dans les pays en développement.
Dans le cadre de son engagement de 100 millions de dollars visant à remédier aux inégalités liées à la prestation de soins rémunérée et non rémunérée dans les pays à revenu faible ou moyen, le Canada aide un plus grand nombre de femmes à chercher des possibilités d'emploi rémunéré et fait la promotion des conditions de travail décentes pour les soignantes, qui travaillent souvent dans le secteur non structuré et doivent composer avec des conditions de travail dangereuses et précaires.
Analyse statistique
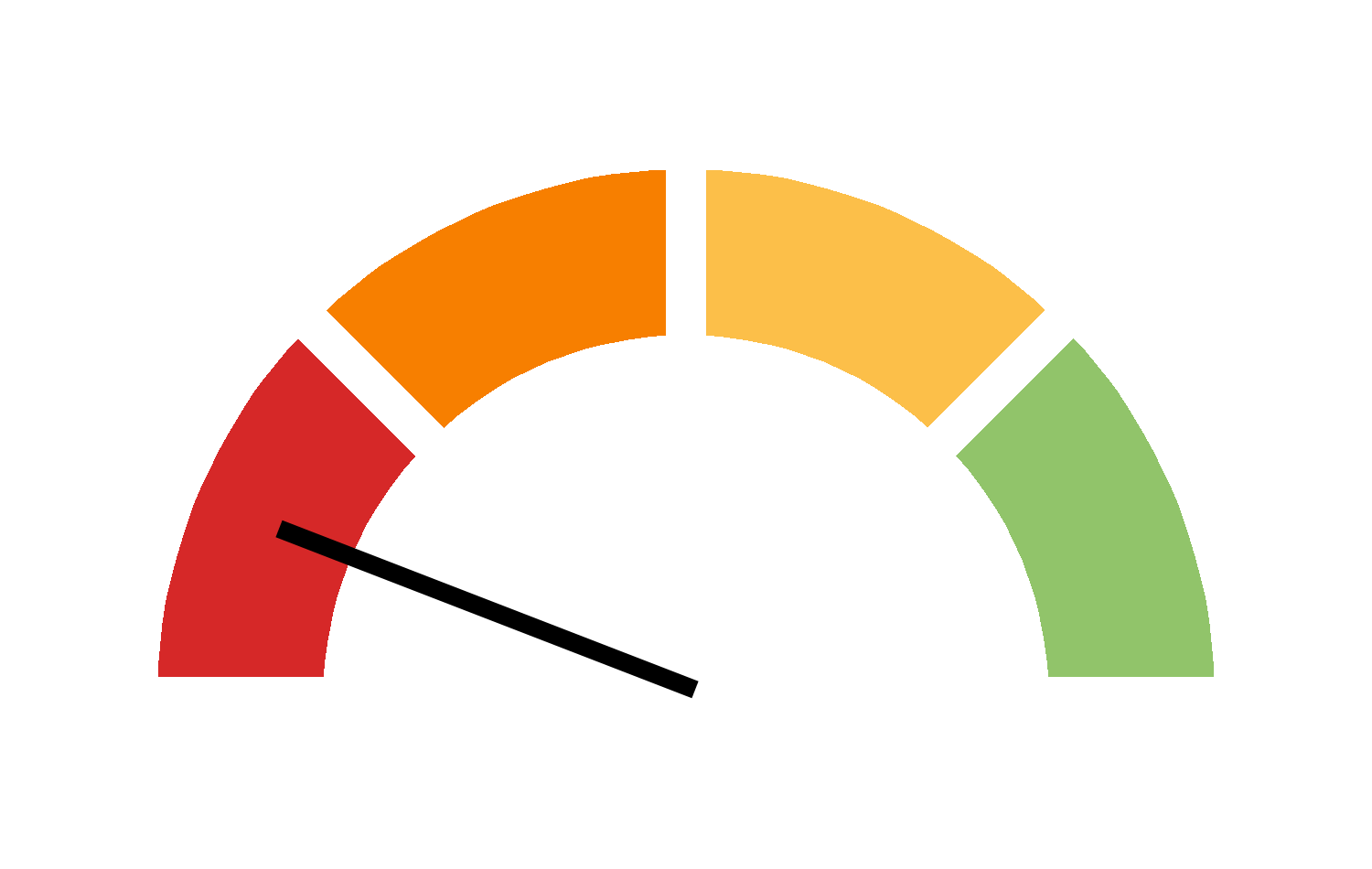
Indicateur national 8.2.1 : Taux d'emploi
Le taux d'emploi donne un aperçu de la vigueur du marché du travail et de l'économie en calculant le nombre de travailleurs, exprimé en proportion de la population âgée de 15 ans et plus.
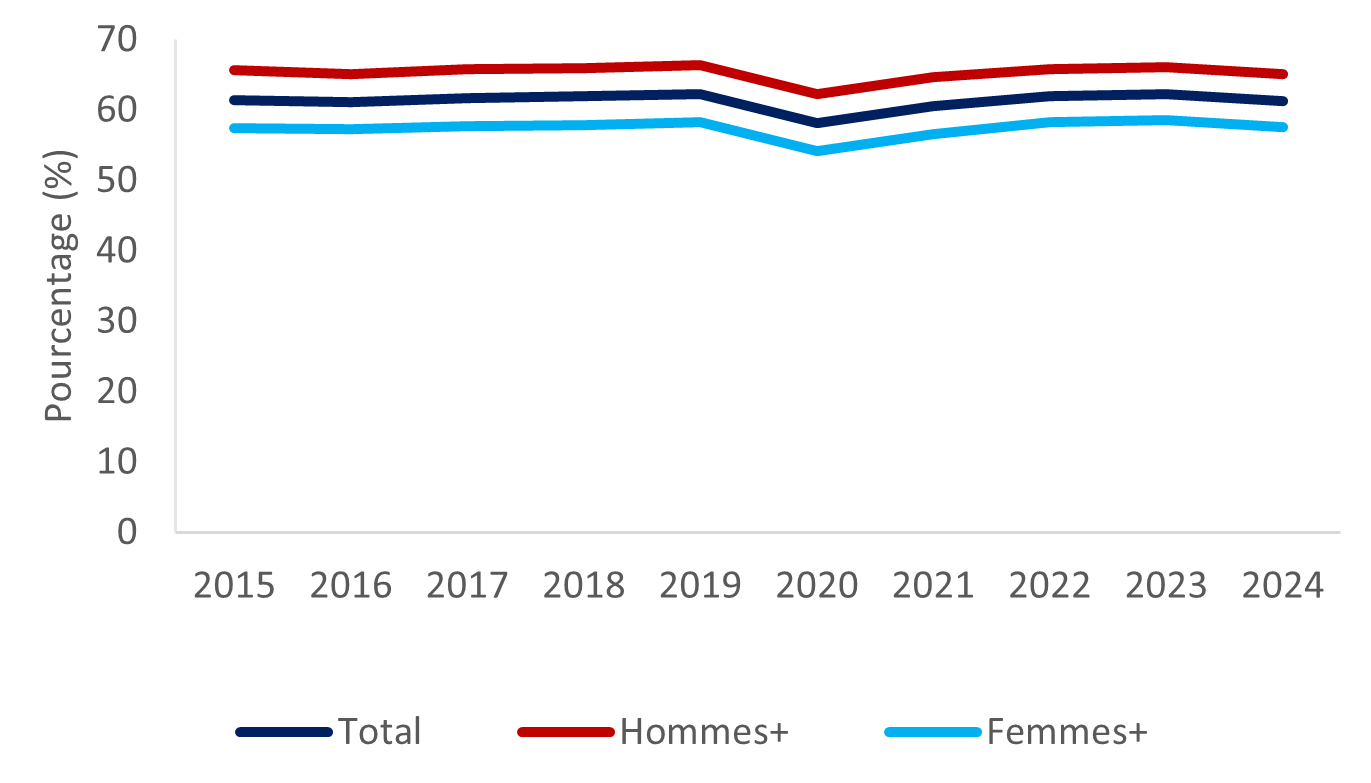
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active
Description textuelle de la figure 6
| Année | Total | Hommes+ | Femmes+ |
|---|---|---|---|
| 2015 | 61.4 | 65.6 | 57.4 |
| 2016 | 61.1 | 65.1 | 57.3 |
| 2017 | 61.7 | 65.8 | 57.7 |
| 2018 | 61.9 | 66 | 57.9 |
| 2019 | 62.3 | 66.3 | 58.3 |
| 2020 | 58.1 | 62.3 | 54.1 |
| 2021 | 60.5 | 64.6 | 56.6 |
| 2022 | 62 | 65.8 | 58.3 |
| 2023 | 62.2 | 66.1 | 58.5 |
| 2024 | 61.3 | 65.1 | 57.6 |
En 2024, le taux d'emploi au Canada a diminué, passant à 61,3 % alors qu'il était de 62,2 % en 2023, ce qui constitue la première baisse depuis 2020, lorsque le Canada subissait les répercussions économiques de la pandémie (figure 6). Alors que le nombre de travailleurs a augmenté de 395 700 (+ 1,9 %) entre 2023 et 2024, ces gains ont été devancés par une croissance démographique plus forte (+ 2,3 %) à compter du quatrième trimestre de 2023 à 2024Note de bas de page 30. Par conséquent, bien que la croissance démographique ait ralenti en 2024 par rapport à 2023 (3,1 %), surtout en raison du ralentissement important de l'augmentation du nombre de résidents non permanents, elle a continué d'excéder la croissance de l'emploi, ce qui a entraîné un taux d'emploi plus faibleNote de bas de page 31. Donc, le taux d'emploi en 2024 était inférieur à celui de 2015. Par conséquent, on constate une détérioration des progrès lorsqu'on les mesure par rapport à l'ambition connexe, selon laquelle les Canadiens ont accès à des emplois de qualité.
L'écart entre les taux d'emploi des femmes et des hommes a persisté en 2024, car le taux des femmes est passé de 58,5 % en 2023 à 57,6 % en 2024, tandis qu'il s'établissait à 65,1 % chez les hommes, en baisse par rapport à 66,1 % en 2023. Chez les femmes de 25 à 44 ans (+ 3,0 %), l'emploi a augmenté plus lentement que chez leurs homologues masculins (+ 4,3 %) de 2023 à 2024. Parallèlement, l'emploi chez les hommes (- 0,1 %) et les femmes (- 0,1 %) âgés de 45 à 64 ans a également diminué. Le taux d'emploi chez les Canadiens âgés de 15 à 24 ans est tombé à 54,8 % en 2024 par rapport à 58,0 % en 2023, soit la deuxième baisse consécutive. Il s'agit du taux le plus bas depuis 1999, sauf en 2020, lorsque le marché du travail au Canada subissait les répercussions de la pandémie.
Le taux d'emploi de la population autochtoneNote de bas de page 32,Note de bas de page 33 de 15 ans et plus vivant hors réserve a diminué, se situant à 57,1 % en 2024, contre 58,7 % en 2023. Bien qu'il s'agisse d'une deuxième baisse annuelle consécutive, après un sommet de 60,9 % en 2022, cela représente une augmentation par rapport au taux d'emploi de 54,9 % en 2015. Parmi les groupes autochtones, les Métis ont affiché un taux d'emploi plus faible en 2024 (60,7 %) qu'en 2023 (62,9 %). De même, le taux d'emploi chez les membres des Premières Nations est passé de 55,3 % en 2023 à 54,0 % en 2024.
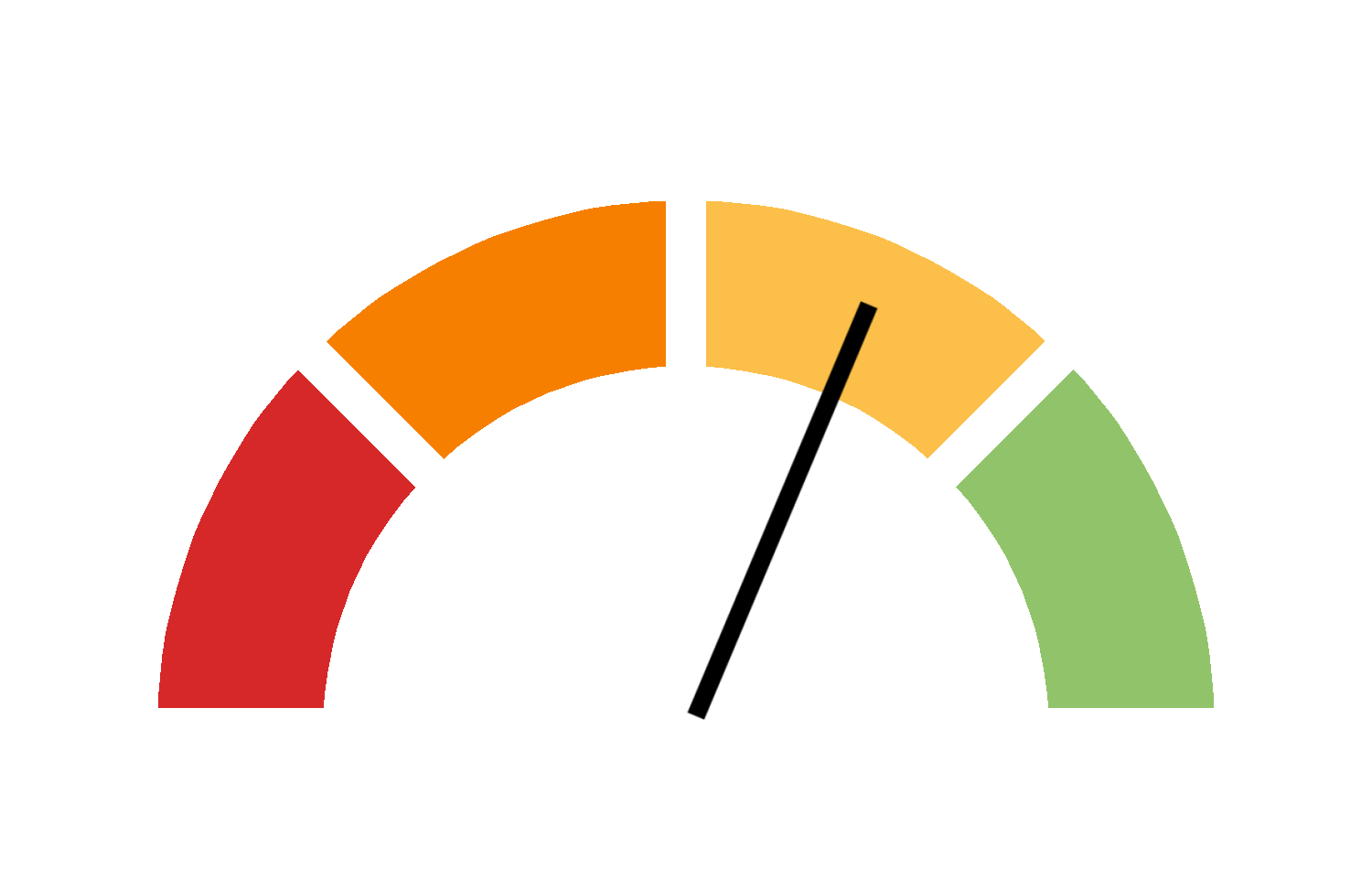
Indicateur national 8.3.1 : Proportion des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation
La proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET) est un indicateur utilisé à l'échelle mondiale pour déterminer comment les jeunes de 15 à 29 ans passent des études à un emploi, qui peut mettre en évidence les lacunes potentielles. Les lacunes dans la transition peuvent parfois résulter d'un choix, p. ex. prendre congé entre les études et le travail pour voyager ou fonder une famille et s'occuper de jeunes enfants. Toutefois, ces lacunes peuvent s'expliquer par d'autres motifs. Par exemple, lorsqu'ils éprouvent de la difficulté à intégrer la population active, les jeunes peuvent décider d'arrêter temporairement leur recherche d'emploi, ce qui fait hausser les taux NEET.
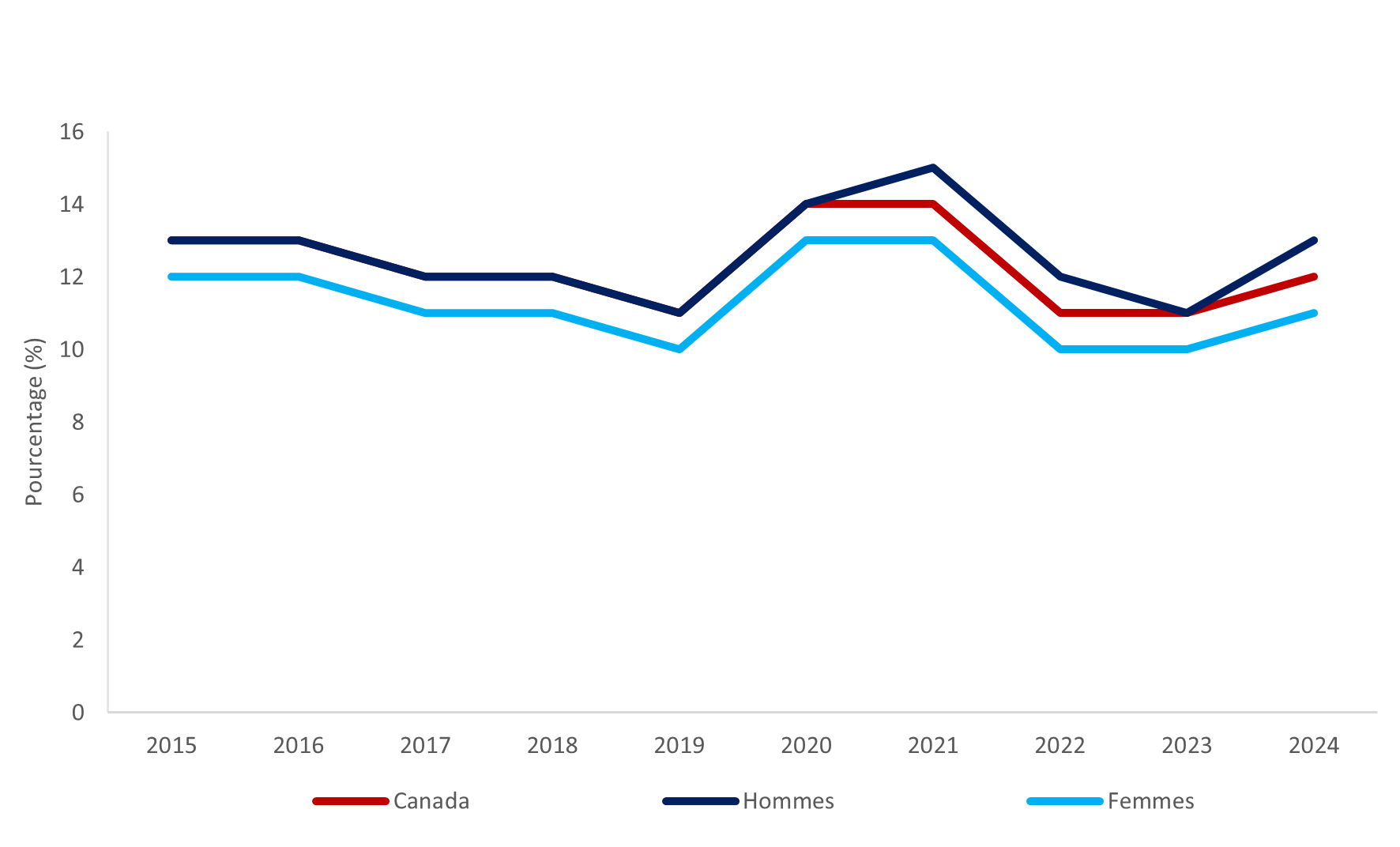
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active
Description textuelle de la figure 7
| Détail | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| Hommes | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 |
| Femmes | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 |
La proportion de jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation au Canada a augmenté, passant de 11 % en 2023 à 12 % en 2024 (figure 7). Des progrès ont été réalisés depuis 2015 (13 %), mais une accélération est nécessaire pour réaliser l'ambition selon laquelle les Canadiens ont accès à des emplois de qualité. Plusieurs événements récents ont contribué au mouvement des taux NEET. Plus particulièrement, les taux NEET ont grimpé à 14 % en 2020 et sont demeurés à ce niveau en 2021 alors que les jeunes ont dû composer avec la pandémie et ses répercussions socioéconomiques. Toutefois, il est tombé à 11 % en 2022, lorsque l'activité économique a repris et que les répercussions de la pandémie se sont atténuées. Récemment, les taux NEET ont augmenté à mesure que l'emploi chez les jeunes qui ne sont pas aux études a diminué.
Au Canada, les taux NEET étaient les plus faibles au Manitoba (10 %) et en Colombie‑Britannique (10 %) en 2024. À l'autre bout du spectre, les jeunes du Nunavut ont affiché le taux NEET le plus élevé, soit 38 % en 2024, contre 34 % en 2023. Venaient ensuite les Territoires du Nord-Ouest (17 %) qui ont déclaré le deuxième taux NEET en importance à l'échelle nationale. L'Alberta (14 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (14 %) ont affiché les taux NEET les plus élevés parmi les provinces en 2024.
Une proportion constamment plus élevée d'hommes que de femmes n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation, ce qui a donné lieu à des taux NEET comparativement plus élevés chez les hommes entre 2015 et 2024. Le taux NEET chez les femmes est passé de 10 % en 2023 à 11 % en 2024. Malgré cette augmentation, le taux NEET chez les femmes demeure inférieur de 2 points de pourcentage à celui des hommes, qui était de 13 % en 2024 contre 11 % l'année précédente.
Il n'est pas surprenant que depuis 2015, les jeunes Canadiens âgés de 15 à 19 ans ont constamment enregistré le taux NEET le plus faible, soit 6 % entre 2022 et 2024. Par ailleurs, les jeunes de 25 à 29 ans affichaient le taux NEET le plus élevé, qui est passé de 13 % en 2023 à 15 % en 2024. Ces différences mettent en lumière les défis auxquels se heurtent les jeunes dans leur transition vers le marché du travail.
Articles de fond
Ouvrir des perspectives pour les jeunes
La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative fédérale visant à aider les jeunes Canadiens à acquérir des compétences et de l'expérience de travail. Les programmes de la SECJ, comme Emplois d'été Canada et le Programme de stages en sciences et technologie, ont ouvert des perspectives pour des personnes comme Sarah Crowe et Janelle Flett.
Pour Sarah Crowe, le programme Emplois d'été Canada (EEC) a constitué une étape importante de son parcours professionnel. Tout en poursuivant ses études en création de textiles et de vêtements, Sarah a obtenu un emploi d'été à Quidi Vidi Village Artisan Studios dans le cadre du programme EEC.
Cette occasion lui a permis de travailler aux côtés d'artisans expérimentés, d'acquérir une expérience pratique et de tisser de précieux liens dans l'industrie artisanale. « Mon emploi d'été aux Artisan Studios m'a permis de nouer des liens et d'acquérir l'expérience dont j'avais besoin pour présenter une demande pour mon propre studio et démarrer mon entreprise après avoir obtenu mon diplôme », explique Sarah. Aujourd'hui, en tant que fondatrice de Sarah Crowe Designs, elle reconnaît que son expérience dans le cadre d'EEC lui a permis d'établir les bases nécessaires pour transformer sa passion en une entreprise fructueuse.
Janelle Flett, membre de l'Athabasca Chipewyan First Nation, a toujours été profondément attachée à l'environnement. Ayant grandi près des chantiers d'exploitation des sables bitumineux en Alberta, elle a appris à mieux connaître la production d'énergie dans la région et ses répercussions. Ses expériences ont instillé en elle un désir d'explorer des solutions de rechange durables. « Je voulais trouver de meilleures solutions pour la production d'énergie », précise Janelle.
Son parcours pour changer les choses a commencé lorsqu'elle s'est jointe à la cohorte d'Indigenous Clean Energy de Generation Power, qui l'a aiguillée vers le programme de stages en sciences et technologie du Barkley Project Group, une société-conseil en énergie propre travaillant avec les collectivités des Premières Nations en Colombie-Britannique et au Yukon.
Afin d'encourager d'autres jeunes Canadiens à envisager des possibilités semblables, Janelle a insisté sur la souplesse et les avantages du programme : « Je dirais certainement à d'autres jeunes Canadiens de saisir l'occasion de présenter une demande au Programme de stages en sciences et technologie - il y a tellement de domaines et d'options. »
Janelle, qui envisage de travailler dans le domaine de l'énergie propre, est déterminée à utiliser ses compétences et ses connaissances pour aider les collectivités autochtones et le Canada à faire la transition vers des solutions énergétiques plus durables.
En offrant aux jeunes des expériences de travail enrichissantes dans les secteurs à forte demande, les programmes de la SECJ forment une main-d'œuvre outillée pour relever les défis de l'avenir, une possibilité à la fois.
Habiliter les jeunes à surmonter les obstacles systémiques à la réussite professionnelle
Les jeunes vivant dans des collectivités à faible revenu au Canada ont souvent un accès limité à des mentors et à des réseaux pour favoriser leur avancement professionnel. Ces obstacles peuvent faire en sorte qu'il est moins probable qu'ils terminent leurs études secondaires et poursuivent des études postsecondaires ou suivent une formation, ce qui renforce encore plus leur situation de désavantage économique.
Passeport pour ma réussite a pour objectif de briser le cycle de la pauvreté grâce à l'éducation. Il soutient les jeunes issus de collectivités à faible revenu en leur permettant d'acquérir les aptitudes et les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un diplôme d'études secondaires et faire la transition vers les études postsecondaires, une formation ou un emploi valorisant. Dans les 31 collectivités canadiennes bénéficiant des services de Passeport pour ma réussite, les jeunes participent régulièrement à des programmes structurés conçus pour les informer de nouveaux cheminements de carrière et les aider à acquérir des compétences pratiques en préparation à la carrière.
Un exemple est la semaine annuelle des carrières de Passeport Spryfield, organisée par Danielle Truen, coordonnatrice des études postsecondaires et du perfectionnement professionnel. La semaine des carrières permet aux étudiants d'explorer différents secteurs auxquels ils n'ont habituellement pas accès, par exemple l'astrophysique, la pharmacologie, le cinéma et l'informatique, et de prendre contact avec des professionnels d'organisations comme la municipalité régionale d'Halifax, Santé Nouvelle-Écosse et la Gendarmerie royale du Canada.
Les étudiants ont aussi l'occasion d'échanger avec des professionnels pour en apprendre plus sur leur travail quotidien et les différents parcours qu'ils ont empruntés pour accéder à leur poste actuel. « Je voulais montrer aux étudiants que 2 personnes ne suivront pas le même parcours, même si leur destination peut être presque identique », mentionne Danielle.
À la suite de l'événement, les étudiants ont fait savoir que l'expérience leur avait permis d'ouvrir des perspectives et d'entrevoir différentes possibilités. « C'est tellement important de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas de problème si leur cheminement ne correspond pas au parcours structuré typique. On peut changer de voie plusieurs fois pour trouver quelque chose qu'on aime », ajoute Danielle.
Bien que ces activités aient aidé les étudiants à découvrir de nouvelles possibilités de carrière, bon nombre d'entre eux qui vivent dans des collectivités à faible revenu doivent surmonter des obstacles multidimensionnels lorsqu'ils souhaitent poursuivre des études postsecondaires. De nombreux étudiants n'ont pas les ressources financières nécessaires pour poursuivre des études supérieures ni le réseau professionnel voulu pour bâtir du capital social. Pour relever ces défis complexes, Danielle a également créé une trousse d'outils complète pour aider les élèves du secondaire à acquérir des compétences pratiques pour réussir, comme l'élaboration d'un budget ou la rédaction de demandes de bourse qui seront retenues. De plus, les étudiants reçoivent un soutien financier par l'entremise du programme Passeport, comme l'accès aux bourses d'études postsecondaires ou à une formation.
En aidant les étudiants à explorer leur potentiel et en leur offrant le soutien pratique dont ils ont besoin pour le réaliser, le programme Passeport offre aux jeunes les moyens de surmonter les obstacles et des outils pour assurer leur réussite à long terme et leur indépendance économique.
Faire le lien entre inclusivité, emploi et durabilité
Reena, un organisme sans but lucratif, a lancé une initiative visant à créer des possibilités d'emploi intéressantes pour des personnes aux capacités diverses. Cette initiative, nommée à juste titre GReena, vise à rendre la mobilisation en faveur de l'environnement plus inclusive et accessible et offre une bouée de sauvetage aux participants pour qu'ils définissent un but à atteindre, conservent leur dignité et acquièrent de la confiance en eux grâce à un travail valorisant.
En 2024, l'organisme a collaboré avec l'entreprise sociale Growcer pour lancer une ferme hydroponique verticale accessible produisant des légumes casher. Ce projet novateur combinait l'agriculture durable et l'inclusivité, offrant aux participants une expérience pratique en agriculture et une formation pour les emplois verts.
La conception accessible de l'initiative comprenait des postes de travail ajustables et des parcours sans obstacle afin d'assurer la pleine participation des personnes à mobilité réduite. Les participants ont acquis des compétences essentielles, de la confiance et de l'autonomie grâce à un travail thérapeutique qui a favorisé leur bien-être physique et mental. L'amélioration de la sécurité alimentaire locale, la réduction de l'impact environnemental et la création de voies prometteuses pour la croissance économique locale ont contribué à la résilience des collectivités.
Les initiatives agricoles de GReena ont été élargies grâce à la collaboration avec des organismes communautaires, dont la Learning Enrichment Foundation, le carrefour communautaire Oakwood Vaughan et la bibliothèque de ressources Bathurst-Clark. Il en a résulté un projet de recyclage dans la région de York, qui a permis d'améliorer les pratiques locales de gestion des déchets. Les partenariats ont favorisé une vision commune qui a incité les groupes communautaires à promouvoir l'intendance environnementale, tout en créant des emplois verts pour les personnes aux capacités diverses.
Rob et Fred, les gestionnaires de GReena, ont souligné la transformation qu'ils ont constatée chez les participants, remarquant leur confiance et leur indépendance accrues grâce à un travail thérapeutique de renforcement des compétences. Un participant, JB, a déclaré : « [...] cela me fait sentir indépendant ». Sophie, membre de la collectivité participant au projet, a souligné à quel point la culture de légumes a renforcé sa confiance et ses compétences.
GReena crée un environnement positif où les personnes se sentent valorisées et connectées, tout en contribuant à la durabilité et à la sécurité alimentaire. Il y a eu des défis, comme la conception d'un modèle agricole entièrement accessible et le maintien de l'engagement communautaire et du soutien des ressources. Pour surmonter les obstacles, GReena a formé des partenariats stratégiques pour promouvoir le partage des ressources, l'échange des connaissances et la participation de la collectivité afin de créer un solide réseau de soutien de l'initiative.
GReena démontre que l'inclusivité, l'emploi et la durabilité peuvent aller de pair. Cette initiative montre comment les initiatives locales contribuent aux objectifs mondiaux en combinant développement durable et action communautaire. En autonomisant les personnes, en renforçant la résilience communautaire et en montrant comment intégrer l'intendance environnementale à un travail valorisant, GReena ouvre la voie à un avenir plus inclusif et durable.
Promouvoir le dialogue social dans l'ensemble du secteur agroalimentaire
Tant à l'échelle nationale qu'internationale, 2024 a marqué une étape historique dans la promotion du dialogue social au sein du secteur agroalimentaire. En mai 2024, l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada) a convoqué le premier forum des partenaires sociaux sur le travail décent dans l'industrie agroalimentaire de l'Amérique du Nord. Cet événement marquant a réuni des intervenants clés, qui ont échangé des idées et des pratiques exemplaires et élaboré conjointement un plan d'action pour renforcer l'une des industries les plus importantes du Canada : le système de production alimentaire.
Le forum a mis l'accent sur un programme de croissance économique fondé sur les engagements du Canada à l'égard des normes internationales du travail fondamentales, y compris la ratification des conventions clés et la promotion d'autres éléments essentiels du travail décent. Cette initiative, qui favorise un dialogue constructif entre les partenaires sociaux, marque une étape importante vers des résultats durables, inclusifs et équitables dans l'ensemble du contexte agroalimentaire canadien.
Des représentants des syndicats, de l'industrie et du gouvernement se sont réunis à Toronto pour une séance d'une journée entière afin de discuter des nouvelles lignes directrices sur le travail décent dans l'industrie agroalimentaire. Les lignes directrices découlent d'un mandat que l'ONU a confié à l'Organisation internationale du travail et qui consiste à diriger les efforts mondiaux et sectoriels afin de promouvoir le travail décent.
TUAC Canada a joué un rôle central dans ce processus en tant que membre du groupe mondial des travailleurs de l'alimentation et a participé aux négociations conjointement avec les employeurs et les représentants gouvernementaux. Dans le cadre d'un processus tripartite rigoureux, les parties ont dégagé un consensus sur les lignes directrices, marquant une réussite significative dans la promotion du travail décent dans le contexte agroalimentaire mondial.
Les participants au forum sur le travail décent ont entendu directement des travailleurs migrants, dont certains ont survécu à des stratagèmes de trafic de main-d'œuvre. Ces travailleurs vulnérables, qui ne peuvent pas parler la langue et qui dépendent de leur employeur pour tout, des repas au logement en passant par le transport, ont raconté leur histoire héroïque, eux qui ont mis au jour la violence et les mauvais traitements qui touchent les travailleurs dans les coulisses des programmes de travailleurs temporaires du Canada.
Les participants ont été émus par les histoires personnelles mettant l'accent sur les victoires remportées, la protection accordée et la bonne volonté démontrée par les membres des réseaux de soutien, qui travaillent sans relâche pour que les travailleurs soient protégés et que ceux qui ont commis des actes répréhensibles en soient tenus responsables.
Le forum sur le travail décent a permis de souligner le rôle essentiel du dialogue social entre les intervenants du milieu des affaires, du gouvernement et des syndicats pour faire progresser la mise en œuvre des lignes directrices sur le travail décent en tant que stratégie fondamentale pour atteindre l'objectif de développement durable 8 dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire du Canada.
Le succès du forum a clairement démontré la forte volonté des partenaires sociaux d'aborder en collaboration aux enjeux les plus pressants auxquels le secteur est confronté. Toutefois, le forum a également permis de soulever d'importantes questions à propos du manque d'occasions officielles de discuter de ces questions au Canada, plus particulièrement si on le compare à d'autres pays très industrialisés.
Pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable du Programme 2030, il faut en faire davantage pour établir et officialiser des forums tripartites au Canada. Ces plateformes sont essentielles pour faire progresser le travail décent et accomplir des progrès tangibles à l'égard de tous les objectifs de développement durable.
Mise en œuvre de la norme pour les milieux de travail psychologiquement sains
L'Association canadienne de normalisation, qui exerce ses activités sous le nom Groupe CSA, a élaboré une norme clé, la norme CAN/CSA Z1003-13/BNQ 9700-803/2013 (C2022), qui vise à favoriser la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail.
La norme volontaire, connue sous le nom de CSA Z1003, énonce les exigences relatives au système de gestion permettant de prévenir les préjudices, de promouvoir la santé et de régler les incidents. Elle vise à réduire le stress en milieu de travail et à aider les organismes à créer des environnements de travail plus sains, plus sécuritaires et plus accueillants.
La norme définit 13 facteurs clés en milieu de travail, tels que la culture organisationnelle, la gestion de la charge de travail et la protection psychologique contre la violence, l'intimidation et le harcèlement, qui influent sur la sécurité psychologique et contribuent à la santé générale.
Une récente étude de cas menée par le Groupe CSA et le Groupe Delphi, qui devrait être publiée au printemps 2025, a révélé que les organismes qui adoptent la norme CSA Z1003 ont signalé une amélioration de l'engagement et du moral des employés et une réduction de l'absentéisme. Par exemple, les employés d'une organisation ont mentionné qu'ils avaient moins souffert d'épuisement professionnel et de maladies liées au stress.
La norme CSA Z1003 établit les exigences relatives à la participation inclusive et significative des employés. Elle favorise la participation des travailleurs de tous les horizons à la prise de décisions. Elle favorise aussi un environnement de travail positif et une formation en santé mentale pour les dirigeants. À mesure que les problèmes de santé mentale évoluent, le Groupe CSA prévoit de mettre à jour la norme afin d'examiner et d'aborder les nouveaux enjeux et thèmes, comme la diversité et l'inclusion.
En fournissant des conseils sur les milieux de travail inclusifs et sécuritaires, la norme CSA Z1003 favorise la responsabilisation et la transparence, encourage la protection des droits du travail, améliore le maintien en poste, le moral et l'engagement des employés et démontre que la priorisation et la promotion de la santé des travailleurs rendent l'effectif plus productif.
En harmonisant les initiatives de santé en milieu de travail avec les objectifs et les cibles des objectifs de développement durable, la norme CSA Z1003 aide à créer des milieux de travail résilients et durables qui engendrent des répercussions positives à long terme pour les entreprises, les employés et la société.
Ouvrir des perspectives : possibilités meilleures et plus nombreuses pour les travailleuses domestiques au Pérou
En 2021, le Canada a engagé 100 millions de dollars pour financer les soins rémunérés et non rémunérés dans les pays à revenu faible ou moyen. Plusieurs projets ont depuis été mis en œuvre, dont celui appelé Ouvrir des perspectives, au Pérou.
Mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail, le projet vise à améliorer concrètement la vie de 1 500 travailleuses domestiques au Pérou en veillant à ce que les politiques nationales répondent mieux à leurs besoins et protègent leurs droits. Le projet contribue à améliorer des programmes, comme la loi sur les travailleurs domestiques et le système national de soins, et favorise la collaboration avec les syndicats et les associations de femmes pour autonomiser les travailleuses domestiques.
En 2024, dans le cadre du projet, un atelier de formation des formateurs s'est tenu à 3 endroits. Il a ainsi été possible de former 88 dirigeantes de divers organismes sur la lutte contre la violence fondée sur le sexe, la santé mentale et la négociation avec les employeurs. Ces dirigeantes ont ensuite formé plus de 700 travailleuses affiliées dans 9 régions.
La formation a renseigné les travailleuses domestiques sur leurs prestations sociales, les déductions connexes et la façon de calculer l'impôt sur le revenu. Flor Angélica Masa, une dirigeante de la Fédération nationale des travailleuses domestiques de Trujillo, a affirmé avoir vécu une excellente expérience d'apprentissage lors de l'atelier. « Je l'ai trouvé très intéressant. Ce que j'ai appris me sera très utile, car je pourrai calculer les versements (d'impôts et de cotisations) que je dois faire et guider les membres de mon syndicat. » Elle a ajouté qu'elle pourra transmettre ses connaissances à d'autres travailleuses domestiques qui ne sont peut‑être pas au courant des prestations.
Des projets comme Ouvrir des perspectives pour les travailleuses domestiques au Pérou sont essentiels à la protection des droits des travailleurs et à la promotion d'environnements de travail sécuritaires.
Objectif de développement durable 14 : Vie aquatique
Contexte stratégique
L'ambition du Canada à l'égard de cet objectif est de protéger et de conserver les écosystèmes marins, d'assurer des pêches durables, de réduire la pollution, de protéger les populations de baleines à risque et de renforcer la conservation des océans à l'échelle mondiale.
Zones de protection marine et mesures de conservation
Le Canada continue de travailler à l'établissement de nouvelles zones de protection marine (ZPM) et d'autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), qui sont essentielles à la protection de la biodiversité et à la conservation des habitats essentiels. Ces zones protégées favorisent la conservation des espèces et des habitats sensibles et le rétablissement des écosystèmes, et elles contribuent à la résilience des écosystèmes marins relativement à diverses menaces, comme la surpêche, la destruction des habitats, la pollution et les changements climatiques. De plus, le Canada s'emploie à rétablir et à protéger les écosystèmes marins en réduisant le bruit sous-marin; en protégeant les populations de baleines à risque au moyen de mesures de gestion des navires; en appliquant la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux; et en dirigeant les efforts visant à réduire les espèces envahissantes provenant de l'encrassement biologique des navires.
Activités de planification et de conservation des menées en collaboration
Le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements et les collectivités autochtones ainsi que les groupes industriels et environnementaux pour promouvoir les activités efficaces de planification et de conservation des océans. Par exemple, le Canada travaille avec des organismes autochtones pour orienter les efforts de conservation dans le cadre du Programme de contribution pour la gestion des océans et du modèle de financement de projets pour la permanence afin de protéger les écosystèmes marins uniques et fragiles. Grâce à la collaboration avec les partenaires et les gardiens du savoir autochtones, une expertise importante est mise à profit pour améliorer l'efficacité des mécanismes de conservation (comme les ZPM et les AMCEZ) afin qu'ils s'harmonisent avec les pratiques et la gouvernance autochtones.
Un autre exemple de partenariat est le travail entre la Première Nation Mamalilikulla, Pêches et Océans Canada et la Colombie-Britannique dans le but de protéger un écosystème marin unique et fragile dans la baie Knight, en Colombie-Britannique. Le refuge marin récemment établi, Gwa̲xdlala/Nala̲xdlala (Lull/Hoeya), est une zone de protection et de conservation autochtone qui protégera les espèces rares dans la baie ainsi que sa riche biodiversité et son importance culturelle. Pour en savoir plus sur la façon dont les partenaires collaborent pour protéger la région, visitez la page Web Collaboration pour la protection de l'océan.
Le Canada optimise la planification spatiale marine comme moyen d'orienter l'exploitation durable de nos océans. Ces processus collaboratifs peuvent aider le Canada à mieux comprendre et coordonner où, quand et comment exploiter et gérer les océans et leurs ressources, et à atteindre des objectifs écologiques, économiques, sociaux et culturels.
Pour s'assurer que les principaux stocks de poissons sont gérés et pêchés de façon durable, le gouvernement fédéral définit et met en œuvre des points de référence limites et des règles de contrôle des prises pour maintenir les stocks à des niveaux sains. Il s'emploie également à intégrer d'autres stocks de poissons importants aux dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches pour assurer une gestion durable et élaborer des plans pour rétablir les stocks épuisés.
Recherche et surveillance
Le gouvernement fédéral mène des activités de recherche scientifique et de surveillance pour mieux comprendre les écosystèmes aquatiques et établir une solide base de données probantes pour la prise de décisions. Au moyen de processus de recherche et de consultation scientifiques, des données sont recueillies sur les stocks de poissons, les habitats aquatiques et les répercussions des facteurs de stress sur les espèces et les environnements marins. Ces connaissances sont essentielles pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des pêches, fixer des quotas de pêche durables, prévenir la surpêche et atteindre les objectifs de conservation.
De plus, les activités de surveillance, comme la collecte de données sur des variables écosystémiques, l'évaluation des stocks et la surveillance des prises accessoires, fournissent des renseignements utiles pour prendre des décisions éclairées et modifier les pratiques de pêche afin de maintenir les stocks à un niveau sain et d'appuyer les objectifs de conservation marine.
Accords internationaux et collaboration
Le gouvernement fédéral appuie activement les accords internationaux visant à protéger les océans et la biodiversité, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique pour l'exploitation et la conservation des océans, et l'Accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la compétence nationale.
Le Canada est également membre de l'Organisation maritime internationale, au sein de laquelle il dirige l'élaboration de directives internationales sur l'assainissement dans l'eau de l'encrassement biologique des navires et des directives révisées visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine (disponible en anglais seulement).
Il s'est engagé dans divers partenariats et initiatives multilatéraux et bilatéraux, dont le Groupe de haut niveau pour une économie océanique durable et l'Alliance mondiale pour les océans. Il contribue à la conservation des milieux marins régionaux et mondiaux en partageant son expérience, son expertise et ses recherches scientifiques avec d'autres membres de la coalition des Amériques pour la protection de l'océan et du Groupe de travail sur la protection de l'environnement marin de l'Arctique du Conseil de l'Arctique.
Le gouvernement fédéral s'engage également à réduire la pollution marine en favorisant, entre autres, les économies circulaires et en intensifiant les efforts de recyclage. Par exemple, en tant que signataire de la Charte sur les plastiques dans les océans du G7, le Canada s'est engagé à s'attaquer au problème croissant des plastiques dans les océans.
Analyse statistique
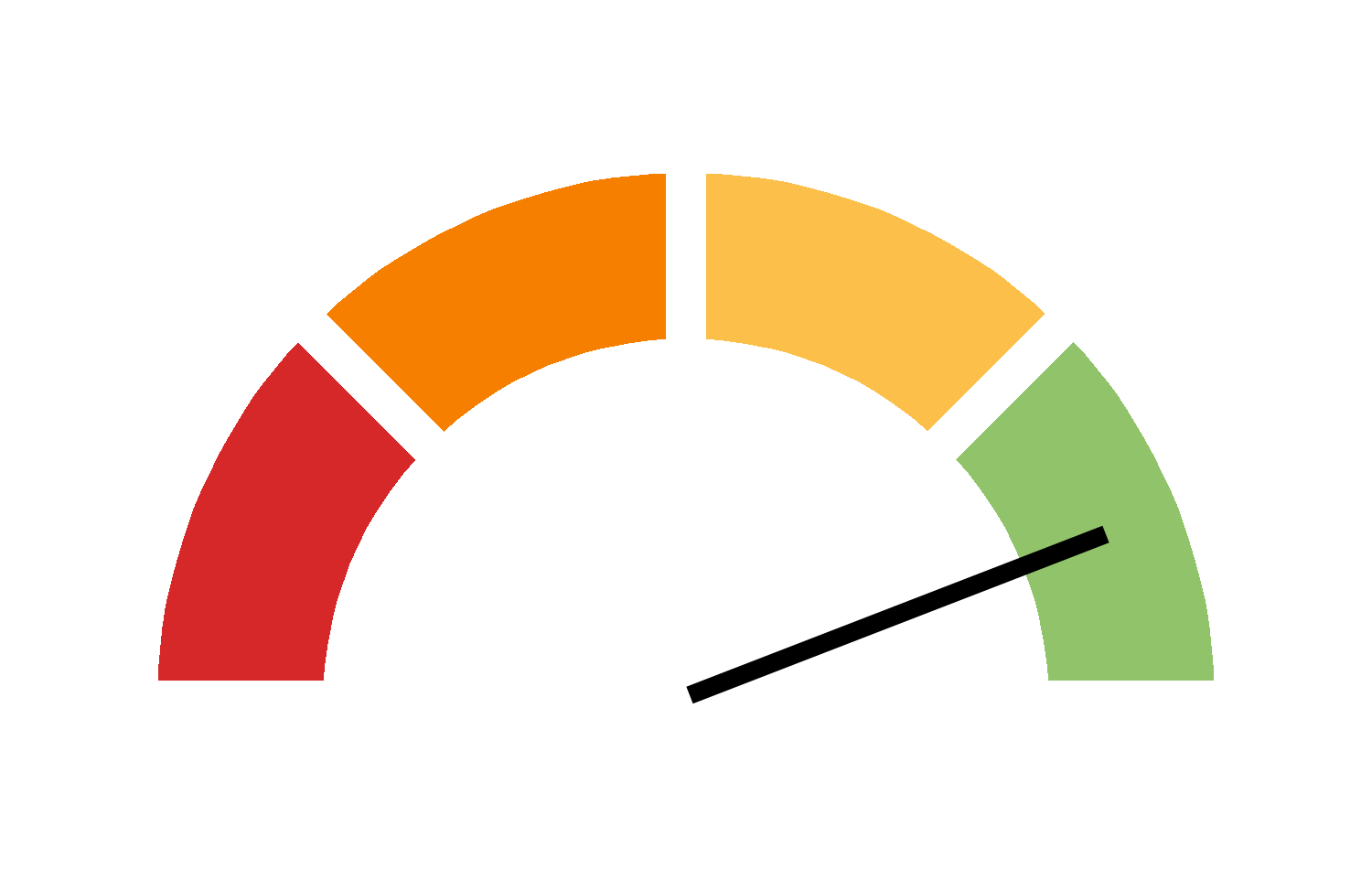
Indicateur national 14.1.1 : Proportion d'aires marines et côtières conservées
Les aires de conservation préservent la biodiversité pour les générations présentes et futures en réduisant les pressions exercées par les activités humaines, tout en offrant aux gens des occasions de se rapprocher de la natureNote de bas de page 34. La proportion d'aires marines et côtières de conservation représentait 14,7 % du territoire marin du Canada ou 842 849 km2 en 2023, une augmentation d'environ 22 km2 par rapport à 2022 (figure 8). Cela démontre que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la cible, c.-à-d. l'engagement mondial de conserver 30 % des aires marines et côtières du Canada d'ici 2030.
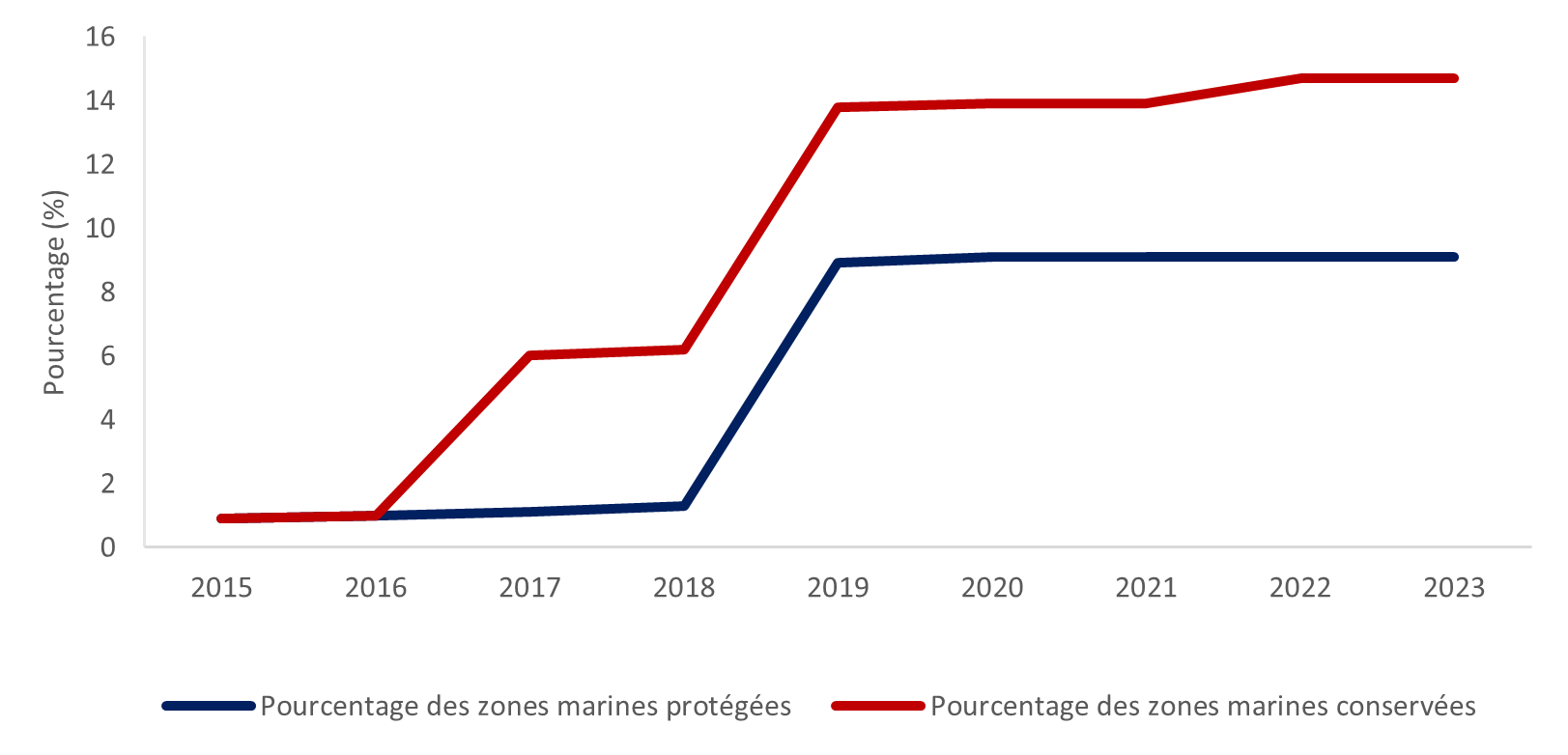
Source : Programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement, Aires conservées au Canada
Description textuelle de la figure 8
| Année | Pourcentage des zones marines protégées | Pourcentage des zones marines conservées |
|---|---|---|
| 2015 | 0.9 | 0.9 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2017 | 1.1 | 6 |
| 2018 | 1.3 | 6.2 |
| 2019 | 8.9 | 13.8 |
| 2020 | 9.1 | 13.9 |
| 2021 | 9.1 | 13.9 |
| 2022 | 9.1 | 14.7 |
| 2023 | 9.1 | 14.7 |
Les aires de conservation sont classées en 2 catégories. Représentant 9,1 % du territoire marin du Canada en 2023, les zones protégées comprennent les parcs nationaux, provinciaux ou territoriaux, les zones protégées autochtones, les refuges d'oiseaux migrateurs et les zones de protection marine.
Parallèlement, d'autres mesures de conservation efficaces visent le reste des zones, qui représentaient 5,6 % du territoire marin du Canada en 2023. Ces zones sont gérées de manière à préserver la biodiversité à long terme; toutefois, elles ne répondent pas nécessairement à la définition officielle de zone protégée. Elles peuvent comprendre les territoires et les bassins hydrologiques autochtones ou les zones de gestion des ressources.
Il y a des aires marines de conservation partout au pays. Les plus grandes sont cependant situées surtout au large des côtes et dans le nord du Canada, où l'exploitation humaine est peu fréquente. La zone de protection marine de Tuvaijuittuq est la plus grande zone de conservation, représentant 5,55 % de la zone marine totale du Canada. Cette zone totalisant 319 411 km2 désignée en 2019 a représenté la plus grande part de l'augmentation observée entre 2018 et 2019. Située au large de l'île d'Ellesmere au Nunavut, dans l'océan Arctique, cette zone est considérée comme unique en raison de la présence de banquises pluriannuelles et contient la glace marine la plus ancienne et la plus épaisse de l'océan ArctiqueNote de bas de page 35.
De 2019 à 2023, la proportion de la superficie de zones marines de conservation s'est accrue de 48 301 km2 (6,1 %). La zone de conservation des canyons de l'est a été ajoutée en 2022, ce qui explique en grande partie cette augmentation de près de 44 000 km2. Située dans la biorégion du plateau néo-écossais et de la baie de Fundy, au large de la Nouvelle-Écosse, cette zone a été conservée pour protéger les récifs coralliens d'eau froide et la zone frontalière d'eau profonde. Par exemple, la région contient le seul récif corallien Lophelia pertusa vivant connu dans les eaux atlantiques du Canada. Plus récemment, soit en 2023, le refuge marin Gwa̲xdlala/Nala̲xdlala (Lull/Hoeya) a été ajouté pour aider à conserver ses formations de coraux et d'éponges de seuils peu profonds, ses estuaires, ses herbiers de zostère et sa forêt de varech. Situé dans la biorégion du plateau Nord en Colombie-Britannique, ce refuge marin occupe une superficie totale de 21,4 km2 et était à l'origine de l'augmentation observée entre 2022 et 2023.
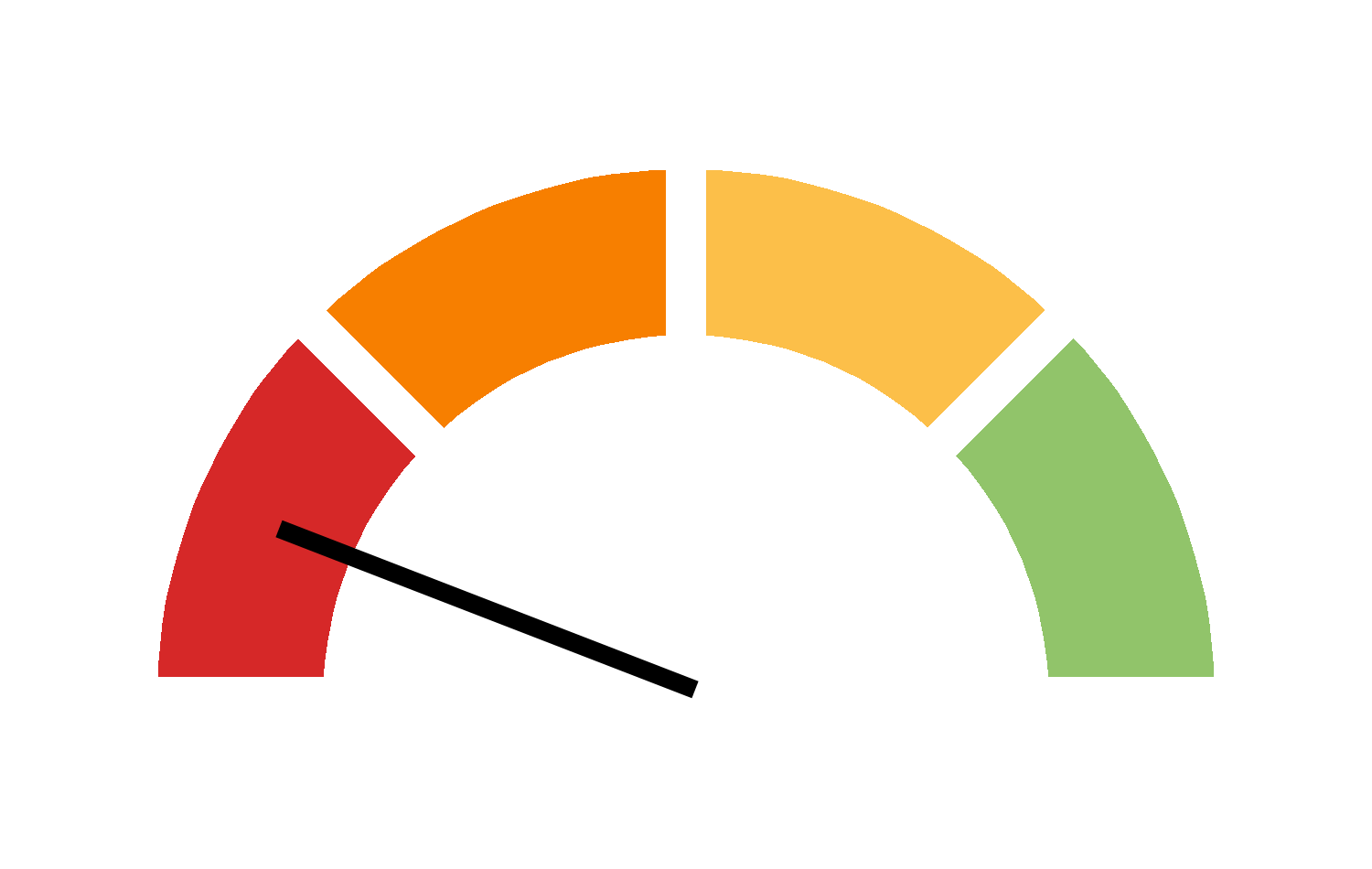
Indicateur national 14.2.1 : Proportion des principaux stocks de poissons qui se trouvent dans la zone de prudence et la zone saine
La santé globale et l'abondance des stocks de poissons sont influencées par les conditions environnementales et les activités humaines d'utilisation des océans, comme la pêcheNote de bas de page 36. Par conséquent, il est essentiel d'évaluer la santé et l'état des stocks de poissons et d'en faire le suivi pour les préserver pour les générations futures. Pour ce faire, les stocks de poissons sont évalués et un état (sain, prudent, critique ou incertain) est attribué après avoir comparé leur taille aux niveaux de référence. Les mesures de gestion sont ensuite modifiées au besoin en prenant des initiatives comme l'imposition de taux et de limites de prise pour assurer leur santé continue. Ces mesures visent au total 195 stocks de poissons principaux qui ont été sélectionnés en raison de leur importance pour la culture, l'économie ou l'environnement.
En 2022, la proportion des principaux stocks de poissons qui se trouvent dans la zone de prudence et la zone saine a diminué, s'établissant à 46 % par rapport à 48 % en 2021 (figure 9). Cette tendance à la baisse montre une détérioration des progrès vers la cible de 2026, qui prévoit qu'au moins 55 % des principaux stocks de poissons du Canada doivent se situer dans la zone de prudence et la zone saine.
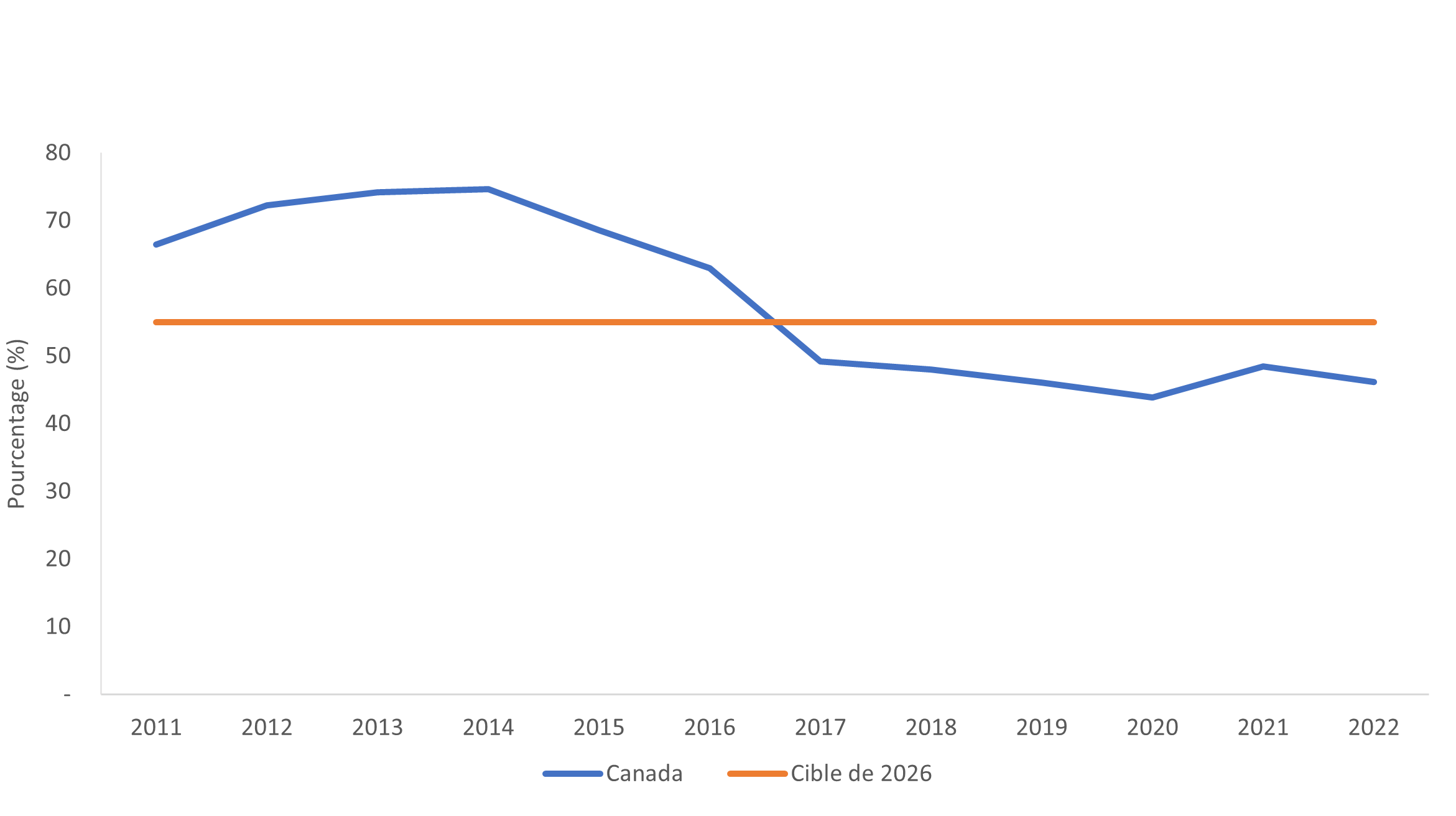
Source : Programme d'Indicateurs canadien de durabilité de l'environnement, État des principaux stocks de poissons
Description textuelle de la figure 9
| Année | Canada | Cible de 2026 |
|---|---|---|
| 2011 | 66.5 | 55 |
| 2012 | 72.3 | 55 |
| 2013 | 74.2 | 55 |
| 2014 | 74.7 | 55 |
| 2015 | 68.6 | 55 |
| 2016 | 62.9 | 55 |
| 2017 | 49.2 | 55 |
| 2018 | 48.0 | 55 |
| 2019 | 46.0 | 55 |
| 2020 | 43.9 | 55 |
| 2021 | 48.4 | 55 |
| 2022 | 46.2 | 55 |
Parmi les régions, la proportion de principaux stocks de poissons dans la zone de prudence et la zone saine était la plus élevée dans le Pacifique (65 %) en 2022, une baisse par rapport à 68 % en 2021. Dans l'Atlantique, 43 % des principaux stocks de poissons se trouvaient dans la zone de prudence et la zone saine en 2022, en baisse par rapport à 45 % l'année précédente. La région de l'Atlantique a également enregistré la proportion la plus élevée de principaux stocks de poissons dans un état critique en 2022 (15 %). L'Arctique affichait la proportion la plus faible de principaux stocks de poissons dans la zone de prudence ou la zone saine en 2022 (14 %). Toutefois, aucun stock de poisson principal ne se trouvait dans un état critique et il y avait une proportion comparativement plus élevée de stocks dont l'état était incertain (86 %), ce qui s'explique en grande partie par les données insuffisantes.
La santé des principaux stocks de poissons varie d'un groupe d'espèces à l'autre. Les crustacés, qui comprennent les espèces comme le crabe, le homard et la crevette, représentent le plus grand groupe d'espèces évalué et leur proportion de stocks est la plus élevée dans la zone de prudence et la zone saine (62 %). Les stocks de poissons de fond (par exemple la morue de l'Atlantique et le sébaste aux yeux jaunes) représentaient le deuxième peuplement en importance, et un peu moins de la moitié (49 %) de ses stocks se trouvait dans la zone saine ou la zone de prudence en 2022. Le principal groupe d'espèces de poissons ayant la plus faible proportion de stocks dans la zone de prudence et la zone saine en 2022 était les mammifères marins (12 %), qui comprennent des espèces comme le morse de l'Atlantique, le béluga et le narval. Étant donné que les principaux stocks de mammifères marins se trouvent principalement en Arctique, ce peuplement comptait une plus grande proportion de stocks dont l'état était incertain en raison des enquêtes halieutiques moins fréquentes et des difficultés d'évaluation connexes attribuables à la faible disponibilité des données.
Articles de fond
Intendance générationnelle : une zone de protection marine primée
La communauté Kitasoo Xai'xais de Klemtu se trouve du côté est de l'île Swindle, dans la forêt pluviale de Great Bear, à environ 500 km au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique. Lorsque le hareng fraie sous la lune printanière, la Nation Kitasoo Xai'xais célèbre la nouvelle année avec sa première prise à Gitdisdzu Lugyeks, dans la baie de Kitasu. Gitdisdzu Lugyeks est un lieu d'importance culturelle et écologique pour son peuple. La fraie du hareng, comme la montaison du saumon, attire une vie abondante dans la baie et d'autres eaux littorales, fournissant une alimentation indispensable au peuple Kitasoo Xai'xais, aux autres communautés côtières et à une grande diversité d'espèces après un long hiver.
En juin 2022, la Nation Kitasoo Xai'xais a déclaré que Gitdisdzu Lugyeks était une zone de protection marine (ZPM) (disponible en anglais seulement) en vertu de ses lois et de sa compétence, qui sont confirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En 2023, la Nation a publié un plan de gestion assorti de stratégies pour préserver le patrimoine culturel et écologique de la région et assurer la sécurité alimentaire.
Milas' (Santana Edgar), coordonnatrice de la planification maritime pour la Kitasoo Xai'xais Stewardship Authority, s'emploie à protéger les terres du territoire, les eaux et le patrimoine culturel dont ses ancêtres s'occupent depuis des décennies. Milas' explique l'importance de la région en ces termes : « Il y a beaucoup d'endroits sur notre territoire traditionnel que nous estimons grandement en tant que lieux occupés par les générations passées; ce sont des lieux où nous pouvons recueillir tout ce dont nous avons besoin comme de la nourriture, des herbes médicinales et des matériaux de construction. » Elle décrit la baie comme « une zone utilisée et prise en charge par notre Nation depuis des millénaires », où les aliments traditionnels sont encore récoltés et où les enfants viennent pour apprendre, entendre des histoires et voir les pratiques culturelles. Ces visites leur permettent d'entrer en contact avec la terre et l'eau, ce qui favorise la liberté et la joie.
Milas' poursuit les efforts de protection marine entrepris par ses grands-parents dans les années 1970. Elle estime que son rôle fait partie d'un extraordinaire héritage d'intendance générationnelle qui « a contribué énormément au fil des ans à protéger et à préserver tout ce que nous avons maintenant, afin que nous aussi puissions faire pour nos générations futures ce que nos grands-parents ont fait pour nous ».
La ZPM Gitdisdzu Lugyeks de 33,5 km2 a été désignée en vertu d'une loi autochtone en 2022, mais la baie fait également partie d'une réserve d'aire marine nationale de conservation (RAMNC) proposée sur la côte centrale, une importante collaboration régionale entre les nations Kitasoo Xai'xais, Gitga'at, Gitxaala, Heiltsuk, Nuxalk et Wuikinuxv, la province de la Colombie-Britannique et le Canada. La RAMNC devrait couvrir une superficie d'environ 7 800 km2, ce qui contribuera à l'objectif du Canada de protéger 30 % de ses zones marines d'ici 2030.
En 2024, la ZPM Gitdisdzu Lugyeks a reçu le prestigieux Blue Park Award dans le cadre de la conférence Our Ocean en Grèce. C'est la première ZPM canadienne et la première ZPM dirigée par des Autochtones à obtenir cette reconnaissance, puisqu'elle répond à des normes internationales rigoureuses de conservation marine.
Le processus de désignation officielle de la RAMNC sur la côte centrale en est maintenant aux dernières étapes, ce qui aidera à protéger ses eaux riches pour les enfants de Milas' et les générations futures.
L'eau, c'est la vie : la perspective des Métis
L'eau sous toutes ses formes est sacrée pour la Nation métisse. Lorsqu'elle tombe sous forme de neige, elle recouvre la terre et lui permet de se reposer avant de renflouer les rivières, les milieux humides et les lacs au printemps. La neige et la glace sont importantes pour le piégeage, la récolte, la pêche et l'accès à des terres inaccessibles à d'autres périodes de l'année.
Lorsque la neige fond et que la pluie commence à tomber, l'eau s'enfonce dans le sol pour nourrir les plantes et les herbes médicinales, elle remplit les milieux humides et les ruisseaux pour que les poissons fraient et que les grenouilles et les tortues se réveillent au printemps. L'eau de ruissellement et des ruisseaux se déverse dans les rivières en route vers les lacs et les océans. L'été et l'automne sont importants pour les voyages le long des rivières et des lacs, pour la pêche, la vie végétale et les habitats de nidification des oiseaux, qui sont tous essentiels pour le mode de vie des Métis.
L'eau, c'est la vie, elle traverse toute la vie, reliant l'air à la terre. L'eau a trait à tous les objectifs de développement durable. Il est important de reconnaître la relation sacrée des femmes avec l'eau et leur rôle de leadership dans la prise en charge de l'eau. L'eau est d'importance cruciale pour la santé, l'industrie et le développement économique et est essentielle à la durabilité et à l'adaptation aux changements climatiques. C'est un droit humain et elle relie toutes les personnes au-delà des frontières.
Les Métis qui vivent à proximité de la terre et de l'eau sont parmi les premiers à remarquer des changements, comme l'impact des espèces envahissantes, la modification des populations de poissons, de plantes et d'amphibiens, les répercussions de la pollution causée par les produits chimiques et pharmaceutiques, les plastiques et les engrais ainsi que les changements dans les niveaux d'eau et l'écoulement de l'eau.
La Nation métisse protège l'eau en surveillant sa qualité, la santé des poissons et les espèces envahissantes. Elle intervient dans des politiques liées à l'eau au niveau des bassins hydrographiques ainsi qu'aux échelons provincial, national et international. La Nation métisse participe à la création de l'Agence de l'eau du Canada et à la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada. Le Ralliement national des Métis (RNM) veille à ce que l'eau et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soient prises en compte dans les conventions internationales, notamment la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention de Ramsar. De plus, le RNM participe à la Conférence des Nations Unies sur l'eau et aux négociations en vue d'un nouvel instrument international pour combattre la pollution par les plastiques et contribue aux objectifs de développement durable.
Pour la Nation métisse, l'eau est la vie; si vous en prenez soin, tout le reste suivra. Que ce soit les nuages et la pluie, la neige et la glace, les milieux humides, les rivières et les lacs ou les océans, nous devons tous nous préoccuper de l'eau. Non pas comme une ressource ni comme quelque chose que nous utilisons puis oublions, mais comme une relation, un patrimoine ancestral et la vie elle-même.
Stratégie de développement durable et Stratégie de l'eau du Québec
La Stratégie de développement durable du gouvernement du Québec vise à intégrer les principes de développement durable dans tous les mécanismes d'intervention publics, tels que les lois, les politiques et les programmes gouvernementaux, afin qu'ils contribuent à la transition vers un Québec plus prospère, plus écologique et plus responsable. La Stratégie est conforme aux ententes conclues par le gouvernement du Québec, les Premières Nations et les Inuit et respecte les obligations du gouvernement du Québec en matière d'affaires autochtones. Elle constitue la réponse officielle du gouvernement du Québec au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.
La reddition de compte à l'égard de la Stratégie est régie par la loi et s'effectue par la publication de rapports d'étape périodiques sur les mesures prises par les ministères et les organismes pour atteindre les objectifs. L'obligation de rendre compte des progrès a récemment été étendue à tous les ministères et organismes publics.
La Stratégie s'appuie sur la mise en œuvre du Plan nature 2030, du Plan national de l'eau, du Fonds bleu et d'autres initiatives qui représentent des contributions majeures à la politique gouvernementale en matière de développement durable.
Le Plan nature 2030 est la politique-cadre pour la conservation de la biodiversité au Québec. Il vise à atteindre la plupart des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, adopté lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en décembre 2022. Le Plan nature, qui est conforme aux ambitions internationales, comprend des objectifs stratégiques couvrant un large éventail de domaines, tels que les aires protégées, la restauration des écosystèmes, la protection des espèces menacées ou vulnérables, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, l'utilisation durable des ressources biologiques et la prise en compte des questions de biodiversité dans les activités économiques.
Le Plan national de l'eau, qui fait partie intégrante de la Stratégie québécoise de l'eau, vise à soutenir la mise en œuvre des mesures de protection, de restauration, d'amélioration et de gestion des ressources en eau. Il est financé par le Fonds bleu qui, à son tour, est financé en partie par les redevances sur l'eau. Cela assure un financement adéquat et fiable pour le Plan national de l'eau. Les mesures soutenues par ce financement contribuent à une utilisation durable, équitable et efficace des ressources en eau et à une meilleure conservation des écosystèmes aquatiques.
L'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent annoncé récemment par les gouvernements du Québec et du Canada n'est qu'une des plus récentes réalisations dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'eau. Parmi les autres réalisations, mentionnons une augmentation des prélèvements d'eau, une meilleure réglementation des pesticides et une sensibilisation accrue du public aux enjeux liés à l'eau.
Protéger les océans grâce à l'innovation des jeunes
Praneet Arora, qui a grandi en Inde, a vu de ses propres yeux l'impact dévastateur de la pollution par les plastiques sur les voies navigables et les collectivités locales. Lorsqu'il a déménagé au Canada à l'âge de 8 ans, il a commencé à espérer qu'un avenir plus propre et plus durable était réalisable.
À 15 ans, Praneet s'est joint au programme Jeunesse pour l'océan d'Ocean Wise, une initiative axée sur les jeunes qui autonomise les participants en vue de protéger et de conserver les océans du monde. Durant le programme, Praneet a pris connaissance de l'impact des débris de plastique sur les écosystèmes marins et d'une initiative néerlandaise appelée Precious Plastic (disponible en anglais seulement). L'idée de transformer les rebuts en trésors reconvertis a suscité chez lui un grand intérêt. Grâce à une subvention d'Ocean Wise, il a développé un prototype de déchiqueteuse de plastique pouvant désagréger les déchets collectés en granules réutilisables.
Même si les premières étapes du projet ont été accompagnées de difficultés, notamment des contraintes de temps, Praneet n'a pas abandonné.
Durant son année de congé, de 2023 à 2024, il a relancé l'initiative avec un intérêt renouvelé. « Nous travaillons actuellement à financer notre première extrudeuse, un injecteur et un four à compression, ce qui nous permettra de bâtir des économies entièrement circulaires dans les pays en développement », explique-t-il. Ces systèmes de recyclage, conçus pour être installés à l'intérieur des conteneurs, visent à transformer la collecte des déchets dans les régions côtières.
Selon Praneet, ces systèmes sont une façon d'améliorer à la fois l'environnement et les moyens de subsistance. Chaque année, l'équivalent de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est rejeté dans les océans, les rivières et les lacs du monde, perturbant les écosystèmes et menaçant les moyens de subsistance de millions de personnesNote de bas de page 37. « Nous voulons mettre l'accent sur les régions côtières à forte concentration de plastique et leur offrir une indemnisation pour la collecte des plastiques, transformer la cueillette de déchets en une entreprise organisée, éliminer les intermédiaires et améliorer l'existence des résidents locaux, tout en améliorant la vie subaquatique », précise-t-il.
Praneet, qui étudie aujourd'hui à l'Université Minerva, élargit le projet grâce à des partenariats avec le Sustainability Collective de l'Université Minerva et Ocean Wise. Son objectif est d'amener d'autres pays à mettre en œuvre l'initiative d'ici 5 ans.
Ce qui a commencé comme un projet à l'école secondaire est maintenant une initiative mondiale, ce qui démontre la puissance des innovations dirigées par les jeunes pour favoriser le changement durable. La solution de Praneet à la pollution des océans (ODD 14) contribue également à la concrétisation de l'objectif portant sur les possibilités d'emploi décent (ODD 8). Elle montre comment une seule action peut créer une vague de changement pour améliorer les vies et protéger la planète.
Objectif de développement durable 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Contexte stratégique
Les Canadiens savent que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. L'ODD 17 consiste à nouer des partenariats pour atteindre des objectifs communs. En établissant des liens solides et en prenant des mesures concrètes ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus durable et inclusif où personne n'est laissé pour compte.
Promouvoir le développement durable grâce aux partenariats locaux
Le Programme de financement des ODD sensibilise les gens, soutient les partenariats nouveaux et existants et finance des projets qui font progresser les ODD. Dans le cadre du programme, divers partenaires nationaux reçoivent des fonds pour financer leur travail, y compris les organismes sans but lucratif, les provinces et territoires, les municipalités, les universités, le secteur privé, les Autochtones, les femmes, les jeunes, les groupes en quête d'équité et les personnes vulnérables. Cela comprend également le financement de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis afin de prendre en compte les voix, les points de vue et le savoir traditionnel des Autochtones dans les travaux du Canada visant à faire progresser les ODD. En 2018, 59,8 millions de dollars au total sur 13 ans ont été affectés au Programme de financement des objectifs de développement durable, ce qui équivaut à près de 4,6 millions par année.
À ce jour, le gouvernement du Canada a financé plus de 160 projets à l'échelle nationale. En 2023, 14 projets ont appuyé des mesures visant à combattre la discrimination, à inclure les perspectives autochtones et à promouvoir l'urbanisme durable, le logement, l'éducation inclusive et l'engagement des jeunes et des collectivités. En 2024, 30 nouveaux projets ont porté sur des thèmes clés comme la sensibilisation aux ODD, l'action climatique, le renforcement communautaire, la mobilisation des jeunes et la réconciliation avec les Autochtones. Par exemple, Cuso International dirige un projet visant à accroître la sensibilisation et la mobilisation de jeunes Inuit dans le Nord à l'égard des ODD. En encourageant le dialogue communautaire, en soulignant le rôle des gardiens de la terre dans le soutien aux ODD et en accroissant la sensibilisation, ce projet facilite les contributions de jeunes Autochtones au Programme 2030.
Mobilisation et partenariats à l'échelle mondiale et nationale
Au cours de la dernière année, le gouvernement fédéral a mobilisé des intervenants et des partenaires pour échanger de l'information sur les ODD, établir des réseaux solides et favoriser l'établissement de liens précieux. Le Canada a également participé à des événements clés comme Together | Ensemble, la conférence nationale consacrée au suivi des progrès réalisés à l'égard des 17 ODD, qui a réuni 175 délégués en personne et 600 délégués en ligne.
Sur la scène internationale, le Canada a été à l'avant-garde des discussions sur le financement du développement à l'ONU au cours de la dernière décennie. Depuis 2016, le Canada et la Jamaïque participent activement à la coprésidence du Groupe des amis du financement des ODD de l'ONU, une plateforme précieuse pour des discussions opportunes, notamment un dialogue entre les dirigeants des banques multilatérales de développement et les États membres de l'ONU en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2024. Plus récemment, le renforcement de la collaboration entre l'ONU et les institutions financières internationales a été une priorité clé de la présidence canadienne du Conseil économique et social des Nations Unies, notamment avec la visite du Bureau de l'ECOSOC et de 13 États membres de l'ONU à Washington, D.C., afin de dialoguer directement avec les conseils d'administration du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Également, en 2024, le Canada a participé au Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies, où il a pris part à des discussions sur le Programme 2030 et les ODD avec des organismes des Nations Unies et d'autres pays et a organisé un événement parallèle officiel sur l'économie des soins.
Le Canada établit des partenariats pour améliorer l'égalité entre les sexes à l'échelle mondiale, reconnaissant que le développement durable n'est pas atteignable à moins d'éliminer les obstacles systémiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles. En privilégiant les partenariats dans des domaines comme la santé, l'éducation et les possibilités économiques, le Canada veille à placer les femmes et les filles au cœur de ses efforts en matière d'aide internationale en faisant la promotion de leurs droits et en renforçant leur rôle d'agentes de changement dans leurs collectivités.
Un exemple de ce partenariat est le Fonds égalité, un consortium d'organismes canadiens et internationaux qui sont profondément ancrés dans les associations et les mouvements de femmes et qui y sont associés. Ces organismes ont combiné leurs expériences pour créer la première plateforme mondiale où les partenaires peuvent réunir des ressources pour créer des occasions de combler les écarts entre les sexes et d'éliminer les obstacles à l'égalité entre les sexes.
De plus, en 2024, le Canada a coprésidé l'Alliance pour les mouvements féministes dans le but d'accroître le financement et le soutien offerts aux mouvements féministes à l'échelle mondiale grâce à la mobilisation multipartite.
Analyse statistique
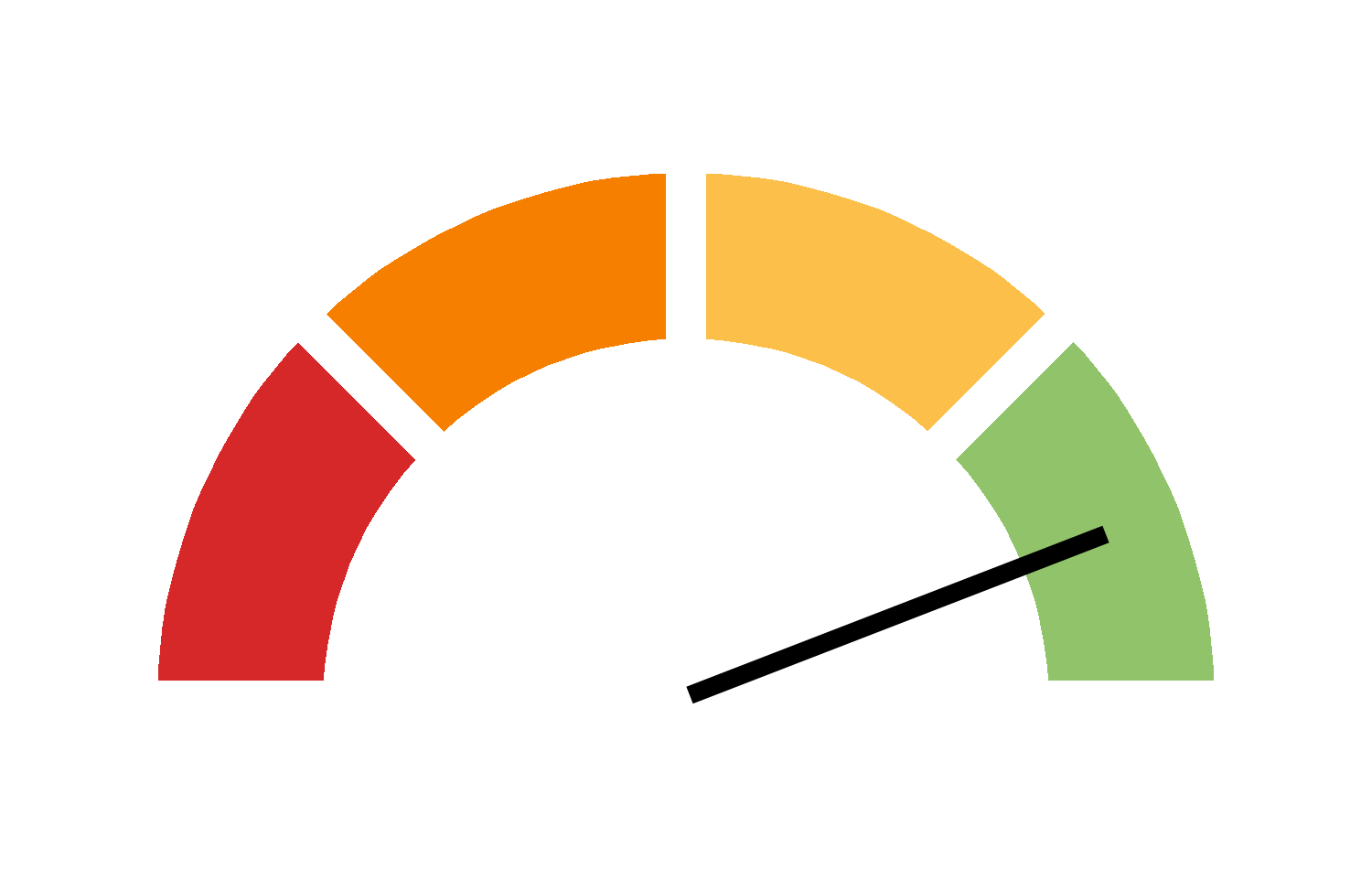
Indicateur national 17.2.1 : Soutien public total au développement durable
L'évaluation du soutien public total au développement durable (SPTDD) est essentielle pour surveiller les flux de ressources à l'appui du développement durable vers les pays en développement. Plus précisément, le SPTDD mesure les flux monétaires qui contribuent directement à l'avancement d'au moins une cible des objectifs de développement durable (ODD), tout en évitant les effets néfastes sur les autres. Il comprend les flux provenant de sources officielles ainsi que les ressources privées mobilisées au moyen des voies officielles.
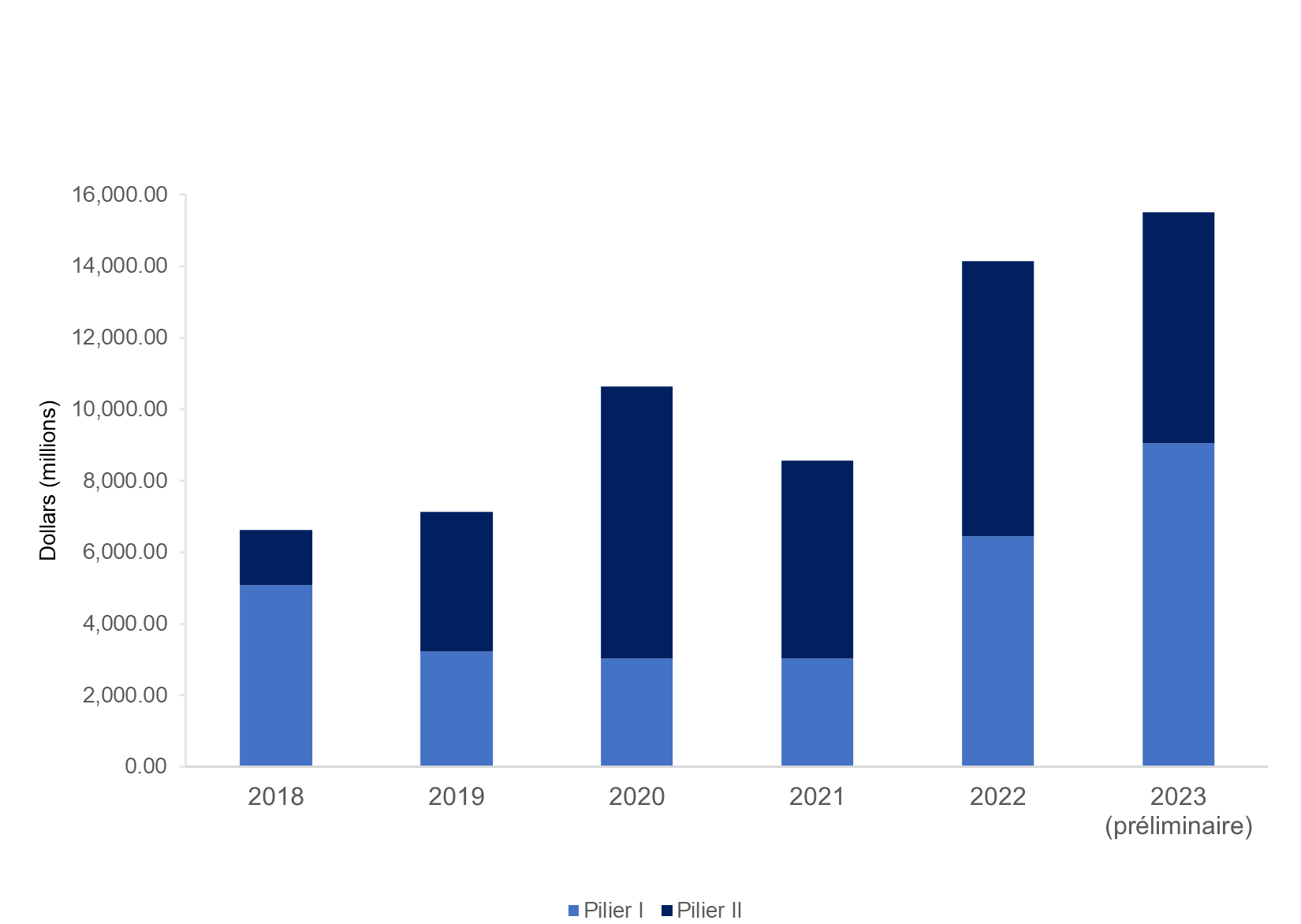
Source : Affaires mondiales Canada
Description textuelle de la figure 10
| Détail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (préliminaire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pilier I |
5,076.52 | 3,231.59 | 3,033.29 | 3,031.34 | 6,438.71 | 9,054.53 |
| Pilier II | 1,550.03 | 3,898.31 | 7,612.26 | 5,537.24 | 7,703.80 | 6,459.55 |
| Total du SPTDD | 6,626.55 | 7,129.90 | 10,645.55 | 8,568.57 | 14,142.51 | 15,514.09 |
Selon les données préliminaires, le SPTDD du Canada a totalisé 15,514 milliards de dollars en 2023, contre 14,143 milliards en 2022 (figure 10). Ce soutien a augmenté substantiellement par rapport aux 6,627 milliards de dollars accordés en 2018, lorsque la mesure du SPTDD est devenue disponible, et il fait état de progrès dans la réalisation de l'ambition selon laquelle le Canada doit favoriser la collaboration et les partenariats pour faire progresser les ODD.
Le soutien public au développement durable se compose de 2 types de flux de ressources qui sont classés sous 2 piliers. Le pilier I, qui comprend les flux transfrontaliers bilatéraux vers les pays admissibles au SPTDD, a totalisé 9,055 milliards de dollars en 2023, représentant 58 % du SPTDD du Canada. Le pilier II, totalisant 6,460 milliards de dollars en 2023 et correspondant au solde du SPTDD du Canada, mesure les dépenses mondiales et régionales au titre des biens publics internationaux. Ces fonds sont octroyés à des fournisseurs multilatéraux, comme les organismes des Nations Unies, puis sont affectés aux pays en développement pour soutenir les efforts mondiaux.
Le soutien à l'Europe, parmi les régions bénéficiaires, représente la plus grande proportion du soutien public total du Canada au développement durable. Les fonds destinés à l'Europe ont totalisé près de 2,891 milliards de dollars en 2023, soit une légère baisse par rapport aux 3,045 milliards en 2022. Ces fonds représentent la plus grande proportion pour la deuxième année consécutive et découlent du soutien accordé à l'Ukraine pour l'aider à répondre à ses besoins urgents et soutenir sa stabilité économique.
Parallèlement, le SPTDD versé à l'Afrique, le deuxième bénéficiaire en importance (15 %), a totalisé près de 2,260 milliards de dollars en 2023, soit la deuxième baisse annuelle consécutive par rapport au sommet de 2,765 milliards en 2021. Le soutien accordé à l'Afrique a augmenté considérablement en 2021, lorsque le Canada a consacré des fonds supplémentaires en réponse à la pandémie pour améliorer la disponibilité des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics dans les pays dans le besoin; ces fonds ont depuis cessé d'être versés.
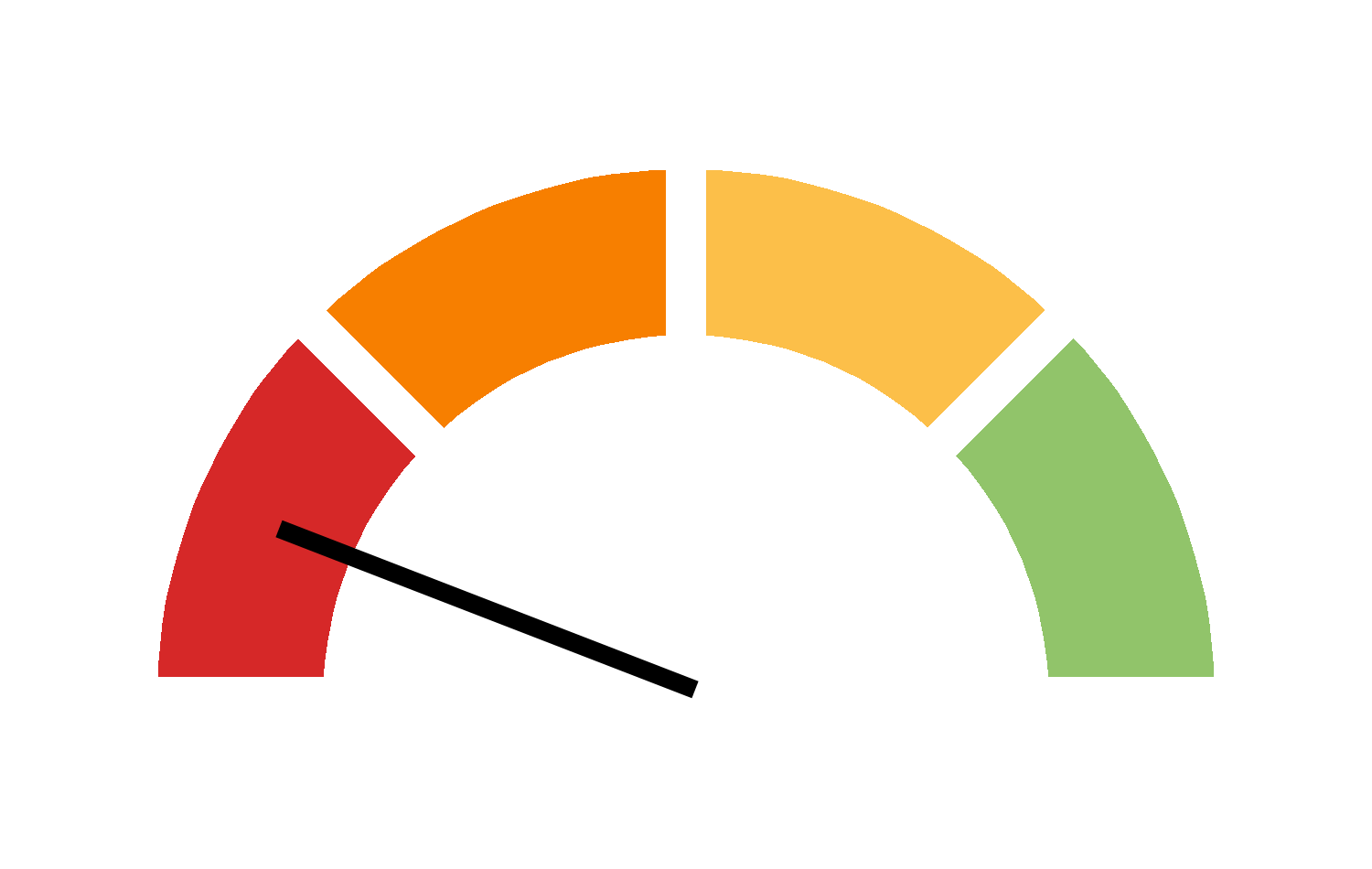
Indicateur mondial 17.9.1 : Valeur en dollars de l'aide financière et technique promise aux pays en développement (notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire)
L'indicateur 17.9.1 mesure la valeur en dollars de l'aide financière et technique versée aux pays en développement pour le renforcement des capacités et la planification nationale. Les données préliminaires révèlent que les décaissements du Canada pour les pays en développement ont totalisé 1,493 milliard de dollars en 2023, une réduction par rapport à 1,511 milliard en 2022 (figure 11). Puisque les décaissements sont passés de 1,583 milliard de dollars en 2018, lorsqu'ils ont commencé à être mesurés, à 1,493 milliard en 2023, les progrès relatifs à cet indicateur se sont détériorés en ce qui concerne l'atteinte de la cible mondiale, qui consiste à améliorer le soutien international visant à renforcer de façon efficace et ciblée les capacités des pays en développement afin d'appuyer les plans nationaux.
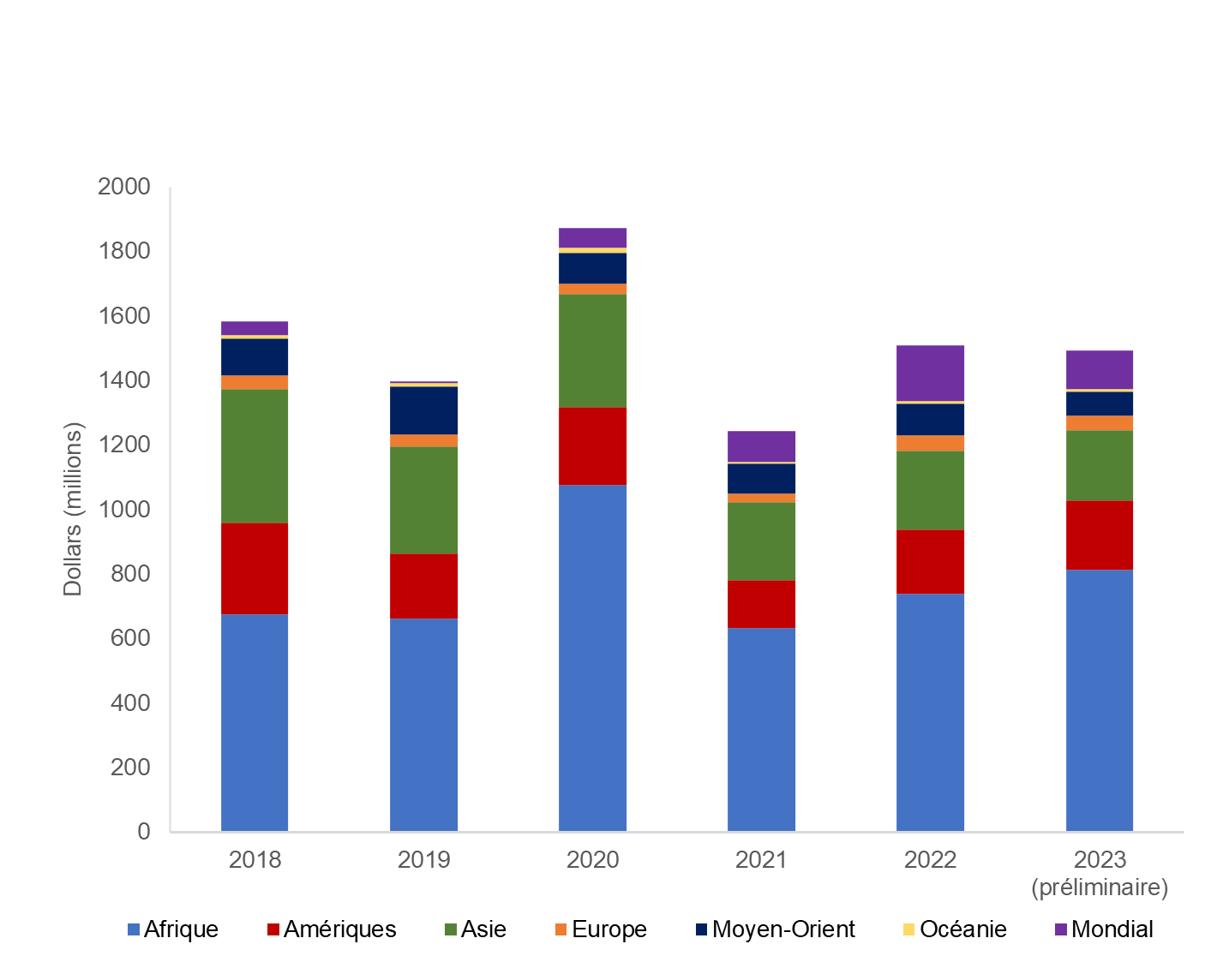
Source : Affaires mondiales Canada
Description textuelle de la figure 11
| Détail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (préliminaire) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 676 | 663 | 1,077 | 633 | 738 | 812 |
| Amériques | 283 | 202 | 241 | 149 | 199 | 216 |
| Asie | 414 | 331 | 351 | 240 | 245 | 218 |
| Europe | 44 | 38 | 30 | 27 | 49 | 46 |
| Moyen-Orient | 113 | 147 | 98 | 94 | 97 | 74 |
| Océanie | 11 | 10 | 15 | 6 | 8 | 7 |
| Mondial | 43 | 6 | 60 | 94 | 174 | 119 |
L'Afrique, parmi les régions, est demeurée le plus important bénéficiaire, recevant plus de la moitié (54 %) des décaissements du Canada au titre de l'aide financière et technique pour les pays en développement. L'Afrique a toujours reçu la plus importante proportion de l'aide, mais celle-ci a varié au fil des ans, passant d'un creux de 43 % en 2018 à un sommet de 58 % en 2020. Les Amériques et l'Asie ont chacune reçu un peu moins de 15 % des décaissements du Canada au titre de l'aide financière et technique pour les pays en développement afin de mettre en œuvre les ODD.
Le Bangladesh a été le plus important bénéficiaire du soutien bilatéral du Canada en 2023, recevant 73 millions de dollars au total, bien qu'il s'agisse d'une baisse par rapport aux 81 millions de dollars accordés en 2022. En 2023, la plus importante proportion des décaissements, totalisant 12,5 millions de dollars, a été attribuée au projet pour l'éducation pour les réfugiés et la communauté d'accueil du Bangladesh. Ce projet s'inscrit dans un effort pluriannuel et vise à renforcer le système et l'infrastructure d'éducation afin de joindre les communautés touchées par l'afflux de réfugiés et la pandémie.
L'Ukraine était le deuxième bénéficiaire en importance du soutien bilatéral du Canada au titre du renforcement des capacités et de la planification nationale. Le Canada a versé au total 40,9 millions de dollars à l'Ukraine en 2023, dans le cadre des efforts continus pour renforcer les capacités du pays.
Articles de fond
Le Canada et le Partenariat mondial pour l'éducation
L'engagement du Canada à faire progresser les objectifs de développement durable repose sur son soutien à des partenariats inclusifs et collaboratifs qui favorisent le progrès mondial. Cette approche se concrétise notamment par ses investissements continus dans le Partenariat mondial pour l'éducation, une initiative multipartite qui rassemble des gouvernements, la société civile, des organisations internationales et le secteur privé afin de renforcer les systèmes d'éducation dans les pays à revenu faible et intermédiaire. En tant que donateur, le Canada contribue à la mission du Partenariat qui consiste à élargir l'accès à une éducation de qualité, en particulier pour les enfants marginalisés. Grâce à sa dernière promesse de contribution de 300 millions de dollars canadiens pour la période de 2021 à 2025, le Canada, de concert avec d'autres donateurs, a aidé le Partenariat à fournir les compétences de base nécessaires à un emploi valorisant.
Plus précisément, entre 2001 et 2024, grâce au financement des parties prenantes, y compris du Canada, le Partenariat mondial pour l'éducation a touché 253 millions d'élèves par des activités de subvention, distribué 169 millions de manuels scolaires, formé plus de 1,9 million d'enseignantes et enseignants, et construit et rénové 36 000 salles de classe. Les mécanismes de financement innovants du Partenariat ont permis de recueillir un montant additionnel de 3,845 milliards de dollars américains en cofinancement durant cette période, ce qui a accru les retombées des contributions de donateurs tels que le Canada.
Qu'il s'agisse de soutenir des projets d'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap au Tchad, de former plus de 12 500 enseignantes et enseignants, agentes et agents chargés de l'assurance qualité dans les écoles et agentes et agents de district en Sierra Leone afin de faciliter et de dispenser efficacement des cours de mathématiques, ou d'améliorer l'accès à une éducation de qualité en construisant des salles de classe au Soudan du Sud, le soutien institutionnel du Canada au Partenariat mondial pour l'éducation démontre le pouvoir des partenariats pour l'atteinte de résultats concrets.
Renforcer la collaboration au Sommet mondial du Ralliement national des Métis
En février 2024, le Ralliement national des Métis a organisé un sommet mondial inaugural afin de fournir une plateforme pour explorer les liens entre les Autochtones et le Programme 2030 et les ODD des Nations Unies. Dans l'espoir de favoriser une meilleure compréhension de ces croisements, des défis et des solutions potentielles, le Sommet mondial a servi de point de rassemblement aux gouvernements et aux citoyens métis, aux côtés de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'Autochtones à l'échelle mondiale.
L'objectif collectif du Sommet était de veiller à ce que les initiatives de développement durable soient non seulement significatives, mais aussi inclusives et ne laissent personne pour compte. À l'échelle internationale, souvent, les initiatives mondiales de développement n'incluaient pas l'autodétermination et les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le Sommet a réuni des citoyens métis de partout dans la patrie et des représentants autochtones de 6 des 7 régions socioculturelles autochtones des Nations Unies pour organiser un dialogue sur la façon de donner suite aux ODD dans chacune des régions. Un participant a écrit qu'il « était vraiment utile d'avoir des représentants d'autres nations autochtones ».
Le Sommet était ouvert au public pour qu'un large éventail d'intervenants et de détenteurs de droits puissent participer pleinement aux importantes séances d'échange de connaissances. Les participants ont montré un grand intérêt à en apprendre plus sur les initiatives dirigées par les Métis et la localisation des ODD à l'échelon communautaire.
Le renforcement de la collaboration a été le plus important résultat du Sommet mondial du Ralliement national des Métis. Un participant a déclaré : « Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'occasion de m'asseoir avec des personnes qui ont partagé des idées, des expériences et des recommandations propres aux Métis, d'avoir pris contact avec elles et de les avoir écoutées. »
Le Sommet a offert une tribune pour une coopération accrue entre les organismes internationaux, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les Autochtones afin de partager des solutions et d'envisager l'élaboration conjointe de politiques et de programmes qui reflètent les aspirations et les valeurs des Autochtones. Il a créé un espace pour les partenariats qui a favorisé une compréhension mutuelle et une responsabilité partagée en ce qui concerne la réalisation des ODD.
À l'avenir, des forums comme celui-ci offriront la possibilité d'accroître l'inclusion des Autochtones dans le développement mondial grâce à l'intégration des principes d'autodétermination dans le Programme 2030, qui sont confirmés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Des plateformes comme le Sommet mondial du Ralliement national des Métis visent à stimuler l'innovation, la sensibilisation et la responsabilisation, tout en contribuant à façonner un avenir durable et inclusif.
La SDG Idea Factory de Kitchener, en Ontario
Située au cœur du centre-ville de Kitchener, en Ontario, la SDG Idea Factory (disponible en anglais seulement) est un centre d'entrepreneuriat unique en son genre et une installation de cotravail dont le but est de faire progresser les ODD. L'espace rassemble de nombreux organismes qui servent des entrepreneurs sociaux.
Lancée au printemps 2023, la SDG Idea Factory compte 17 bureaux, 24 bureaux à la carte, des salles de réunion à réserver, une salle de formation, un espace événementiel, des aires de réunion communes et un studio de baladodiffusion. Gérée par le Waterloo Region Small Business Centre, la SDG Idea Factory a pour mission d'aider les entrepreneurs à relever les défis mondiaux et d'offrir un espace où les dirigeants, les entrepreneurs et les intervenants locaux peuvent collaborer et innover.
Au cours de la dernière année, la SDG Idea Factory a accueilli des organismes qui se sont engagés à atteindre les ODD dans le cadre de leur travail, comme LiftOff, la Waterloo Region Community Foundation, la Community Company, la ForUsGirls Foundation, l'Oktoberfest, Bring On The Sunshine, Mot Mot Mind et le Waterloo Region Small Business Centre.
Dès son ouverture, la SDG Idea Factory a lancé une série de conférences sur les ODD visant à mieux faire connaître les objectifs. La série « Business as a Force for Good » a mobilisé des centaines de membres de la collectivité et d'entrepreneurs afin de prendre en compte les objectifs à l'échelon local. Parrainée en partie par la Waterloo Region Community Foundation, la série comptait 17 conférences sur une période de 17 mois et 3 marchés de fournisseurs écologiques, et a offert des occasions de réseautage et de vente aux propriétaires d'entreprises locales. La série actuelle, « Community of Difference Makers », a été lancée en novembre 2024 pour faire mieux connaître les histoires d'agents du changement régionaux et examiner l'intersectionnalité des objectifs.
La SDG Idea Factory a lancé 2 nouveaux programmes à l'intention d'aspirants entrepreneurs. Early Sparks (disponible en anglais seulement) est un programme de 5 semaines qui aide les participants à transformer leurs idées en entreprises. L'édition Global Goals comprend une introduction aux ODD des Nations Unies, des conseils sur la façon de bâtir une entreprise durable ainsi que des conférenciers invités qui se consacrent surtout aux ODD dans le cadre de leurs activités.
Soutenue par Berry Vrbanovic, maire de Kitchener et coprésident de Cités et gouvernements locaux unis, la SDG Idea Factory est le seul carrefour Local4Action en Amérique du Nord, qui intègre la localisation au développement durable mondial.
L'immeuble est un symbole de partenariat et de collaboration et illustre bien ce qu'est l'ODD 17. Il montre comment les organismes publics, privés et multipartites se réunissent à l'échelon local en appliquant des approches communautaires de développement économique.
En collaborant, les locataires partagent leurs connaissances et leur expertise, en plus de trouver et de mettre en œuvre leurs propres solutions aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux, ce qui donne lieu à des processus d'affaires et opérationnels plus efficients et efficaces.
Utiliser les objectifs de développement durable pour concevoir et construire un campus qui répond aux besoins locaux
Lorsque le Nova Scotia Community College (NSCC) a amorcé le processus de construction de son nouveau campus, l'objectif était de s'assurer qu'il servirait non seulement d'établissement d'enseignement, mais qu'il contribuerait aussi à la revitalisation de Sydney, en Nouvelle-Écosse. En intégrant les objectifs de développement durable au processus de conception et de construction, le NSCC s'est efforcé de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux locaux.
La conception du campus riverain de Sydney a fait l'objet de vastes discussions et consultations avec un éventail diversifié de groupes communautaires. Cette approche collaborative a fait en sorte que l'aménagement du campus s'harmonise avec des objectifs sociaux, culturels et environnementaux. Pendant la construction, 80 % de la main-d'œuvre était composée de résidents, y compris d'étudiants du NSCC qui ont acquis une expérience précieuse grâce à des emplois à temps partiel ou à des stages professionnels liés à leurs études. De plus, 10 % de la main-d'œuvre devait être composée de femmes et de groupes en quête d'équité, un objectif qui a fait l'objet de rapports mensuels et qui a souvent été dépassé.
Conçu pour favoriser la croissance sociale et économique, le campus abrite plus que des salles de classe et des laboratoires traditionnels. Il comprend des espaces interactifs comme un auditorium pour les exposés, une garderie, des espaces culturels et un centre de bien-être. Ces installations favorisent la collaboration et l'engagement en enrichissant les expériences des étudiants et des résidents. L'intégration de divers espaces visait à créer un environnement qui encourage l'apprentissage, l'échange culturel et le développement communautaire.
Le campus sert de modèle et montre comment les établissements d'enseignement postsecondaire peuvent avoir une incidence positive sur leur collectivité. L'intégration de diverses installations favorise la collaboration et l'engagement, créant un carrefour d'apprentissage et d'échange culturel qui profite à la fois aux étudiants et à la communauté élargie de Sydney.
Il faut du temps pour faciliter une collaboration significative, mais celle-ci entraîne des résultats durables et marquants. En investissant dans les relations communautaires, il est possible de créer des espaces éducatifs qui reflètent véritablement les besoins de la population locale et y répondent.
De jeunes leaders travaillent en partenariat pour combattre l'insécurité alimentaire
À Vancouver-Sud, la sécurité alimentaire et l'accès à des aliments sains sont très importants. Par conséquent, le Newcomer Leadership Program de la South Vancouver Neighbourhood House a entrepris un projet en partenariat avec Equitas, un organisme d'éducation aux droits de la personne. Ce partenariat visait à habiliter les jeunes leaders à combattre l'insécurité alimentaire, tout en favorisant le bien-être communautaire.
Dans le cadre d'activités interactives d'éducation aux droits de la personne menées sous la direction d'Equitas, les jeunes participants ont reconnu l'importance de l'accès à de l'eau potable, à des aliments nutritifs et à un environnement sain. Ils ont décidé que leur projet viserait à garantir que les familles de leur collectivité ont accès à des repas sains et à de l'information afin de réduire le gaspillage d'aliments.
Afin de tirer le meilleur parti de leurs compétences diversifiées, les jeunes ont été répartis en 3 équipes :
- équipe de préparation des repas : Ce groupe a créé des recettes, établi un budget, acheté des ingrédients et préparé des repas.
- équipe de littératie numérique : Cette équipe a conçu des infographies sur la réduction du gaspillage d'aliments et la réutilisation des restes de nourriture. Les dessins ont été transférés sur des fourre-tout et des tabliers, qui ont été distribués avec les repas.
- équipe des médias et de la sensibilisation : Ce groupe a produit une vidéo documentant le projet, qui soulignait le rôle joué par les jeunes leaders en vue de favoriser l'inclusion communautaire, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion des objectifs de développement durable à l'échelle communautaire.
En travaillant ensemble, les jeunes ont transformé une vision commune en action. Grâce aux conseils et à une petite subvention d'Equitas, ils ont distribué plus de 50 repas nutritifs ainsi que des fourre-tout et des tabliers à des familles dans le besoin, leur apportant un soutien concret. Les participants ont également acquis des compétences essentielles en leadership, en travail d'équipe et en littératie numérique ainsi qu'une meilleure compréhension de leurs droits et responsabilités au sein de leur collectivité.
Plus de 200 personnes ont visionné en ligne la vidéo produite par l'équipe des médias et de la sensibilisation, qui les a sensibilisées à l'importance des pratiques durables et à l'influence des initiatives dirigées par des jeunes. La collaboration a démontré le pouvoir des partenariats pour surmonter des défis systémiques, appuyer l'objectif de développement durable 17 et favoriser des collectivités plus inclusives.
Prochaines étapes
Tout au long de 2024, des mesures importantes ont été prises au Canada pour renforcer les progrès relatifs aux objectifs de développement durable (ODD). D'importants travaux ont eu lieu, notamment des interventions pour contrer la violence fondée sur le sexe et offrir plus de perspectives aux jeunes et aux Autochtones sur le marché du travail ou la collaboration pour faire progresser les activités de planification et de conservation des océans.
Toutefois, 2024 a également été remplie de difficultés pour les habitants du Canada et du monde entier. Les progrès accomplis à l'égard des ODD ont été entravés par le coût élevé de la vie, l'insécurité alimentaire, le déclin du bien-être mental, la crise des surdoses, la discrimination, les conflits géopolitiques, les menaces à l'égalité entre les sexes à l'échelle mondiale et les changements climatiques. Dans ces circonstances, les ODD demeurent une feuille de route vers un avenir plus juste, plus durable et plus pacifique.
L'importance des partenariats est l'un des principes sous-jacents du Programme 2030. En 2024, les Canadiens ont collaboré avec les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones, les collectivités, les réseaux nationaux et les organismes internationaux pour aider les gens à améliorer leur vie et leur collectivité. Les Canadiens ont offert des possibilités de travail durable et inclusif, ont soutenu les personnes dans le besoin dans leur collectivité et sont intervenus pour que personne ne soit laissé pour compte, tant au pays qu'à l'étranger.
Des travaux efficaces sont en cours pour faire progresser les ODD, mais de toute évidence, il faut en faire davantage pour atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble.
Nous devons surmonter de grands défis, et dans ce contexte, il est important de rester concentrés sur la feuille de route. Les champs d'action comprennent le soutien de la santé mentale des Canadiens, la prévention de la violence fondée sur le sexe, la protection des principaux stocks de poissons et des travailleurs de l'industrie agroalimentaire canadienne et la résolution de la crise des surdoses. Ce n'est que grâce à la collaboration que nous pouvons bâtir un pays et un monde où les gens jouissent d'une bonne santé, se sentent bien et ont droit à l'égalité entre les sexes, à un travail décent et à des océans sains.