Rapport annuel 2023-2024 de la Direction générale des sciences et de la technologie
Mai 2024
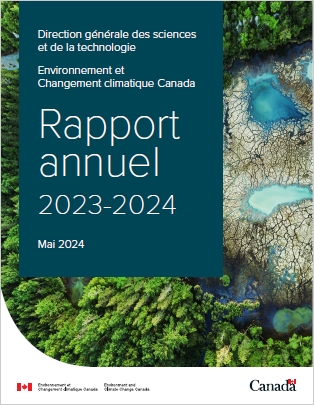
Téléchargez le format alternatif
(PDF format, 7,88 Mo, 33 pages)
Sur cette page
- 1. Introduction
- 2. Faits marquants et réalisations en 2023-2024
- 2.1 Activités transversales
- 2.2 Rendre possibles la prévision et la projection des conditions météorologiques, des événements extrêmes et des conditions environnementales dans un climat changeant
- 2.3 Mieux comprendre la manière d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter pour un Canada résilient et carboneutre
- 2.4 Orienter la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature et améliorer la résilience des écosystèmes et les services connexes
- 2.5 Soutenir la protection de l’environnement maintenant et à l’avenir
- 3. La voie à suivre en 2024-2025
1. Introduction
1.1 Message du SMA
La Direction générale des sciences et de la technologie (DGST) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) se consacre à la prestation de services scientifiques financés par des fonds publics pour aider à combattre les menaces environnementales actuelles et orienter la protection de l’environnement pour les générations futures. Les activités scientifiques menées par la DGST servent de fondement pour façonner les politiques, les règlements et les programmes qui permettent de remplir le mandat d’ECCC et d’assumer nos responsabilités croissantes. En tant que direction générale de prestation horizontale, notre engagement envers l’excellence scientifique est essentiel pour faciliter la prise de décisions éclairées, l’élaboration de politiques et la prestation de services solides dans l’ensemble du ministère, du gouvernement du Canada, et au-delà.
Le présent rapport présente les faits marquants du dernier exercice qui rendent compte de notre engagement envers l’excellence scientifique. Ces réalisations s’inscrivent dans les quatre principales responsabilités ministérielles (nature, changements climatiques, pollution, conditions météorologiques ou environnementales) et illustrent les valeurs et les priorités scientifiques de la Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC qui a récemment été renouvelée.
En 2023-2024, la DGST a mis l’accent sur la diversité et l’inclusion, développé davantage le talent de son personnel, renforcé ses partenariats et innové dans sa façon de travailler. En tant que direction générale, nous pouvons être fiers de notre contribution au ministère et à la protection de l’environnement. Je vous invite à prendre connaissance de ces récentes réalisations pour vous inspirer à poursuivre vos efforts.
Marc D’Iorio
Sous-ministre adjoint, Direction générale des sciences et de la technologie
En 2023-2024, la DGST a directement soutenu 18 des engagements de la lettre de mandat d’ECCC, notamment :
- Élaboration et mise en œuvre de la Stratégie nationale d’adaptation du Canada
- Modernisation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Mise en œuvre d’un Plan d’action sur l’eau douce renforcé
- Adaptation au climat et atténuation de ses effets
- Programme sur la biodiversité, la conservation et la nature
- Réconciliation avec les peuples Autochtones
- Région des lacs expérimentaux
- Agence de l'eau du Canada
- Programme relatif aux plastiques
- Renouvellement du Service météorologique du Canada et Calcul de haute performance
Aperçu de la Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC

Description longue
Vision :
ECCC : Source fiable en matière de science et d’innovation qui éclaire les politiques et fournit des services qui protègent les personnes et l’environnement partout au Canada, maintenant et à l’avenir
Orientations scientifiques :
- Rendre possible la prévision et la projection des conditions météorologiques, des événements extrêmes et des conditions environnementales dans un climat changeant
- Mieux comprendre la manière d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter pour un Canada résilient et neutre en carbone
- Orienter la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature et améliorer la résilience des écosystèmes et des services
- Soutenir la protection de l’environnement maintenant et à l’avenir
Les valeurs de la science :
- Intégrité scientifique
- Diversité, inclusion et équité
- Rapprochement, tressage et tissage avec la science Autochtone
- Collaboration
- Réceptivité
- Transparence
Soutiens fondamentaux :
- Synthèse et mobilisation des connaissances
- Personnes
- Gouvernance des avis scientifiques
- Communication
- Données
- Infrastructure
1.2 Nos équipes, nos valeurs
Grâce à la collaboration et aux partenariats, les professionnels dévoués de la DGST font progresser, appliquent et communiquent les connaissances scientifiques dans tout le Canada. Nos réalisations en tant que direction générale au cours de la dernière année sont le résultat du dévouement du personnel de la DGST envers les valeurs fondamentales et de l’amélioration continue de la façon dont nous fournissons des avis scientifiques pour orienter les politiques, les règlements, et les opérations ministérielles visant à protéger l’environnement.
La DGST compte 1500 employés travaillant dans 43 immeubles répartis dans 32 collectivités au Canada. 5 employés de la DGST sont basés dans l’Arctique, notamment à l’Installation de recherche de Pond Inlet au Nunavut. À partir de cette vaste base au Canada, les scientifiques de la DGST mènent des recherches dans tous les écosystèmes et environnements du pays.
Direction générale des sciences et de la technologie au Canada
Approx. 1500 employés dans 43 bureaux

Description longue
Environ 1500 personnes répartis sur 43 sites.
En Alberta : Calgary, Edmonton
En Colombie-Britannique : Nanaimo, Sydney, Vancouver, Victoria
Au Manitoba : Winnipeg
Au Nouveau-Brunswick : Fredericton, Moncton, Sackville
À Terre-Neuve-et-Labrador : Goose Bay, Mount Pearl
Dans les Territoires du Nord-Ouest : Yellowknife
En Nouvelle-Écosse : Dartmouth
Au Nunavut : Pond Inlet
En Ontario : Burlington, Egbert, King City, Ottawa, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Toronto, Trenton, Waterloo
Au Québec : Dorval, Gatineau, Montréal, Québec
En Saskatchewan : Regina, Saskatoon
Répartition régionale des employés de la DGST

Description longue
- Région de la capitale nationale avec 573 employés
- Région de l'Ontario avec 479 employés
- Région du Québec avec 188 employés
- Région du Pacifique et du Yukon avec 139 employés
- Région des Prairies et du Nord avec 111 employés
- Région de l'Atlantique avec 78 employés
Le budget de la DGST pour 2023-2024 reflétait un éventail diversifié d’investissements pour mener à bien la recherche et l’innovation scientifiques guidées par le mandat. Avec près de 34 millions alloués aux subventions et contributions, la DGST continue de mobiliser le système d’innovation canadien pour faire progresser les sciences environnementales essentielles. La direction générale mobilise de plus en plus de connaissances à l’extérieur du ministère pour relever les défis environnementaux complexes d’aujourd’hui.
Diversité, inclusion et équité
La DGST est fière de ses effectifs diversifiés et inclusifs, mais reconnaît également la sous-représentation des groupes visés par l’équité dans certains domaines, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. La DGST continue de faire du recrutement et du maintien en poste des talents des groupes d’équité en matière d’emploi sa principale priorité en matière de ressources humaines.
- À la fin de 2023, la composition de la DGST comprenait 23,4 % de minorités visibles, les employés noirs constituant 2,1 %. De même, les employés Autochtones représentaient 2,1 % des employés de la DGST, tandis que les personnes en situation de handicap représentaient 6,1 % des employés au cours de la même périodeNote de bas de page 1.
- La DGST continuera de miser sur les progrès récents dans l’équité en matière d’emploi pour améliorer la représentation et l’inclusion dans ses activités scientifiques et ses effectifs.
Grâce à la mobilisation active de la direction et des employés, le Groupe de travail sur la diversité et l’inclusion de la DGST accomplit des progrès remarquables en vue de réaliser son Plan d’action sur la diversité et l’inclusion pluriannuel. À ce jour, le groupe de travail a réalisé plus de 25 événements et initiatives par l’entremise de ses cinq sous-groupes dirigés par des employés sur le recrutement et l’habilitation, la formation et le perfectionnement, les communications et la sensibilisation, l’intégration et les approches Autochtones, ainsi que le milieu de travail sain. En plus d’organiser des forums de discussion sur la lutte contre le racisme, les préjugés inconscients, l’accessibilité, la neurodiversité et le leadership inclusif, le groupe de travail a publié une trousse d’intégration pour les nouveaux employés, élaboré un guide d’embauche inclusif pour les gestionnaires et préparé un plan d’action ciblé pour résoudre certains des problèmes soulevés dans le sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 2022-2023.
En outre, les activités conjointes et collaboratives menées en 2023-2024 par la DGST avec les réseaux ministériels d’employés ont permis de sensibiliser le personnel de la DGST et de promouvoir un milieu de travail respectueux, solidaire et inclusif. Une table ronde printanière organisée conjointement avec le Comité des femmes en science et en technologie a mis en lumière des dirigeantes chevronnées dans la fonction publique, qui ont fait part de leurs expériences, donné des conseils et souligné l’importance de la diversité pour l’innovation dans le domaine scientifique. Un événement en partenariat avec le Réseau des employés Autochtones d’ECCC a été organisé en l’honneur de la Journée nationale des peuples Autochtones en juin 2023. Au cours de l’année, des événements en partenariat avec le Réseau des employés noirs d’ECCC, le Réseau des employés sur l’accessibilité d’ECCC et le Réseau de la fierté d’ECCC ont éveillé les consciences et fourni des ressources et du soutien aux employés.
En 2023-2024, une Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) a été effectuée sur l’application du Cadre de gestion de l’avancement professionnel pour les chercheurs du gouvernement fédéral par ECCC. Les résultats de l’ACS Plus mettent en évidence les défis et les obstacles systémiques auxquels les professionnels de la science sont confrontés dans l’avancement de leur carrière, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes visés par l’équité en matière d’emploi. Ces conclusions orienteront les efforts de la DGST pour améliorer la mise en œuvre par ECCC du cadre de gestion de l’avancement professionnel pour les chercheurs fédéraux (RES), mieux soutenir le perfectionnement du personnel et renforcer la capacité de la direction générale à attirer et à retenir les talents dans le domaine de la recherche. À l’automne 2023, la DGST a constitué un groupe de travail sur l’ACS Plus au sein de la direction générale dans le but de coordonner les efforts et d’échanger des renseignements pour mieux comprendre et traiter ses besoins en matière d’ACS Plus. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts généraux déployés par ECCC, notamment le Réseau consultatif sur l’ACS Plus, un forum qui regroupe des représentants de chaque direction générale.
- Les femmes représentent 31 % de la population totale du groupe SE-RESNote de bas de page 2.
- Les femmes occupent 14 % des postes de la catégorie RES-05, le niveau le plus élevé des postes RES.
- Au cours des dix dernières années, 23 % des candidats à une promotion du SE-RES étaient des femmes, pour un taux de réussite de 76 %.
Collaboration et partenariats
La DGST collabore avec un vaste réseau de partenaires de recherche à l’échelle nationale et internationale et de membres de la communauté des données. La diversification continue et le renforcement de ces partenariats sont essentiels à l’apport de la DGST à un avenir plus vert et plus durable.
En 2023-2024, l’expertise, les données et les efforts de coordination de la DGST ont contribué à faire progresser la participation et le leadership du Canada dans divers partenariats à l’échelle internationale, notamment le Conseil de l’Arctique, la Commission de coopération environnementale, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, l’Observatoire international des émissions de méthane, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques. La contribution de la DGST aux efforts internationaux est présentée plus en détail au chapitre 2.
À l’échelle nationale, la DGST travaille en étroite collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux financés par des fonds publics, par l’intermédiaire de groupes de travail, de comités et d’accords officiels, tels que des protocoles d’entente avec le Conseil national de recherches du Canada, Santé Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et l’Agence spatiale canadienne. Sous l’égide d’ECCC, la DGST est responsable de plusieurs initiatives scientifiques importantes dirigées par d’autres ministères, notamment les initiatives en matière de génomique (Initiative de recherche et développement en génomique), la participation du Canada au Groupe de travail du G7 sur la science ouverte, et l’accord sur la science, la technologie et l’innovation conclu avec les États-Unis.
En 2023-2024, la DGST a continué d’innover dans ses relations avec ses partenaires et entretient des liens solides avec les parties prenantes, y compris l’industrie, la société civile, les autres ordres de gouvernement et les Canadiens. Par exemple, les améliorations apportées à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) ont porté sur l’accroissement de la qualité des données grâce à la mise à jour des documents d’orientation et à l’ajout de fonctions de visualisation des données qui répondent aux commentaires de divers intervenants, comme le tableau de bord amélioré de l’INRP et la toute nouvelle carte en ligne. Des partenariats en formation novateurs, comme le Réseau canadien de biosurveillance aquatique, ont permis aux scientifiques citoyens d’acquérir une expérience pratique. Des partenariats continus avec les provinces et les territoires ont permis une surveillance à long terme de la qualité de l’air et de l’eau, et de la faune, notamment dans le cadre du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique et du Programme de surveillance des sables bitumineux, ainsi que de l’amélioration continue du Gestionnaire d’information du guichet unique d’ECCC pour la déclaration des émissions et de la pollution.
Chaque année, les collaborations entre la DGST et des coauteurs externes donnent lieu à des centaines de publications scientifiques évaluées par des pairs et à des innovations technologiques qui contribuent à l’avancement des sciences de l’environnement; c’est cette science qui forme ultimement la base des données probantes pour ECCC et le gouvernement du Canada, les politiques et les programmes. La dernière année n’a pas dérogé à la règle, avec 515 des 586 publications de la DGST en 2023 rédigées avec des coauteurs provenant d’un total de 704 organisations!
La DGST a également élaboré un nouveau plan de mobilisation en milieu universitaire qui aidera la DGST à renforcer ses relations productives avec le milieu universitaire par l’entremise d’une approche stratégique structurée visant à améliorer la communication, à faciliter les ateliers et à déterminer les priorités communes. Pour encourager les talents scientifiques émergents du Canada, la DGST a embauché 127 étudiants dans divers domaines d’études en 2023-2024. La DGST compte huit installations situées au sein d’universités canadiennes.
En 2023-2024, le programme de stage Horizons Sciences de la DGST a aidé environ 650 diplômés au pays à acquérir une expérience de travail pratique dans l’économie verte du Canada.
Pour continuer à soutenir les chercheurs canadiens, l’industrie et les organisations communautaires, tout en faisant progresser une science de l’environnement de renommée mondiale, la DGST a conclu 108 accords de subventions et de contributions (S et C) avec 71 organismes externes en 2023-2024, pour un financement total de près de 34 millions de dollars. Parmi ces accords, 62 ont été conclus avec des universités canadiennes pour faciliter la recherche scientifique en collaboration avec certains des plus grands experts du Canada, laquelle porte sur un large éventail de questions environnementales, comme la surveillance de la dispersion de matières plastiques dans l’environnement, l’analyse des contaminants dans les poissons et des effets sur les écosystèmes, le suivi des émissions de méthane en milieu urbain et la modélisation des effets des feux de forêt sur le climat. En 2023-2024, la DGST a intensifié son soutien à ses partenaires Autochtones avec 27 projets financés par les S et C, notamment l’évaluation des impacts de l’exploitation des sables bitumineux sur l’utilisation traditionnelle des terres dans le territoire traditionnel de la Première Nation de Sucker Creek et le financement accordé au Conseil de Mushkegowa pour l’utilisation d’outils et de techniques géospatiales en vue de coordonner la recherche sur le carbone et la biodiversité sur le territoire Mushkegowak.
La collaboration en action : Étude sur la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (ÉPAHT)
Les études sur la qualité de l’air ont toujours eu lieu pendant l’été. Cependant, l’air hivernal est, quant à lui, affecté par d’autres sources de pollution et conditions ambiantes. La Direction des sciences et de la technologie atmosphériques a mené la première étude de ce type au Canada pour étudier l’effet des conditions météorologiques, des appareils de chauffage, des foyers au bois, du sel de déglacement et d’autres facteurs hivernaux sur la qualité de l’air en milieu urbain. L’étude a compris une campagne intensive sur le terrain à Toronto, en collaboration avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et de plusieurs universités.
Transparence et ouverture
Les efforts scientifiques d’ECCC prennent toute leur ampleur lorsque les décideurs et le public ont ouvertement accès à l’information, aux avis scientifiques ainsi qu’aux incertitudes connexes. Le personnel de la DGST a appuyé le travail des comités parlementaires en fournissant une expertise en la matière lors de 19 comparutions en 2023-2024. Le personnel de la DGST a soutenu le travail des comités parlementaires en fournissant une expertise en la matière lors de 19 comparutions devant des comités en 2023-2024. Les documents préparés par la DGST ont éclairé plus de 10 autres réunions de comités parlementaires. Une collaboration soutenue à l’échelle nationale et internationale entre les producteurs et les utilisateurs de données scientifiques permet d’orienter l’évolution de la transmission des données et de la prestation de conseil, ce qui accroît l’influence de la science.
En 2023, les auteurs de la DGST ont produit environ 586 publications scientifiques évaluées par des pairs, qui représentent environ 86 % de toutes les publications scientifiques évaluées par des pairs publiées par ECCC. Plus particulièrement, 71 % des publications scientifiques évaluées par les pairs de la DGST sont en libre accès et mises à la disposition des éducateurs, des chercheurs, des décideurs et des membres du public, ce qui garantit un accès à grande échelle à la connaissance, peu importe l’emplacement géographique et l’affiliation institutionnelle.
Conjointement aux efforts déployés à l’échelle du gouvernement, la DGST dirige l’approche d’ECCC en faveur d’une science fédérale ouverte et accessible par l’intermédiaire du Plan d’action pour la science ouverte : 2021-2026. En janvier 2024, ECCC, par l’entremise de la DGST a été un chef de file et contributeur clé au lancement du Dépôt fédéral de science ouverte du Canada, et l’un des premiers ministères et organismes à vocation scientifique (MOVS) participants à y intégrer un grand nombre de ses publications. Cette plateforme Web regroupe les résultats des travaux de recherche des MOVS participants et s’avère un outil sûr et transparent qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder gratuitement à la science fédérale.
Certains renseignements et ensembles de données générés par la DGST comprennent le Rapport d’inventaire national du Canada, le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, l’Inventaire national des rejets de polluants, les substances indiquées dans certains des outils législatifs et réglementaires canadiens, l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, l’Inventaire des émissions de carbone noir, le programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique et le programme national de surveillance de la qualité de l’eau à long terme. Ils sont diffusés et consultés régulièrement sur le Portail de données ouvertes du Canada et sur divers autres portails en libre accès, comme DataStream, une plateforme en libre accès de partage des données sur l’eau douce au Canada. Les données du projet de surveillance environnementale des sables bitumineux géré conjointement par le Canada et l’Alberta sont accessibles sur le Portail de données ouvertes du Canada ainsi que sur le portail du Programme de surveillance des sables bitumineux de l’Alberta (en anglais seulement).
Le saviez-vous?
Le programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) de la DGST est le deuxième site de données le plus visité d’ECCC ! Le programme RNSPA, qui célèbre cette année son 55e anniversaire, surveille la qualité de l’air à l’échelle régionale grâce à un réseau de plus de 250 stations réparties dans tout le Canada, dans le but d’informer la population sur la qualité de l’air qu’elle respire. Géré par la Direction des sciences et de la technologie atmosphériques, le programme RNSPA est administré dans le cadre d’un accord de coopération entre ECCC, les provinces, les territoires et certaines municipalités.
Rapprochement, tressage et tissage avec la science Autochtone
Le rapprochement, le tressage et le tissage de la science Autochtone dans l’ensemble des pratiques scientifiques d’ECCC sont essentiels pour soutenir la réconciliation, orienter les politiques et les programmes et renforcer la prise de décision au sein d’ECCC.
Au cours de sa deuxième année d’existence au sein d’ECCC, la Division de la science Autochtone (DSA) de la DGST a poursuivi ses efforts pour mettre au point et appliquer une optique Autochtone aux activités scientifiques et politiques ainsi qu’aux activités de programme d’ECCC. À cette fin, la DSA vise à produire et à mobiliser la science dirigée par les Autochtones et continue d’appliquer une approche de dotation axée sur les Autochtones. La nouvelle division a commencé l’année avec seulement deux employés, mais elle a depuis quadruplé, comptant maintenant 9 employés dont 6 s’identifient comme Autochtone. Les faits saillants des initiatives de la DSA en 2023-2024 sont les suivants : atelier sur l’éthique Autochtone, axé sur la création d’un cadre éthique Autochtone pour la réalisation de recherches respectueuses sur les oiseaux migrateurs et d’autres animaux, atelier sur les prévisions météorologiques, les lieux et espaces ainsi que les jardins de palourdes (Loxiwe).
En 2023-2024, la série de conférences Voix Autochtones a accueilli sept conférenciers et conférencières de renom. Ces scientifiques Autochtones ont participé à des discussions éclairantes sur des sujets, comme la cogestion Autochtone, la pêche Autochtone et la recherche sur les mammifères marins de l’Arctique. La présentation de Jesse Popp intitulée « Weaving Ways of Knowing Among the Trees » a notamment attiré plus de 600 participants à l’événement en direct.
La série de conférences continuera à l’avenir d’amplifier les voix Autochtones au sein de la communauté scientifique. Cette série souhaite inciter les employés d’ECCC à adopter des perspectives diverses et à remettre en question les idées préconçues, en favorisant un espace inclusif qui valorise différentes façons de savoir et d’être dans le domaine scientifique et crée des lieux pour celles-ci.
La DGST a aussi établi un partenariat dans le cadre d’initiatives comme le projet des Nations Gwa’sala—’Nakwaxda’xw sur la récolte à des fins alimentaires, sociales et rituelles à Blunden Harbour (Colombie-Britannique); l’élaboration d’une formation pour soutenir la surveillance communautaire des écosystèmes aquatiques avec l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador; et un projet de surveillance communautaire Autochtone de la qualité de l’air à Fort McKay, dans la région des sables bitumineux. Le présent rapport contient d’autres renseignements sur ces initiatives et d’autres initiatives collaboratives de science Autochtone.
2. Faits marquants et réalisations en 2023-2024
2.1 Activités transversales
Intégrité scientifique
Sous la direction de la DGST, l’intégrité scientifique est la pierre angulaire de la prise de décisions éclairées par les données probantes et de la réputation du ministère en tant que source fiable d’information scientifique.
Au cours de la dernière année, la DGST a mieux fait comprendre et connaître la Politique sur l’intégrité scientifique d’ECCC (Pol-IS), par le déploiement de nouvelles ressources et de séances d’information à l’intention des employés d’ECCC afin qu’ils se familiarisent avec cette politique et son incidence pour leur travail. Les responsables de la direction générale ont aussi élaboré un nouveau document d’orientation concernant l’examen des allégations de manquement à l’intégrité scientifique au sein d’ECCC. La DGST préside le groupe de travail interministériel sur la mise en œuvre de la Politique sur l’intégrité scientifique. Ce forum de collaboration fait appel aux ministères et organismes à vocation scientifique, au Bureau du conseiller scientifique principal, aux conseils de recherche, aux agents négociateurs et à d’autres intervenants. Au cours de la dernière année, ce groupe de travail a contribué à des initiatives telles que l’élaboration de nouvelles formations sur la prise de décision fondée sur des données probantes. Ces cours, maintenant offerts par l’École de la fonction publique du Canada sous le code TRN502 et TRN503, permettent d’améliorer les compétences professionnelles dans un domaine essentiel.
En 2023, Jennifer Winter, Ph. D., a été nommée conseillère scientifique ministérielle (CSM) et responsable de l’intégrité scientifique d’ECCC.
Mme Winter fournit des conseils sur la promotion d’une culture d’excellence scientifique et sur la collaboration universitaire stratégique pour tirer parti des perspectives scientifiques externes. À titre de Responsable de l’intégrité scientifique, Mme Winter veille à ce que les manquements à la Politique sur l’intégrité scientifique d’ECCC soient traités avec impartialité, confidentialité et respect. L’apport de Mme Winter fait d’ECCC un organisme de réglementation et un décideur politique crédibles qui se fondent sur la science ainsi qu’une source d’information scientifique faisant autorité.
Données et infrastructure
L’investissement stratégique dans la science et l’infrastructure de recherche est essentiel pour exploiter les données et l’information scientifiques, accroître les capacités scientifiques nationales et promouvoir la collaboration. En phase avec ses activités de premier ordre de surveillance, de modélisation, de réglementation et de recherche axées sur l’air, la santé des écosystèmes aquatiques, la qualité de l’eau, la conservation de la nature, la gestion des produits chimiques et autres, la DGST a produit et géré d’énormes quantités de données et de renseignements scientifiques à l’échelle locale et nationale au cours de la période 2023-2024.
Les fonds de données scientifiques de la DGST sont variés, complexes, évoluent rapidement et augmentent rapidement en volume. Cela comprend les données ponctuelles, les séries chronologiques, les données géospatiales quadrillées en 3 dimensions, les données numériques, les données textuelles, les données d’image, les données audio, les données vidéo, les données de modélisation et les données réglementaires.
Ces ensembles de données pluridisciplinaires et variés couvrent de nombreux domaines essentiels, comme les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l’eau à l’échelle nationale, la génomique, le climat, la biodiversité, la qualité de l’air, les dépôts, les aérosols et l’ozone stratosphérique. Ces ensembles de données permettent de fournir de précieux conseils scientifiques et de prendre des décisions éclairées, d’élaborer des politiques et de faire des découvertes scientifiques à l’échelle nationale et internationale. En 2023-2024, ils ont été utilisés pour étayer des projets, comme les efforts nationaux de tarification du carbone et les prévisions des conditions environnementales, et pour contribuer aux rapports produits par des organisations internationales influentes telles que les rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et le cadre mondial pour la biodiversité du Programme des Nations unies pour l’environnement.
En 2023-2024, la DGST a apporté de nombreuses améliorations à la gestion des volumes croissants de données. La DGST a déployé un système de gestion de l’information de laboratoire pour automatiser l’analyse en laboratoire et la production de rapports pour le programme de Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique. La direction générale met en œuvre une Solution de gestion des données sur la qualité de l’eau à l’échelle nationale pour moderniser la gestion des données sur la qualité de l’eau et fournir une plateforme intégrée de données d’accès généralisé pour la population canadienne. La direction générale a également continué de diriger le Système de guichet unique d’ECCC qui intègre les données de près de trente programmes fédéraux et provinciaux qui réglementent la pollution. La DGST a acquis 900 To supplémentaires de stockage pour le partage de données climatiques modélisées et 1,1 Po de stockage pour le calcul de haute performance dans le cadre de projets collaboratifs de recherche sur la météorologie, l’environnement, le climat et la qualité de l’air.
La DGST participe activement à de nombreuses missions d’observation de la Terre par satellite qui recueillent des données de grande importance. Par exemple, la mission satellite TEMPO (Tropospheric Emissions : Monitoring of Pollution) (en anglais seulement) de la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis, a été lancée en avril 2023. La participation de la DGST a assuré que TEMPO fournira des données sur les sources et les schémas de pollution atmosphérique locale pour plus de 99 % de la population du Canada.
Les travaux de construction du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique (CESA), une nouvelle installation de sciences aquatiques prévue à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont officiellement commencé en 2023. Ce centre de recherche de calibre mondial réunira ECCC, Pêches et Océans Canada, le Conseil national de recherches, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence spatiale canadienne. Dans les années à venir, le personnel de la DGST au CESA collaborera avec d’autres membres de la famille fédérale à des initiatives scientifiques transformationnelles visant à mieux comprendre, à protéger et à soutenir les écosystèmes d’eau douce et les écosystèmes côtiers de l’Atlantique.
Synthèse, mobilisation et communication des connaissances
En 2023-2024, la DGST s’est fixé comme priorité de rendre la science plus accessible, afin d’aider les gouvernements à prendre des décisions et de faciliter les choix quotidiens des Canadiens et Canadiennes à l’échelle du pays. Cet effort qui visait à renforcer la confiance du public envers la science a favorisé des discussions et des partenariats éclairés et s’est traduit par des applications concrètes dans le monde réel.
En 2023-2024, 105 publications originales ont été publiées sur le compte X (anciennement Twitter) de Science et technologie d’ECCC.
En 2023-2024, la DGST a présenté 11 séances du « Science Café d’ECCC » sur une variété de sujets, comme les possibilités de la génomique et les effets de la pollution plastique. Les séances « Science Café d’ECCC » sont une occasion pour les scientifiques du ministère de faire part de leurs travaux et de nouer des liens au sein du ministère.
En 2023-2024, la DGST s’est associé au Centre canadien science et médias pour offrir une formation en communication scientifique aux chercheurs de la DGST de tout le Canada afin qu’ils puissent mieux communiquer leurs recherches aux médias, au public canadien et aux décideurs.
La nouvelle série de séminaires sur les sciences de la faune a mis en évidence la haute qualité de la science faunique produite en collaboration par la DGST et le Service canadien de la faune. Les séminaires ont porté sur des questions scientifiques essentielles pour la conservation et le rétablissement d’espèces sauvages, comme le martinet ramoneur, l’océanite cul-blanc et le papillon monarque.
Au printemps 2023, la DGST a commencé l’élaboration d’un deuxième Rapport sur le climat changeant du Canada, la publication du premier remontant en 2019. Cette évaluation scientifique nationale décrira l’évolution du climat du Canada, les causes des changements et les changements projetés pour l’avenir. Elle fera appel à des experts du gouvernement fédéral, des universités canadiennes et des détenteurs du savoir et de la science Autochtones.
La DGST est aussi à la tête de la participation du Canada à l’évaluation continentale trinationale de la biodiversité et des changements climatiques. Cette évaluation phare résumera les connaissances sur les liens importants entre les changements climatiques et la biodiversité, y compris le repérage d’importantes lacunes au niveau des connaissances et les conséquences pour les politiques relatives à la biodiversité et aux changements climatiques dans divers domaines d’expertise au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L’évaluation représentera une contribution continentale aux travaux futurs de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et d’autres forums internationaux sur la biodiversité.
La Synthèse des sciences de l’eau douce au Canada a été publiée au début de 2024 pour soutenir la mobilisation dans le cadre du programme scientifique national sur l’eau douce. Les experts de la DGST ont collaboré avec une équipe de plus de 100 collègues du gouvernement fédéral pour produire le document de synthèse, qui sert de point de départ à la discussion avec les partenaires et les intervenants sur les priorités, les lacunes et les besoins scientifiques sur l’eau douce au Canada. En fin de compte, les contributions de la DGST au Programme scientifique national sur l’eau douce aideront à soutenir l’Agence de l'eau du Canada et un Plan d’action sur l’eau douce renforcé.
Au sein de la DGST, le Groupe consultatif d’experts scientifiques nouvellement constitué par la Direction des sciences de la faune et du paysage met à la disposition des décideurs du Service canadien de la faune et d’ailleurs des avis d’experts scientifiques sur la faune et le paysage. Le groupe réunit des experts d’ECCC, du monde universitaire, d’organisations non gouvernementales et de l’industrie pour formuler des avis et des recommandations scientifiques consensuels. Les rapports sont ensuite rendus publics. Au cours des prochaines années, le Groupe entend intégrer davantage la science Autochtone dans les activités scientifiques traditionnelles afin de mieux prendre en compte toutes les sources de connaissances dans la formulation des meilleurs conseils.
La DGST a dirigé la réalisation d’un projet pilote de conseils scientifiques sur la faune portant sur les papillons monarques. La DGST a travaillé en étroite collaboration avec l’utilisateur final de la science, soit le Service canadien de la faune (SCF), pour relever la question de recherche prioritaire. Le personnel a ensuite mené une étude pour répondre à la question et a communiqué les résultats et les conseils au SCF au moyen d’une rencontre en personne et d’un rapport officiel. Les leçons tirées du processus pilote ont contribué à l’établissement de nouveaux processus d’avis scientifiques au ministère. Cette approche axée sur le client est un indicateur de l’orientation future de la Direction générale au cours des prochaines années.
Gouvernance et politique scientifique
La Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC a été publiée en février 2024 pour guider les activités scientifiques du ministère au cours des prochaines années. La Stratégie appuie la modernisation et l’amélioration continue de la réalisation, de l’utilisation, de la gouvernance et de la communication des activités scientifiques d’ECCC afin de s’adapter à un environnement en constante évolution. Sous la direction de la DGST, la Stratégie a été élaborée grâce à la collaboration de tout le ministère, guidée par les forums de gouvernance pour la science d’ECCC et examinée par d’autres ministères et organismes à vocation scientifique ainsi que par les syndicats.
En mai 2023, la DGST a mis en place le Cadre de gouvernance des avis scientifiques, avec l’approbation du Comité exécutif de gestion du ministère. Le nouveau cadre prévoit des tables de consultations scientifiques pour favoriser la collaboration horizontale entre les directions générales et pour renforcer le rôle, la pertinence et l’incidence des activités scientifiques dans la prise de décisions et l’exercice des responsabilités ministérielles. Les cinq tables de consultations scientifiques ont connu une année productive, chacune d’elles ayant tenu de trois à quatre réunions. Les discussions aux tables de consultations scientifiques ont porté sur des sujets comme la mise en place d’un processus de priorisation pour une meilleure coordination des besoins scientifiques dans l’ensemble du ministère en matière de pollution, les initiatives pour relever les défis, les possibilités et les priorités en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, les efforts pour recenser les exigences scientifiques afin de les harmoniser aux cibles du Cadre mondial de la biodiversité et d’en soutenir la mise en œuvre, ainsi que l’élaboration de la feuille de route d’ECCC sur l’intelligence artificielle en vue d’améliorer les prévisions météorologiques et environnementales. Grâce à une approche transparente et structurée des avis scientifiques, le ministère a la capacité de traiter efficacement des questions d’ordre scientifique, ce qui accroît la confiance du public dans le processus décisionnel au sein d’ECCC.
Un Conseil des sciences renouvelé a été mis en place en 2023-2024 au sein de la Direction générale des sciences et de la technologie afin de conseiller les cadres supérieurs en matière de priorités scientifiques et de priorités de recherche. Au cours de la dernière année, le Conseil, composé de chefs de file en matière d’opinion scientifique de l’ensemble de la Direction générale, s’est penché sur les activités scientifiques et les domaines émergents, comme le récent rapport sur l’Arctique du Conseil des académies canadiennes (CAC); l’élaboration d’une stratégie de mobilisation en milieu universitaire pour la DGST; la Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC; la reconnaissance de l’excellence en science au sein de la direction générale et du ministère; et les résultats du Réseau de conseillers scientifiques ministériels (CSM).
2.2 Rendre possibles la prévision et la projection des conditions météorologiques, des événements extrêmes et des conditions environnementales dans un climat changeant
Les événements météorologiques à fort impact tels que les inondations, les vagues de chaleur, les feux de forêt, les tornades et la mauvaise qualité de l’air peuvent entraîner des conséquences désastreuses. La DGST contribue de manière continue à renforcer la capacité du ministère à prévoir les risques météorologiques et environnementaux et à fournir des avertissements à la population, des renseignements essentiels pour la gestion des urgences et la prise de décisions quotidiennes par la population canadienne.
Les chercheurs de la DGST contribuent à 35 systèmes opérationnels de prévisions météorologiques et environnementales numériques, ce qui a mené à plus d’une centaine d’innovations visant à améliorer les prévisions météorologiques et environnementales – un appui essentiel à des organisations comme le Service météorologique du Canada. Certaines avancées notables comprennent l’amélioration de la résolution spatiale dans certains systèmes et l’amélioration des capacités prévisionnelles relatives à la glace en milieu marin.
Feux de forêt et événements extrêmes
L’année dernière (2023) a été marquée par une activité sans précédent de feux de forêt au Canada. La fumée des feux de forêt est une source majeure de pollution atmosphérique au Canada et, comme elle peut être transportée par le vent sur des milliers de kilomètres, elle entraîne des répercussions de grande portée qui vont au-delà des frontières et touchent des régions éloignées comme les États-Unis et l’Europe. Le modèle FireWork d’ECCC est un système de prévision de la qualité de l’air qui projette le mouvement de la fumée des feux de forêt en Amérique du Nord. Cette capacité s’est avérée précieuse en 2023, lorsque la fumée des feux canadiens a recouvert une grande partie du Canada et la majeure partie du nord et du nord-est des États-Unis. Des spécialistes des prévisions météorologiques de l’État du Maryland et de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont communiqué avec la DGST pour la remercier :
Au cours du mois de juin, le modèle FireWork a joué un rôle déterminant pour donner à notre État des indications sur la fumée. Le modèle FireWork est devenu notre principal guide numérique et s’est révélé le modèle le plus performant pour nos besoins. De nombreux spécialistes des prévisions sur la qualité de l’air dans l’est des États-Unis ont jugé ce modèle utile.
Au cours de la dernière année, les chercheurs de la DGST ont commencé à mettre au point un système d’attribution rapide des événements extrêmes, une initiative clé dans le cadre de la Stratégie nationale d’adaptation du Canada, afin de quantifier l’influence du changement climatique induit par l’action humaine sur les événements météorologiques extrêmes au Canada. Ce type d’information est essentiel pour étayer l’adaptation locale (par exemple, la conception des infrastructures reconstruites après un événement ou la planification des procédures d’intervention en cas de canicule) ainsi que pour améliorer la sensibilisation des Canadiens et Canadiennes aux effets des changements climatiques. Le nouveau système calcule automatiquement l’influence humaine sur le risque lié aux vagues de chaleur observées au Canada. Ce système sera ensuite développé pour utiliser de nouvelles simulations de modèles de haute résolution et pour prendre en compte d’autres types d’événements extrêmes, comme les précipitations abondantes. En 2023-2024, les chercheurs de la DGST ont également réalisé une étude exhaustive pour quantifier l’influence des changements climatiques imputables à l’action humaine sur la saison sans précédent de feux de forêt au Canada en 2023, en collaboration avec Ressources naturelles Canada.
Atelier sur la science Autochtone relative aux prévisions météorologiques
En octobre 2023, la DGST a soutenu un atelier d’orientation sur la science Autochtone relative aux prévisions météorologiques destiné à rapprocher les sciences Autochtones et occidentales afin d’améliorer les connaissances sur les conditions météorologiques et leurs incidences sur les cultures et les communautés Autochtones historiques et contemporaines. Des détenteurs du savoir Autochtone de tout le Canada ont participé à des séances sur les méthodes scientifiques Autochtones relatives aux prévisions météorologiques, à la météorologie et aux récoltes, à la différence entre les régimes climatiques et les incidences des phénomènes météorologiques violents. Les conclusions de l’atelier ont souligné l’importance de la collaboration et du respect mutuel entre les systèmes de connaissances scientifiques Autochtones et occidentaux pour une compréhension globale des conditions météorologiques, qui sont liées aux systèmes physiques et biophysiques ainsi qu’aux cultures humaines et à la santé. Un rapport d’atelier et un article de journal sont à venir. L’atelier était fondé sur le respect et l’adhésion aux principes du consentement libre, préalable et éclairé (CLPI) et de la propriété, du contrôle, de l’accès et de la possession (PCAP) des données, ce qui a permis d’établir de bonnes relations et de donner l’exemple pour les futures initiatives de rapprochement, de tressage et de tissage.
Mettre à contribution des progrès technologiques
Les chercheurs de la DGST ont tiré parti de l’intelligence artificielle (IA) pour générer le tout premier ensemble de données sur l’épaisseur de la glace de mer panarctique toute l’année. La diminution de la glace de mer sous l’effet du réchauffement climatique a suscité une hausse de l’intérêt commercial, mais aussi des risques pour la sécurité des utilisateurs des ressources maritimes. Ce nouvel ensemble de données permet de comprendre la rétroaction du climat arctique selon différentes échelles de temps, y compris la possibilité de prolonger le délai de prévision de la glace de mer en août-octobre, au plus fort de la saison de navigation dans l’Arctique.
Pour faire progresser l’utilisation de l’IA dans les capacités de prévisions météorologiques et environnementales d’ECCC, la DGST et le Service météorologique du Canada ont collaboré à l’élaboration de la première feuille de route de l’IA pour les prévisions météorologiques et environnementales. L’équipe d’experts interdisciplinaire d’ECCC a élaboré une feuille de route pour favoriser l’intégration de l’IA dans toute la chaîne de production des prévisions, qu’elles soient à la minute ou aux saisons complètes. La feuille de route, dont la publication est prévue pour le printemps 2024, stimule déjà des projets en cours d’élaboration.
2.3 Mieux comprendre la manière d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter pour un Canada résilient et carboneutre
Compte tenu des coûts et des impacts du réchauffement climatique sur l’environnement et les communautés, accroître la résilience est une priorité clé pour le Canada. La DGST joue un rôle clé pour favoriser la réduction des émissions, l’adaptation aux changements climatiques et la prise de décision axée sur les risques afin de répondre de façon stratégique aux effets des changements climatiques.
En partenariat avec les provinces, les territoires et les municipalités, la DGST compte 312 stations de surveillance de la pollution atmosphérique à long terme et 23 stations mesurant des concentrations de gaz à effet de serre à long terme partout au Canada.
Science du climat
Le rapport Science du climat 2050 : Priorités nationales en matière de science et de connaissances sur le changement climatique, publié au printemps 2024, fait suite à deux années d’un vaste engagement avec plus de 500 chefs de file, universitaires et experts du climat au sein des gouvernements, des secteurs et de la communauté scientifique canadienne du changement climatique. Il rassemble les points de vue de la science occidentale et Autochtone pour guider les efforts de coordination et de recherche en cours, essentiels à l’obtention de résultats scientifiques d’ici 2030. Servant d’étoile polaire aux personnes impliquées dans la science, les politiques et les programmes relatifs au changement climatique, il présente les actions prioritaires à prendre pour atteindre six objectifs sociétaux clés essentiels à un Canada résilient et carboneutre d’ici 2050. Un chapitre dédié du rapport souligne l’importance de la science Autochtone, de la création d’un système scientifique équitable et de l’apprentissage de la relation sacrée des peuples Autochtones avec la terre, l’eau et la glace.
En 2023-2024, ECCC a élaboré et validé un nouvel inventaire hybride des émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières en amont du Canada. Des travaux antérieurs avaient fait état d’écarts importants entre les estimations des émissions déclarées et les estimations des émissions atmosphériques (jusqu’à +90 %). À l’aide d’observations aériennes, la DGST a procédé à des mises à jour méthodologiques du Rapport d’inventaire national et les a validées par rapport aux observations atmosphériques à long terme. Le nouvel inventaire hybride d’ECCC et les estimations établies dans l’atmosphère concordent à 10 % près. Il a également été démontré que les estimations établies dans l’atmosphère fournissent des mesures de référence fiables pour les émissions de méthane dans l’Ouest canadien et que les observations atmosphériques continues et la modélisation inverse permettront de faire le suivi de la réduction des émissions attendue de la réglementation actuelle et future du gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de réduction de 75 % du méthane pour l’industrie pétrolière et gazière.
Le Canada a réussi à nommer et faire élire un expert canadien indépendant au bureau du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour le septième rapport d’évaluation (AR7) (en anglais seulement), et les représentants de la DGST ont participé activement aux réunions du GIEC afin de veiller à ce que le programme de travail de l’AR7 réponde aux besoins du Canada. L’expertise de la DGST et de ses partenaires a également été sollicitée pour définir la portée de rapports à venir tels que le Rapport méthodologique sur les agents de forçage climatique à courte durée de vie (Methodology Report on Short-Lived Climate Forcers) (en anglais seulement) et le Rapport spécial sur les changements climatiques en milieu urbain (Special Report on Climate Change and Cities) (en anglais seulement).
Continuer à soutenir la réduction des émissions
Au cours de la dernière année, la DGST a poursuivi diverses initiatives en vue d’appuyer les efforts continus du ministère pour réduire les émissions. L’Inventaire des émissions de carbone noir, dressé chaque année, a continué d’évaluer les progrès réalisés pour réduire les émissions de carbone noir, contribuer à l’atténuation des changements climatiques, dissiper les préoccupations pour la santé humaine et atteindre l’objectif ambitieux et collectif du Conseil de l’Arctique (en anglais seulement). En outre, le Rapport d’inventaire national, importante publication fréquemment citée de la DGST qui remonte à 1994, a fourni des renseignements cruciaux sur les estimations des gaz à effet de serre (GES) afin d’éclairer la prise de décision en matière de réduction des émissions et de réalisation des objectifs de carboneutralité. En complément de cet effort, le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES), qui recueille des données en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a poursuivi sa collecte de données sur les émissions provenant d’installations situées dans tout le pays. Le PDGES permet un suivi cohérent et précis des émissions de GES afin d’étayer les politiques relatives aux changements climatiques, aux activités industrielles et à l’utilisation de l’énergie.
2.4 Orienter la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature et améliorer la résilience des écosystèmes et les services connexes
La perte généralisée et de plus en plus rapide de la biodiversité menace les fonctions et les services écosystémiques essentiels à la vie sur Terre. Les activités de la DGST sont axées sur l’amélioration des résultats pour la biodiversité au moyen de partenariats importants avec les peuples Autochtones et s’inspirent des perspectives de rapprochement, de tressage et de tissage de la science Autochtone avec la science occidentale.
En 2023-2024, la DGST a collecté des échantillons dans 346 sites de biosurveillance au Canada, y compris de nombreux échantillons prélevés en partenariat avec les provinces, les territoires et Parcs Canada.
En 2023-2024, la DGST a surveillé plus de 400 zones de croissance des mollusques au Canada afin d’assurer une récolte de mollusques sûrs pour le commerce interprovincial et international dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM). La surveillance et les autres activités liées au PCCSM, comme les enquêtes sur les sources de pollution et la modélisation des interventions en cas d’urgence (comme des phénomènes météorologiques extrêmes), ont également contribué à une récolte sans danger des mollusques à des fins alimentaires, sociales et rituelles, et récréatives par la population Autochtone.
En 2023-2024, la DGST a collecté 8744 échantillons dans 996 sites de surveillance de la qualité de l’eau dans tout le Canada. Bon nombre d’échantillons ont été collectés avec des partenaires externes, y compris les provinces et les territoires. Les activités de surveillance de la DGST soutiennent des initiatives, comme le projet de surveillance des pesticides avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. L’exercice 2023-2024 était la dernière année de ce projet pilote collaboratif qui visait à étayer le modèle de risque de l’ARLA, une composante essentielle des règlements régissant la commercialisation et l’utilisation des pesticides au Canada.
Conserver et restaurer la biodiversité
La DGST a lancé un projet qui analyse les données sur les polluants tirées de l’Inventaire national des rejets de polluants et de Pêches et Océans Canada dans l’habitat essentiel du béluga dans l’estuaire du Saint-Laurent. Cette intégration de données exhaustive vise à évaluer les effets potentiels, directs et indirects, de ces substances sur la population en danger de bélugas, de sorte à contribuer aux efforts de conservation et de rétablissement de l’espèce. Ce travail reposait sur l’approche élaborée par la DGST pour évaluer les contaminants préoccupants qui pénètrent dans l’habitat essentiel de l’épaulard résident du Sud dans le bassin du fleuve Fraser.
Le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal (GBF) cherche à freiner et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 et à restaurer la biodiversité d’ici 2050. Le GBF propose quatre objectifs à long terme et 23 cibles qui nécessitent les meilleurs avis scientifiques disponibles pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace. Afin d’explorer les thèmes précis compris dans les cibles et les objectifs du GBF, la DGST a convoqué plusieurs rencontres virtuelles de groupes consultatifs scientifiques regroupant des experts du milieu universitaire, des organisations Autochtones, des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales et de l’industrie. Les rencontres ont été l’occasion d’explorer des thèmes précis compris dans les cibles et les objectifs du GBF. Après ces rencontres et d’autres initiatives récentes en matière de biodiversité, cette équipe multisectorielle a rédigé un rapport qui énonce 78 besoins scientifiques spécifiques aux cibles et 4 possibilités transversales pour aider le Canada à mettre en œuvre le GBF. Pour mobiliser l’information, la DGST a organisé un forum scientifique d’une journée en janvier 2024 de façon à faire des rapprochements entre les scientifiques et les décideurs politiques et à examiner comment la science peut favoriser l’atteinte des cibles du GBF.
La DGST est la correspondante nationale pour la participation du Canada à la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). La DGST a dirigé la délégation canadienne lors de la dixième séance plénière de l’IPBES à Bonn, en Allemagne, dans le cadre de laquelle une évaluation importante de l’incidence mondiale des espèces exotiques envahissantes (en anglais seulement) et un résumé à l’intention des décideurs politiques ont été approuvés, en plus d’un plan de travail ambitieux pour l’avenir. Le Canada a également réussi à nommer des experts dans les divers groupes de travail de l’IPBES et à participer à l’établissement de la portée de la Deuxième évaluation mondiale des services visant les écosystèmes et la biodiversité (en anglais seulement). La DGST a élargi la participation et l’apport d’experts des scientifiques fédéraux et a mobilisé une expertise canadienne plus vaste et des connaissances Autochtones pour soutenir les travaux de l’IPBES.
Au Canada, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène présente des risques et des coûts importants pour la santé des espèces sauvages, la biodiversité, les moyens de subsistance, la sécurité et la sûreté alimentaires (y compris les aliments prélevés dans la nature), l’économie et la santé du bétail, et affiche des risques croissants pour la santé humaine. Dans le cadre d’une approche « Une seule santé » visant à optimiser la santé des animaux, des personnes et de l’environnement, les chercheurs de la DGST se sont associés à des collaborateurs fédéraux, provinciaux, territoriaux et internationaux ainsi qu’à des organisations Autochtones pour offrir un programme scientifique interdisciplinaire qui soutient une approche « Une seule santé » fondée sur des données probantes dans la lutte contre les épidémies. En 2023-2024, les activités sous « Une seule santé » se sont centrées sur la coordination et la mise en œuvre d’activités de surveillance des maladies, dont la détection des anticorps, l’évaluation de la mortalité des oiseaux sauvages et des répercussions sur la population, l’intégration des données et des connaissances, l’analyse épidémiologique et les avis d’experts dans de nombreux comités et groupes de travail inter-institutions.
Encourager la science citoyenne
Les scientifiques de la DGST participent à de nombreuses initiatives qui soutiennent la science citoyenne. Le Réseau canadien de biosurveillance aquatique (RCBA), un réseau collaboratif de biosurveillance dirigé par ECCC, soutient l’évaluation citoyenne de la santé des écosystèmes d’eau douce à l’aide de protocoles normalisés, d’outils accessibles sur le Web et de formations. En 2023-2024, ECCC a continué d’offrir une formation assortie d’une attestation en biosurveillance aquatique, organisée par l’Institut canadien des rivières de l’Université du Nouveau-Brunswick. Ce programme novateur combine des modules de formation en ligne et sur le terrain. Les modules en ligne fournissent des conseils sur la saisie des données, l’analyse et l’établissement des rapports. La formation sur le terrain qui est donnée dans un environnement fluvial avec des formateurs RCBA certifiés, propose une expérience pratique de la collecte de macroinvertébrés benthiques et de données sur l’habitat fluvial selon les protocoles du RCBA.
Soutenir les pratiques d’intendance Autochtone et la surveillance collaborative
La DGST collabore à la recherche sur les jardins de palourdes ou Loxiwe, avec la communauté Wei Wai Kum Kwiakah, une ancienne pratique d’intendance Autochtone qui permet d’accroître la productivité des palourdes et autres mollusques ou de créer un nouvel habitat dans les plages intertidales. Le projet associe les sciences Autochtones et occidentales tout en respectant les droits et la souveraineté des nations Autochtones et en donnant un aperçu de la sécurité alimentaire, de la conservation de la biodiversité et de l’adaptation aux changements climatiques.
En 2023-2024, les partenaires du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM – ECCC, Agence canadienne d’inspection des aliments et Pêches et Océans Canada) ont collaboré avec les Nations des Gwa’sala—’Nakwaxda’xw pour mettre à l’essai la surveillance de la qualité de l’eau, les enquêtes sur les sources de pollution et la surveillance des biotoxines dans des zones d’intérêt le long du littoral de la Colombie-Britannique. Cette initiative a encouragé la collaboration et favorisé la connaissance des besoins des nations pour améliorer l’accès à des sources sûres et durables de mollusques à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Le PCCSM tire parti de cette expérience et d’autres expériences avec les Premières Nations pour orienter la modernisation du programme.
L’année dernière, la DGST a soutenu l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau programme pratique de certificat de technicien de marine Autochtone dans le cadre des Partenariats communautaires pour l’intervention maritime l’initiative du Plan de protection des océans. L’objectif du programme est de soutenir la préparation et l’intervention aux situations d’urgence locales, de préparer les participants à surveiller le milieu marin et à renforcer la participation Autochtone au système de sécurité maritime.
2.5 Soutenir la protection de l’environnement maintenant et à l’avenir
La science de la DGST et la mise en œuvre d’initiatives obligatoires de collecte de renseignements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) permettent de relever, de mieux comprendre et d’atténuer l’incidence des activités et des infrastructures gouvernementales, ainsi que les risques évolutifs de la pollution et des substances nocives dans l’environnement. Les activités scientifiques de la DGST orientent aussi l’élaboration de mesures d’intervention d’urgence et de gestion des risques qui contribuent à protéger les personnes et l’environnement.
En 2023-2024, la DGST a répondu à plus de 1350 demandes de renseignements et reçu plus de 450 commentaires du public concernant le Plan de gestion des produits chimiques.
Les chercheurs de la DGST ont assuré un suivi auprès de plus de 7000 installations ayant déclaré plus de 300 substances dans l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement canadien.
Les responsables du Programme des substances nouvelles de la DGST ont répondu à 722 demandes de renseignements relatives à de nouvelles substances et ont réalisé l’évaluation des risques pour 231 produits chimiques et polymères. Dans le cadre du Programme des substances existantes, 7 évaluations définitives des risques ont été publiées.
Protéger les espaces verts et la faune en milieu urbain
La science de la DGST est à l’avant-garde dans la compréhension du rôle essentiel des espaces verts urbains pour faciliter la migration et les autres étapes importantes du cycle de vie des oiseaux nicheurs de la région boréale. En collaboration avec des partenaires universitaires, la DGST mène des recherches concertées dans toutes les disciplines pour quantifier les effets de la perte d’infrastructures vertes sur le bien-être humain et la biodiversité. Cette recherche intervient à un moment critique où la construction de nouveaux logements pour répondre aux besoins d’une population de plus en plus urbanisée constitue une priorité des pouvoirs publics. La recherche sur les collisions d’oiseaux menée par la DGST a également éclairé la version révisée de la Stratégie pour un gouvernement vert, en particulier son objectif de réduire les impacts d’oiseaux avec les bâtiments fédéraux. Cet effort contribue à atténuer les effets négatifs des activités gouvernementales sur la faune.
Protéger les Canadiens et l’environnement contre les substances chimiques
La modernisation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) constitue une étape décisive pour garantir la sécurité et la santé de l’environnement et des personnes vivant au Canada. La DGST a contribué aux travaux scientifiques qui ont orienté les modifications apportées à la LCPE et continuera à innover pour appuyer sa mise en œuvre. Par exemple, la DGST s’est associé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre d’un projet visant à évaluer le risque d’exposition aux polluants environnementaux des communautés Autochtones situées dans la forêt boréale du Québec. En 2023-2024, les investissements dans l’Inventaire national des rejets de polluants de la DGST étaient axés sur l’amélioration de la qualité des données, l’ajout de fonctionnalités aux outils de visualisation des données et la mise à jour de plusieurs produits d’information adaptés à une diversité d’utilisateurs. 2023 marque la 30e année de communication des données dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), et l’événement a été souligné par une promotion sur les médias sociaux et la publication d’une chronologie interactive de l’INRP. Pour se conformer aux nouvelles obligations de transparence relatives aux organismes vivants prévues dans la LCPE, le Programme des substances nouvelles a tenu des périodes de consultation publique pour quatre lignées de poissons génétiquement modifiés et une lignée de mouches des fruits génétiquement modifiées. Grâce en partie à l’analyse scientifique de la DGST, ECCC a obtenu gain de cause dans une poursuite contre une entreprise pour non-conformité aux normes d’émission en vertu de la LCPE.
En collaboration avec des collègues de la Direction générale de la protection de l’environnement et de Santé Canada, la DGST a élaboré l’ébauche du Rapport sur l’état des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), qui a été publié pour commentaires en mai 2023. Appelés « produits chimiques éternels », les SPFA se retrouvent dans tous les secteurs de l’environnement (air, eau, poissons et faune) et sont couramment présents dans les produits de la vie courante. Ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des personnes et de la faune, notamment sur les fonctions organiques, les systèmes immunitaires et nerveux, la reproduction et la croissance. Le Canada a proposé l’ajout d’un sous-groupe de SPFA, connu sous le nom d’acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à longue chaîne), dans la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Ce travail important oriente les mesures prises par le Canada pour protéger les gens et l’environnement contre les effets des polluants, y compris le soutien à des programmes de recherche et de surveillance plus holistiques, et pour réduire le remplacement des substances nocives par des alternatives qui ne sont pas encore connues pour être nocives.
La recherche de la DGST continue de contribuer à l’avancement du Programme zéro déchet de plastique du Canada. Grâce à la production et à l’évaluation des données, la DGST a appuyé plusieurs initiatives d’ECCC vouées à réduire la pollution plastique, y compris un avis de planification de prévention de la pollution (P2) pour les emballages alimentaires primaires en plastique.
Réduire la pollution atmosphérique transfrontière
Depuis 1991, le Canada et les États-Unis ont réduit l’incidence de la pollution atmosphérique transfrontalière conformément à l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. En 2023-2024, la DGST et ses collègues de la Environmental Protection Agency des États-Unis ont établi les fondements scientifiques d’un examen exhaustif et d’une évaluation qui ont lieu tous les cinq ans dans le cadre de l’Accord. Le rapport d’examen et d’évaluation se sert des données de surveillance et des résultats de modélisation pour évaluer les progrès accomplis dans la réduction des pluies acides et de l’ozone troposphérique, ainsi que pour évaluer les effets transfrontaliers des particules fines (PM2,5), qui ne font pas partie de l’Accord à l’heure actuelle. Le rapport recommande d’actualiser les engagements de réduction d’émissions pour les pluies acides et l’ozone troposphérique et d’envisager l’ajout d’engagements pour les PM2,5. L’examen et l’évaluation serviront de fondement à la renégociation proposée de l’Accord, qui débutera en 2024, une occasion d’approfondir la collaboration pour réduire la pollution atmosphérique transfrontalière et ses effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine.
Continuer à soutenir la protection de l’eau
En 2023-2024, la DGST a continué à fournir un soutien scientifique déterminant pour les politiques et les programmes de conservation et de protection de l’eau douce, des côtes et des océans. Le programme national de surveillance à long terme de la qualité de l’eau de la DGST une obligation légale en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada depuis 1970, analyse l’état et les tendances de la qualité de l’eau, y compris en partenariat avec les provinces et les territoires. Ce programme appuie des initiatives comme le Plan d’action sur l’eau douce, le Plan d’action Saint-Laurent, le Programme de surveillance des sables bitumineux, l’Initiative de protection des baleines et le Plan de gestion des produits chimiques.
Pour orienter les activités de surveillance de l’eau douce et la prise de décisions objectives, la DGST a conçu et continue d’appliquer un Cadre de gestion adaptative fondé sur les risques. Cette approche modernisée et fondée sur la science s’appuie sur les risques et les vulnérabilités des écosystèmes et répond aux nouveaux enjeux et aux exigences organisationnelles. Le Cadre de gestion s’adapte grâce à un cycle continu d’améliorations pour assurer la pertinence et l’efficacité continues des activités de surveillance, y compris la détermination des zones à risque élevé dans les sous-bassins d’eau douce du Canada.
Au cours de la dernière année, la DGST a également fait progresser diverses sous-initiatives dans le cadre du Plan de protection des océans. Les activités ont compris l’organisation d’un colloque technique sur les déversements d’hydrocarbures marins dans l’Arctique et plus particulièrement sur la prévention, l’évaluation et le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et d’autres matières dangereuses dans l’Arctique. Deux évaluations du littoral ont été réalisées — la première en collaboration avec la Nation Cowichan dans la baie de Cowichan, en Colombie-Britannique, et la seconde avec la coopération avec la Garde côtière canadienne à Cornwall, en Ontario. La DGST continue également de fournir et d’améliorer les capacités d’échantillonnage et d’analyse pour contribuer aux interventions d’urgence, à la préparation aux situations d’urgence et à la gestion des épaves et des navires abandonnés.
3. La voie à suivre en 2024-2025
La DGST, et de façon plus générale la communauté scientifique d’Environnement et Changement climatique Canada, peut être fière de ses nombreuses réalisations au cours de la dernière année. Ces réalisations renforcent non seulement notre engagement permanent à préserver la qualité de l’environnement, à assurer la santé et la sécurité publiques et à respecter les mandats fédéraux et les accords à l’échelle mondiale, mais elles servent également à protéger notre environnement pour les générations à venir. Les défis environnementaux auxquels sont confrontés le Canada et la communauté mondiale sont de plus en plus complexes et pressants. En réalisant des progrès scientifiques et technologiques, en favorisant l’inclusion et la collaboration, en investissant dans notre main-d’œuvre et en optimisant la façon dont nous fournissons des conseils scientifiques pour servir de base de données probantes pour les politiques et les programmes, la DGST est prête à relever efficacement ces défis et à appuyer le ministère dans l’exécution de son mandat.
À l’avenir, les rapports annuels mettront en évidence les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC et souligneront le rôle et l’influence de la science dans tout le ministère. Nous demeurons déterminés à fournir les connaissances scientifiques dont le ministère et l’ensemble du gouvernement ont besoin pour relever les défis environnementaux de plus en plus complexes auxquels nous continuerons de faire face.