Rapport sur les résultats ministériels 2022 à 2023, Ministère de l’Environnement
De la part du ministre

L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
À titre de ministre de l’Environnement et du Changement climatique, je suis heureux de présenter le Rapport sur les résultats ministériels 2022-2023 d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
En 2022-2023, ECCC a continué de faire progresser des efforts pour favoriser la croissance propre, lutter contre les changements climatiques et s’adapter à leurs répercussions, prévenir et gérer la pollution, conserver et restaurer les milieux naturels, prévoir les conditions météorologiques et environnementales et mener à bien la vaste gamme de travaux scientifiques qui sont derrière toutes nos réussites.
Le Rapport souligne le travail mené par ECCC pour s’attaquer à la triple crise des changements climatiques, de l’appauvrissement de la biodiversité et de la pollution, en collaboration avec les provinces et les territoires, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les communautés autochtones et les organismes jeunesse.
Prise de mesures à l’égard de la croissance propre et des changements climatiques
La science est claire : la réduction de la pollution par le carbone pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050 est notre meilleure chance de léguer une planète habitable à nos enfants et à nos petits-enfants. En 2022-2023, ECCC a publié le Plan de réduction des émissions, une feuille de route ambitieuse et réaliste qui décrit la voie à suivre pour que le Canada atteigne son objectif de réduire ses émissions de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Nous avons continué de mettre en œuvre l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone et avons lancé la toute première Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA) : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, qui établit une vision commune de l’adaptation aux changements climatiques au Canada et les mesures à prendre pour y parvenir. La SNA présente une approche globale et inclusive axée sur le développement de systèmes climato-résilients grâce à des efforts d’adaptation et d’atténuation.
De plus, ECCC a appuyé la participation du gouvernement du Canada à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2022, la COP27, qui s’est déroulée en Égypte, de même que les résultats ambitieux obtenus pour maintenir à portée de main l’objectif de l’Accord de Paris de limiter la hausse des températures à 1,5 °C et soutenir les populations les plus vulnérables au monde, grâce à la conclusion d’un accord historique sur les pertes et dommages.
La présence marquée du Canada lors de cette importante conférence sur le climat a mis en évidence notre leadership et notre détermination à l’égard d’une action climatique inclusive et efficace, tant au pays qu’à l’étranger. Les efforts internationaux visant à faire avancer les priorités climatiques et environnementales ont également été soutenus par l’ambassadrice pour les changements climatiques.
Prévention et gestion de la pollution
La réduction de la pollution par les plastiques et l’investissement dans l’innovation au Canada font partie du plan global du gouvernement du Canada pour protéger l’environnement et bâtir une économie plus forte et des communautés plus saines.
En 2022–2023, ECCC a continué de faire avancer le Programme zéro déchet de plastique du Canada et les mesures réglementaires et non réglementaires connexes. Nous avons interdit la fabrication et l’importation de cinq des six catégories de plastiques à usage unique nocifs au Canada. Grâce à cette interdiction et à nos progrès vers l’adoption d’un traité mondial, nous nous joignons à l’effort planétaire visant à réduire la pollution plastique et à protéger nos espèces sauvages et leurs habitats.
Nous avons également continué d’axer nos efforts sur l’amélioration, la restauration et la protection des plus importantes ressources d’eau douce du Canada.
De plus, ECCC a appuyé le travail de ses partenaires fédéraux clés, à savoir Santé Canada et le Conseil national de recherches du Canada, afin de protéger l’environnement et les Canadiens contre les substances nocives et de réduire les polluants atmosphériques extérieurs, en mettant en œuvre le système de gestion de la qualité de l’air et en travaillant sur la scène internationale à réduire la pollution atmosphérique transfrontalière qui a des répercussions au Canada.
Conservation de la nature
ECCC a continué de bâtir des partenariats et de faire progresser l’atteinte des objectifs du Canada en matière de conservation des terres et des eaux intérieures et la protection et le rétablissement des espèces en péril.
Par le biais de partenariats et des organismes consultatifs avec les Premières nations, les Inuits et les Métis, ECCC a continué à faire progresser la réconciliation autochtone en planifiant et en travaillant à établir plusieurs aires protégées sous la direction des Autochtones. Ensemble, nous allions les systèmes de connaissances autochtones à la science occidentale pour la conservation, la recherche et la surveillance sur le terrain de la biodiversité et des changements climatiques au Canada.
De plus, ECCC a accueilli en 2022 la Conférence des Parties (COP15) à Montréal, et a contribué à la négociation d’un accord mondial sur la biodiversité en signant l’Accord Canada-Yukon sur la nature... le premier accord du genre qui favorisera la conservation et la protection de la nature dans l’ensemble du territoire et qui appuiera le leadership autochtone en matière de conservation.
Toujours lors de la COP15, le Canada a adhéré au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal – un cadre historique visant à préserver la nature, à freiner l’appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance, ainsi qu’à placer la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050.
Prévisions météorologiques et environnementales
ECCC a continué de fournir des services ininterrompus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de ses centres de prévisions météorologiques, en informant rapidement les Canadiens de tout phénomène météorologique violent et en leur fournissant des renseignements sur les niveaux et les débits d’eau en temps réel, en plus de collaborer avec les organisations de gestion des urgences.
Également en 2022, ECCC a fièrement présenté l’aperçu de la saison des ouragans au Canada afin de donner le coup d’envoi à la saison des ouragans et d’insister sur l’importance de s’y préparer, en plus d’organiser diverses séances d’information technique à l’intention des médias pour communiquer aux Canadiens les plus récents renseignements sur l’ouragan Fiona.
Je vous invite à lire le Rapport sur les résultats ministériels 2022-2023 d’ECCC pour en savoir plus sur les contributions faites par le Ministère pour améliorer l’environnement, la prospérité et la santé de tous les Canadiens. En tant que ministre, j’ai bien hâte de m’appuyer sur ces importantes réalisations dans les années à venir.
______________________________________________
L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Aperçu des résultats
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
En décembre 2022, le Canada et près de 200 autres pays ont conclu un accord sur le plan de mise en œuvre de Charm el-Cheikh lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue à Montréal. Parvenir à un accord sur le plan de mise en œuvre était une étape essentielle pour l’ambition climatique dans le cadre de l’Accord de Paris. Cet accord historique a créé un fonds destiné à aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux pertes et dommages causés par les changements climatiques. Le Canada a également lutté avec ardeur pour que le monde ne recule pas en ce qui concerne l’abandon progressif des subventions aux combustibles fossiles et du charbon, qui demeurent les principales sources d’émissions de CO2.
À l’époque, le gouvernement a également annoncé de nouvelles mesures ambitieuses pour soutenir la réalisation des objectifs du Canada en matière de gaz à effet de serre (GES). Ceci inclut le plafonnement et la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050, tout en permettant au secteur d’être compétitif dans une économie mondiale qui s’efforce d’atteindre les objectifs suivants :
- devenir carboneutre d’ici 2050;
- réduire les émissions de méthane générées par le secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 pour cent d’ici 2030;
- parvenir à un réseau électrique carboneutre d’ici 2035.
Le Plan de réduction des émissions (PRÉ) pour 2030 du Canada, publié le 29 mars 2022, a présenté une feuille de route sectorielle permettant au Canada d’atteindre son objectif de réduction des émissions en 2030, soit de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, et de mettre en place les éléments nécessaires pour parvenir à des émissions carboneutres d’ici 2050. En 2022-2023, ECCC a travaillé avec plusieurs autres ministères fédéraux pour lancer et coordonner la mise en œuvre de ce plan climatique. ECCC a fait progresser les principales mesures du PRÉ pour 2030 qui relèvent de sa compétence, notamment :
- l’élaboration d’une approche pour plafonner et réduire les émissions de GES provenant du secteur pétrolier et gazier pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050;
- la publication de projets de règlements qui fixent des objectifs de vente de véhicules à zéro émission (VZE) pour les fabricants et les importateurs de nouvelles voitures de tourisme, de SUV et de camionnettes, exigeant qu’au moins 20 % des nouveaux véhicules vendus au Canada soient à émission zéro d’ici 2026, au moins 60 % d’ici 2030, et 100 % d’ici 2035;
- la prise de mesures pour réduire les émissions de méthane du pétrole et du gaz d’au moins 75 % d’ici 2030, et passer à un réseau électrique carboneutre d’ici 2035.
En 2022-2023, ECCC a également continué la mise en œuvre de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Cette initiative majeure comprend :
- la mise en place d’un Système fédéral de tarification fondé sur le rendement pour les émetteurs industriels;
- l’évaluation des systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone par rapport aux normes nationales minimales en matière de rigueur (modèle fédéral);
- la finalisation du règlement sur le Système fédéral de crédits compensatoires pour les GES, qui encourage les réductions et les absorptions rentables de gaz à effet de serre provenant d’activités qui ne sont pas couvertes par la tarification du carbone, y compris dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des déchets.
Le Ministère a également finalisé la règlementation sur le carburant propre et publié un Modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada.
La première Stratégie nationale d’adaptation du Canada a été publiée le 24 novembre 2022 pour une période de consultation finale. La Stratégie reflète les deux années de collaboration avec les principaux secteurs clés : les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux; les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis; les principaux experts et intervenants; et tous les citoyens du Canada. La Stratégie établit une vision commune de la résilience climatique au Canada, détermine les grandes priorités d’une collaboration accrue et établit un cadre servant à mesurer les progrès à l’échelle nationale.
Prévenir et gérer la pollution
En 2022-2023, ECCC a continué à diriger les efforts déployés à l’échelle du gouvernement pour soutenir la transition vers une économie circulaire du plastique. Il s’agit d’élargir les connaissances sur les plastiques dans l’environnement et l’économie, d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de gestion, de soutenir l’innovation et la transformation du marché, de prévenir et de réduire la pollution par le plastique et de réduire les déchets provenant des activités fédérales.
En juin 2022, le gouvernement a publié le Règlement interdisant les plastiques à usage unique (RIPUU), qui interdit six catégories de plastiques à usage unique nocifs pour l’environnement et difficiles à recycler. Les premières interdictions en vertu du RIPUU, pour 5 des 6 catégories, sont entrées en vigueur en décembre 2022 : sacs de magasinage en plastique, ustensiles, récipients alimentaires en plastique, bâtonnets à mélanger et pailles. La seconde interdiction, concernant les anneaux pour emballage de boissons, entrera en vigueur en 2023. ECCC a également continué à travailler avec ses partenaires provinciaux et territoriaux au sein du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) pour mettre en œuvre le Plan d’action pancanadien visant l’atteinte de zéro déchet de plastique.
Le gouvernement a de plus lancé des consultations sur des propositions de réglementation en matière de contenu recyclé, des propositions de règles sur l’étiquetage de la recyclabilité et de la compostabilité, et une proposition de registre fédéral sur les plastiques. Il a aussi commencé à travailler au niveau fédéral et avec d’autres pays et parties prenantes, notamment en tant que membre inaugural de la Coalition de Haute Ambition pour mettre fin à la pollution plastique, afin d’élaborer un accord mondial ambitieux et efficace, juridiquement contraignant, sur la pollution plastique d’ici 2024.
Le Projet de loi S-5 : Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, a reçu la sanction royale le 13 juin 2023. Le projet de loi modernise la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE) et représente la première série de modifications globales de la LCPE depuis son adoption il y a plus de 20 ans. Avec ce projet de loi, le gouvernement du Canada tient son engagement de renforcer la LCPE et de reconnaître, pour la première fois dans une loi fédérale, que chaque personne au Canada a droit à un environnement sain.
Afin de protéger l’environnement et les Canadiens des substances nocives, ECCC a continué à collaborer avec Santé Canada pour mettre en œuvre le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. En date du 31 mars 2023, les deux ministères ont traité 4144 des 4363 substances chimiques identifiées en 2006 comme prioritaires. En 2022-2023, le programme du PGPC a publié 17 rapports finaux d’évaluation des risques et cinq instruments finaux de gestion du risque.
Le Ministère a également continué à protéger l’eau en administrant et en appliquant les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches et ses règlements connexes. Cela incluait notamment le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier. En outre, ECCC a établi les bases de la modernisation du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier ainsi que des modifications du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent et le lac Winnipeg comptent parmi les ressources en eau douce les plus importantes du Canada. En 2022-2023, ECCC a continué à concentrer ses efforts sur l’amélioration, la restauration et la protection de ces plans d’eau et d’autres grands plans d’eau. Les efforts ont consisté à entreprendre les travaux scientifiques nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau et conserver et améliorer les écosystèmes aquatiques dans ces bassins hydrographiques vitaux.
En 2022-2023, ECCC a également continué à travailler avec ses principaux partenaires fédéraux (y compris Santé Canada) pour lutter contre la pollution de l’air. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les incidences sur la santé et l’environnement. ECCC a continué à collaborer avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) afin de réduire la pollution de l’air extérieur au Canada et a travaillé au niveau international pour continuer à réduire la pollution atmosphérique transfrontalière qui affecte le Canada.
Conservation de la nature
Le 20 décembre 2022, le Canada et 195 autres pays membres se sont mis d’accord sur le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming lors de la COP15 à Montréal. Ce cadre mondial historique est conçu pour préserver la nature, arrêter et renverser la perte de biodiversité et mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050. Le cadre reflète et soutient les principaux objectifs du Canada : protéger 30 % des terres et des eaux d’ici 2030, respecter les droits et les rôles des peuples autochtones et s’attaquer aux principaux facteurs de perte de biodiversité, tels que la pollution et la surexploitation de la nature.
Le Canada a pris de nouveaux engagements et fait de nouveaux investissements importants en matière de conservation de la nature au cours de la COP15 :
- 800 millions de dollars pour soutenir jusqu’à quatre initiatives de conservation menées par des autochtones qui, une fois achevées, pourraient protéger jusqu’à un million de km2 supplémentaires;
- signature de l’Accord sur la nature entre le Canada et le Yukon, qui vise à promouvoir la conservation et la protection de la nature sur l’ensemble du territoire et à soutenir le leadership autochtone en matière de conservation;
- fonds nouveaux et supplémentaires de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à protéger la nature;
- 255 millions de dollars destinés à des projets qui aident les pays en développement à bâtir un avenir solide, notamment en luttant contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes.
En 2022, le Ministère a désigné Edéhzhíe comme réserve nationale de faune en plus de son statut d’aire protégée Dehcho. Edéhzhíe est une région vierge des Territoires du Nord-Ouest qui revêt une grande importance pour les Premières Nations du Dehcho. Il s’agit d’un sanctuaire culturel pour les Dénés du Dehcho, d’un habitat essentiel pour le caribou boréal et le bison des bois, et d’une aire importante pour la sauvagine et d’autres oiseaux migrateurs.
En novembre 2022, le Ministère a annoncé l’octroi de 34,1 millions de dollars pour le rétablissement et la protection de certaines des espèces les plus emblématiques du Canada dans tout le pays. À ce jour, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont identifié six espèces prioritaires communes : le caribou boréal, le caribou des montagnes du Sud, le caribou de Peary, le caribou des toundras, le Tétras des armoises et le bison des bois.
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
La stratégie nationale Stratégie canadienne de l’observation de la Terre par satellite a été publiée en 2022. Annoncée par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, la stratégie est actuellement mise en œuvre pour fournir des données essentielles afin de soutenir l’agriculture, la santé, la protection de l’environnement, les prévisions météorologiques, la sécurité et les applications de mesures d’urgence.
En 2022-2023, les systèmes de prévision météorologique, de diffusion et d’alerte précoce à la fine pointe de la technologie d’ECCC ont continué d’alerter les Canadiens des conditions météorologiques à fortes répercussions à l’approche, tels que les tempêtes violentes, les vagues de chaleur, les rivières atmosphériques et les ouragans. Les météorologues du Ministère ont continué de concentrer leur attention sur les tempêtes susceptibles d’affecter le Canada et d’émettre des avertissements en fonction de la trajectoire, de la localisation et de l’intensité d’un événement météorologique.
Au cours de l’année, ECCC a réalisé de nouveaux progrès dans la mise en œuvre du programme de remplacement des radars météorologiques canadiens du gouvernement du Canada, d’une valeur de 131 millions de dollars, qui, une fois achevé, remplacera la technologie obsolète par de nouveaux radars. 26 nouveaux radars ont déjà été installés et sept autres ont été mis en place dans plusieurs collectivités du Canada en 2022-2023.
En 2022-2023, les Services hydrologiques nationaux d’ECCC ont continué à moderniser et à renforcer leurs capacités techniques et d’ingénierie ainsi que leur infrastructure hydrométrique, et à mettre en place de nouvelles technologies pour collecter et analyser les données sur l’eau. Le gouvernement fédéral a ainsi finalisé un investissement de 90 millions de dollars sur cinq ans.
Pour de plus amples renseignements sur les plans, les priorités et les résultats obtenus d’ECCC, consultez la section « Résultats : ce que nous avons accompli » du présent rapport.
Résultats : ce que nous avons accompli
Responsabilités essentielles
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
DescriptionNote de bas de page 1
Par une collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les parties prenantes et des experts externes, le Ministère soutiendra et coordonnera la mise en œuvre du cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques; s’employer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES); mener la croissance propre; élaborer des instruments réglementaires; soutenir les entreprises et les Canadiens pour s’adapter et devenir plus résilients aux changements climatiques; et contribuer aux mesures prises sur le plan international pour les changements climatiques pour augmenter les avantages globaux.
Résultats
Résultat ministériel : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de courte durée
En 2022-2023, ECCC a continué à mettre en œuvre et à renforcer les engagements climatiques du Canada en élaborant de nouveaux règlements pour atteindre les objectifs de véhicules à zéro émission, augmenter les réductions des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier et atteindre une production d’électricité carboneutre. Les changements climatiques demeurent un défi fondamental pour le Canada et le monde, avec des répercussions importantes sur l’environnement, l’économie et le bien-être social. La science est claire : les émissions mondiales doivent atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Plus tôt le Canada prendra des mesures pour lutter contre les changements climatiques, plus il pourra réduire efficacement les risques et protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Comme les investisseurs, les consommateurs et les gouvernements fondent de plus en plus leurs décisions sur la durabilité de l’environnement, il est essentiel d’agir maintenant pour le climat si l’on veut tirer parti de cette occasion économique.
En tant que membre du Conseil de l’Arctique, le Canada s’est engagé à produire un inventaire annuel des émissions de carbone noir. Ce rapport annuel est amélioré régulièrement et sert à informer les Canadiens au sujet des émissions de carbone noir et à fournir des renseignements inestimables pour l’élaboration de stratégies de gestion de la qualité de l’air.
ECCC s’efforce d’aider le Canada à atteindre l’objectif de réduction des émissions fixé par le gouvernement pour 2030, à savoir 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, et de poser les jalons pour parvenir la carboneutralité d’ici à 2050. En collaboration avec d’autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les partenaires autochtones, ce travail se concentre sur la mise en œuvre des mesures incluses dans le plan de réduction des émissions (PRÉ) pour 2030. Le respect des compétences constitutionnelles partagées en matière d’environnement est resté un pilier fondamental de l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de ces questions.
ECCC s’engage à renforcer les partenariats entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones dans le domaine du climat. Parmi les faits marquants de la période 2022-2023, on trouve :
- un retour aux réunions en personne des tables bilatérales sur la croissance propre et les changements climatiques avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, après plusieurs années de réunions virtuelles en raison de la pandémie;
- la publication, en juillet 2022, du quatrième rapport annuel du premier Comité mixte Premières Nations-Canada sur l’action climatique (CMAC) au premier ministre et au chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN). Le CMAC offre une occasion unique aux représentants du gouvernement fédéral et des Premières Nations de travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un modèle de partenariat pour l’action climatique, afin de construire ensemble un avenir inclusif, propre et prospère. Les Premières Nations sont touchées de manière unique et disproportionnée par les changements climatiques. Elles sont confrontées à une augmentation des menaces causées par les feux de forêts, le dégel du pergélisol, l’évolution des habitudes des espèces sauvages, la diminution de l’accès aux sources d’alimentation traditionnelles et les inondations. Leurs expériences et leurs connaissances en matière d’environnement et de changements climatiques sont diverses et uniques. C’est pourquoi les systèmes de connaissances, l’autodétermination et les droits des Premières Nations continuent d’être de plus en plus pris en compte dans l’élaboration de toutes les politiques et programmes fédéraux sur le climat;
- l’annonce conjointe, en décembre 2022, avec le Canada et la Colombie-Britannique, d’un investissement pouvant aller jusqu’à 600 000 dollars du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin d’aider les nations de Kwadacha et Heiltsuk à créer et à développer leur capacité de transformation de produits biologiques. Les nations contribueront également à hauteur de près de 150 000 dollars chacune pour leurs projets, qui consisteront à réduire les émissions en compostant les déchets organiques au sein des communautés et réduiront la quantité de déchets qui doivent être transportés de ces deux communautés éloignées des Premières Nations vers les décharges. Le projet créera également des emplois locaux et du compost de classe A pour stimuler la production alimentaire locale.
En 2022-2023, ECCC a également entrepris un certain nombre d’efforts pour impliquer et intégrer de plus en plus les connaissances autochtones dans la science du climat. Le Ministère a :
- lancé et dirigé une série de séminaires intitulée Voix Autochtones à l’échelle du gouvernement, avec plus de 500 participants;
- soutenu la participation de représentants et d’universitaires à un grand nombre de ses délégations et forums internationaux, tels que la 27e Conférence des parties (COP27) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 15e Conférence des Parties (COP15) lors de la Convention sur la diversité biologique et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC);
- présenté le travail de la division scientifique autochtone d’ECCC, ainsi qu’un panel d’experts autochtones sur le caribou et l’ours polaire lors de la COP27;
- fait progresser l’intégration des connaissances et des renseignements scientifiques autochtones et occidentaux afin d’améliorer l’efficacité du processus décisionnel dans le cadre du programme de surveillance des sables bitumineux, grâce à un co-dirigeant efficace.
Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité
La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité a reçu la sanction royale en juin 2021, ce qui confère une force juridique à la réalisation de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 et exige du gouvernement qu’il fixe des objectifs nationaux en matière de GES à intervalles de cinq ans, chaque objectif étant fixé au moins dix ans à l’avance. La loi établit également dans la législation de manière formelle le Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC), un groupe diversifié d’experts qui fournira au ministre de l’Environnement des conseils pour parvenir à la carboneutralité. Le GCPC a soumis son premier avis annuel au ministre en décembre 2022, et le ministre a officiellement répondu à cet avis en avril 2023.
Le premier Plan de réduction des émissions du Canada en vertu de la loi a été publié en mars 2022. Il met en évidence les mesures prises pour atteindre l’objectif du Canada pour 2030 et place le Canada sur la voie pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La loi assure la responsabilité et la transparence du processus de responsabilité climatique en exigeant du gouvernement du Canada qu’il donne la possibilité aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux peuples autochtones, au Groupe consultatif pour la carboneutralité et au public de présenter des observations dans le cadre de l’élaboration d’un objectif ou d’un plan.
En 2022-2023, le Canada a lancé le Défi carboneutre pour encourager les entreprises ayant des activités au Canada à élaborer des plans crédibles et efficaces pour faire passer leurs installations et leurs activités à la carboneutralité d’ici 2050. Le programme a été lancé en août 2022 par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, avec 12 participants initiaux, et s’est étendu à 68 entreprises participantes en mars 2023. Les entreprises participantes bénéficient de conseils techniques, de meilleures pratiques, d’une communauté d’entreprises homologues et de la possibilité de souligner leur engagement à atteindre la carboneutralité. Le Défi carboneutre utilise des niveaux de participation pour encourager et reconnaître l’ambition et la rigueur dans la planification de la carboneutralité.
En 2022-2023, ECCC a également continué à s’appuyer sur l’action et les engagements fédéraux du Canada en matière de climat, en mettant l’accent sur les objectifs de carboneutralité. Ce travail comprenait :
- la publication du Règlement sur les combustibles propres;
- la mise en place d’un mandat de vente pour que 100 % des nouveaux véhicules légers vendus au Canada soient carboneutres d’ici 2035;
- la soumission de la stratégie à long terme actualisée du Canada, y compris les scénarios carboneutres pour 2050, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC);
- la publication de La stratégie canadienne sur le méthane qui offre une voie pour réduire davantage les émissions de méthane provenant de toute l’économie;
- l’engagement à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 % d’ici 2030;
- la poursuite de l’élimination progressive du réseau électrique alimenté au charbon d’ici 2030;
- l’élaboration d’une réglementation sur l’électricité propre afin de parvenir à un réseau carboneutre d’ici 2035.
Au cours de l’année 2022-2023, le Canada a soutenu l’achèvement réussi du sixième cycle d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avec la publication du rapport de synthèse du sixième cycle d’évaluation en mars 2023. Ce rapport éclaire la prise de décision du Canada en matière de politique climatique, tant au niveau national qu’international, en fournissant l’évaluation scientifique la plus récente, la plus complète et la plus fiable des changements climatiques, de leurs répercussions et risques généralisés, ainsi que des mesures nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques et les atténuer.
ECCC a également facilité la participation de plus de 20 auteurs principaux au sixième rapport d’évaluation et a joué un rôle de premier plan au sein du bureau du GIEC et du bureau du Groupe de travail sur les inventaires nationaux de GES. ECCC a également veillé à ce que les contributions du Canada au sixième rapport d’évaluation tiennent compte d’un large éventail de points de vue en s’engageant avec d’autres ministères fédéraux, des provinces et des territoires, des organisations autochtones nationales et des partenaires internationaux dans le cadre de l’examen et de l’approbation des rapports de synthèse. De nombreux autres scientifiques canadiens ont contribué au sixième rapport d’évaluation du GIEC en tant qu’auteurs, experts et réviseurs gouvernementaux, et en tant que délégués canadiens aux réunions du GIEC.
À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse (le 12 août 2022) ECCC a annoncé sa première cohorte du Conseil jeunesse sur l’environnement et les changements climatiques (CJECC). Le CJECC est un groupe de 10 jeunes qui offrent des conseils sur des questions environnementales et climatiques clés afin d’éclairer les décisions du gouvernement du Canada. Les membres ont participé à diverses activités pour partager leurs points de vue et leurs idées, notamment la COP27 du CCNUCC en Égypte, la COP15 lors de la Convention sur la diversité biologique à Montréal et la Conférence des Nations Unies sur l’eau à New York. Le CJECC a fourni des conseils sur les changements climatiques, la conservation de la nature, les communications sur le climat et la Stratégie nationale d’adaptation et a mené et engagé des dialogues avec les jeunes sur l’éducation au climat et la biodiversité.
La Stratégie à long terme (SLT) pour la carboneutralité
En octobre 2022, le gouvernement du Canada a présenté à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sa Stratégie à long terme L’exploration des approches pour le passage du Canada à la carboneutralité. S’appuyant sur les efforts déployés par le Canada dans le cadre du PRÉ, la SLT présente plusieurs possibilités qui pourraient permettre au Canada d’atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050.
ECCC, en collaboration avec Ressources naturelles Canada (RNCan), a lancé en juillet 2022 des consultations officielles sur un engagement clé du PRÉ 2030 du gouvernement. Plus précisément, le PRÉ définit une approche pour lutter contre les changements climatiques tout en créant des emplois et en bâtissant une économie forte pour les générations à venir, en se concentrant sur le plafonnement et la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier. Cette phase d’engagement a fait suite à plus de six mois de réunions préliminaires avec les principales parties intéressées. Le secteur pétrolier et gazier est la plus grande source d’émissions de GES au Canada et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Pour que la production canadienne demeure concurrentielle dans le marché resserré de l’avenir, il faudra en avoir baissé l’intensité en carbone, et le secteur devra explorer les possibilités de passer à des produits et à des services n’entraînant pas d’émissions. La réduction des émissions de pétrole et de gaz est essentielle pour atteindre les objectifs du Canada en matière d’émissions et pour mener une action significative en faveur du climat. Cela permettra également de créer une croissance économique durable et à long terme et fournira une énergie propre et abordable. Au cours de la période de consultation officielle, le gouvernement du Canada a reçu plus de 25 000 observations écrites en réponse au document de discussion sur le PRÉ et a organisé un certain nombre de webinaires d’information avec les parties intéressées.
Lors de la COP27 en Égypte, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a indiqué que le plafond d’émissions était élaboré selon un calendrier accéléré, tout en tenant compte de la nécessité d’un engagement significatif. L’engagement avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, l’industrie, les organisations non gouvernementales et d’autres Canadiens s’est poursuivi jusqu’au printemps 2023.
L’électrification d’un plus grand nombre d’activités (des véhicules au chauffage et à la climatisation des bâtiments en passant par divers processus industriels) sera nécessaire pour que le Canada passe à la carboneutralité d’ici 2050. Pour ce faire, le Canada doit à la fois augmenter son approvisionnement en électricité et veiller à ce que toute la production d’électricité soit carboneutre. En juillet 2022, le gouvernement a publié un cadre réglementaire et a collaboré avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, ainsi qu’avec l’industrie et la société civile, afin de contribuer à l’élaboration des règlements.
ECCC a annoncé en avril 2022 son intention d’élaborer des lignes directrices qui obligeront les promoteurs de nouveaux projets de production de pétrole et de gaz à se soumettre à une évaluation d’impact fédérale afin de démontrer leur exemplarité en matière de performance en faibles émissions. En tant que contributeur important à l’économie et principale source d’émissions de GES au Canada, le secteur pétrolier et gazier a un rôle essentiel à jouer dans l’atteinte des objectifs climatiques du Canada. Pour demeurer concurrentiels sur un marché mondial qui délaisse les combustibles fossiles afin de lutter contre les changements climatiques et d’améliorer la sécurité énergétique, les nouveaux projets de production pétrolière au Canada assujettis à une étude d’impact fédérale devront respecter des normes encore plus strictes. Les nouveaux projets devront présenter des performances en matière d’émissions (la quantité de pollution par les GES nécessaire à la production d’un baril de pétrole ou d’un mètre cube de gaz naturel) qui soient les meilleures de leur catégorie, et tous les futurs projets pétroliers et gaziers devraient être carboneutres d’ici 2050.
Les nouvelles directives d’ECCC expliquent comment les promoteurs de nouveaux projets pétroliers et gaziers assujettis à une étude d’impact fédérale devraient utiliser l’analyse requise par l’évaluation stratégique des changements climatiques du gouvernement du Canada pour démontrer que leurs projets seront « exemplaires », par exemple :
- identifier les meilleurs rendements en matière d’émissions en comparant les projets proposés aux projets de premier plan au niveau mondial (y compris au Canada) dans le cadre de la même activité que le projet proposé;
- démontrer dans quelle mesure, à quel moment et de quelle manière le projet atteindra un rendement exemplaire des émissions;
- décrire comment le projet restera exemplaire tout au long de sa durée de vie et carboneutre d’ici 2050.
En 2022-2023, ECCC a poursuivi la mise en œuvre de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Cette initiative se concentre sur le renforcement des normes nationales minimales (modèle fédéral) pour tous les systèmes de tarification du carbone pour la période 2023-2030, y compris une trajectoire d’augmentation du prix de la pollution par le carbone à partir de 65 dollars par tonne d’équivalent dioxyde de carbone (éCO2)Note de bas de page 2 en 2023, et augmentant de 15 dollars par an jusqu’à 170 dollars en 2030.
L’approche du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone donne aux provinces et aux territoires la possibilité de mettre en œuvre des systèmes de tarification de la pollution par le carbone adaptés à leur situation, conformément aux exigences du modèle fédéral. Le gouvernement du Canada met en œuvre le filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone dans les administrations qui le demandent ou qui n’auront pas adopté de régime conforme aux exigences du modèle fédéral. Le système fédéral comporte une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles et système d’échange fondé sur le rendement pour l’industrie, le Système de tarification fondé sur le rendement.
Groupe consultatif pour la carboneutralité
En vertu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le GCPC est un organisme consultatif externe nommé par le gouverneur en conseil et chargé de fournir au ministre de l’Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Par l’intermédiaire d’un secrétariat spécialisé, ECCC fournit un soutien logistique, administratif et politique au GCPC, notamment en planifiant et en réalisant les activités du groupe consultatif, et en produisant ses rapports annuels et ses plans d’entreprise.
ECCC a également lancé le règlement sur le Système de crédits compensatoires pour les GES du Canada en juin 2022. Mesure clé du plan canadien de réduction des émissions à l’horizon 2030, le régime de crédits compensatoires encouragera les réductions rentables et significatives des émissions de GESNote de bas de page 3 provenant d’activités qui ne sont pas couvertes par la tarification du carbone, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des déchets. Le système de crédits compensatoires offrira aux municipalités, aux aménagistes forestiers, aux agriculteurs, aux communautés autochtones et à d’autres des mesures incitatives axées sur le marché pour entreprendre des projets innovants qui réduisent les GES en empêchant les émissions et en éliminant les GES dans l’atmosphère. Dans le cadre du système, les participants inscrits peuvent réaliser des projets en suivant un protocole fédéral de crédits compensatoires, qui définit une approche cohérente pour mesurer les réductions d’émissions ou les absorptions de GES pour des types de projets spécifiques. Ces projets peuvent générer un crédit compensatoire échangeable pour chaque tonne d’émissions de GES qu’ils réduisent ou éliminent de l’atmosphère. Il n’existe aucune limite quant aux personnes qui peuvent acheter des crédits compensatoires fédéraux pour les GES. Les crédits compensatoires peuvent être vendus et utilisés à des fins de conformité par des installations couvertes par le Système de tarification fondé sur le rendement, ou vendus et utilisés par d’autres entreprises, des gouvernements ou des particuliers pour atteindre des objectifs ou des engagements volontaires en matière de climat tels que des objectifs d’entreprise de carboneutralité.
De plus, en novembre 2022, le gouvernement a annoncé les montants des paiements de l’Incitatif à agir pour le climat pour l’année à venir dans les provinces qui ont adopté l’approche fédérale. Les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat sont la manière dont le gouvernement du Canada reverse directement aux ménages le produit de la tarification de la pollution. La fixation d’un prix pour la pollution par le carbone reste le moyen le plus efficace et le plus rentable de lutter contre les changements climatiques en incitant les particuliers, les ménages et les entreprises à choisir des options moins polluantes et en stimulant l’innovation dans les technologies propres. En réalité, pour huit Canadiens sur dix qui reçoivent des paiements de l’Incitatif à agir pour le climat, le système fédéral de tarification de la pollution se traduit par une augmentation de leurs revenus.
ECCC a continué de mettre en œuvre la réglementation visant à réduire les émissions de GES provenant des secteurs du pétrole et du gaz, des transports, de l’électricité et d’autres secteurs industriels, lesquels contribuent de façon importante aux émissions totales de GES au Canada. En juin 2022, ECCC a publié la version définitive du Règlement sur les combustibles propres (RCP), qui établit des exigences de plus en plus strictes pour les producteurs et les importateurs afin de réduire l’intensité en carbone de l’essence et du diesel. Le RCP adopte une approche fondée sur l’intensité en carbone tout au long du cycle de vie des combustibles, en tenant compte des émissions associées à toutes les étapes de la production et de l’utilisation des combustibles, de l’extraction à l’utilisation finale en passant par le traitement et la distribution. Les créateurs enregistrés, les fournisseurs étrangers et les contributeurs d’intensité en carbone peuvent utiliser le modèle d’analyse du cycle de vie des combustiblesNote de bas de page 4 du gouvernement du Canada dans le but de créer des crédits au titre du Règlement sur les combustibles propres. Le Règlement sur les combustibles propres permettra de réduire l’intensité en carbone du cycle de vie des combustibles liquides utilisés au Canada et favorisera également la production de combustibles plus propres afin de réaliser d’autres changements nécessaires pour la décarbonisation à long terme au Canada.
Une fois entièrement mis en œuvre, le RCP contribuera à réduire jusqu’à 26,6 millions de tonnes de pollution par les GES en 2030, soit environ la quantité de ceux actuellement générée par l’ensemble de l’économie canadienne en deux semaines. Le gouvernement s’attend à ce que le RCP crée d’importantes possibilités économiques dans le développement et l’utilisation de combustibles et de technologies propres. En adoptant des règlements qui mettent l’accent sur les émissions tout au long du cycle de vie des combustibles, le Canada suit des approches semblables qui existent déjà en Colombie‑Britannique, en Californie et en Oregon. Ces administrations ont profité de l’expansion des industries de technologies propres grâce à ces règlements.
En plus du Fonds pour les combustibles propres de 1,5 milliard de dollars du gouvernement, le RCP créera des incitatifs pour la production intérieure accrue de combustibles à faible intensité en carbone (comme l’éthanol). Cette mesure offrira des possibilités économiques aux fournisseurs de matières premières destinées aux biocarburants, comme les agriculteurs et les forestiers. Le Règlement aidera également les producteurs canadiens de combustibles à être concurrentiels sur le marché mondial de l’énergie propre en pleine expansion. De concert avec la tarification de la pollution et le plafonnement des émissions pétrolières et gazières à venir, le RCP contribuera également à diversifier les choix énergétiques et à promouvoir l’adoption plus rapide de VZE en encourageant le déploiement d’une infrastructure de recharge des véhicules. Les mesures supplémentaires prises en 2022-2023 pour atteindre les objectifs de réduction des émissions comprennent ce qui suit :
- la publication d’un projet de règlement en décembre 2022 qui fixe des objectifs de vente de VZE pour les fabricants et les importateurs de nouveaux véhicules, tels que les automobiles, les VUS et les camionnettes. Ce règlement exigera qu’au moins 20 % des véhicules neufs vendus au Canada soient à émission zéro d’ici 2026, au moins 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035;
- l’élaboration de normes d’émissions pour les véhicules lourds et leurs moteurs qui sont harmonisées avec les normes les plus strictes en Amérique du Nord et qui exigent que 100 % des ventes de véhicules moyens et lourds soient à zéro émission d’ici 2040 pour un sous-ensemble de types de véhicules (selon la faisabilité), avec des cibles provisoires pour 2030 et l’exploration de cibles provisoires pour le milieu des années 2020;
- Le renforcement de la réglementation canadienne sur les véhicules légers pour la période après 2026 par son harmonisation avec les nouvelles normes d’émissions proposées par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis au printemps 2023. Le Canada s’alignera également sur les normes de rendement les plus strictes en matière de GES en Amérique du Nord pour les véhicules moyens et lourds.
- La collaboration avec la Californie (par l’intermédiaire du récent protocole d’entente avec le Conseil californien des ressources en air) sur des mesures visant à promouvoir le transport écologique et la réduction des émissions de GES.
Projets du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone
Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) appuie des projets novateurs visant à encourager et à soutenir la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone au moyen de technologies propres, comme par des investissements dans les secteurs suivants :
- jusqu’à 17,5 millions de dollars du FEFEC fédéral et 28,5 millions de dollars du gouvernement du Québec pour appuyer Ciment Québec, dans le cadre du programme ÉcoPerformance, pour l’installation d’un nouvel atelier de broyage de ciment écoénergétique à l’usine de ciment de Saint-Basile;
- 2,8 millions de dollars dans le cadre du Programme de rénovation domiciliaire des Premières nations du Nord de SaskPower, auxquels s’ajoutent des contributions de plus de 1 million de dollars de SaskPower, pour appuyer la rénovation écoénergétique des maisons dans les collectivités des Premières Nations participantes;
- plus de 630 000 dollars pour appuyer l’installation de systèmes d’énergie solaire dans le cadre du Programme de mesurage net de SaskPower afin de permettre à la Première Nation de Cowessess de produire sa propre énergie verte. À cet investissement s’ajoute une contribution de plus de 240 000 $ de la Première Nation de Cowessess pour accroître sa capacité d’énergie verte dans la réserve.
Pour appuyer la lutte contre les changements climatiques à l’échelle du pays, ECCC a poursuivi sa mise en œuvre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) initial, qui fournit jusqu’à 2 milliards de dollars en financement pour réduire la pollution par le carbone. Plus précisément, en 2022‑2023, le Ministère a maintenu le FEFEC (jusqu’à concurrence de 1,4 milliard de dollars) en continuant de fournir un soutien pour encourager la lutte contre les changements climatiques dans les provinces et les territoires, en misant sur le déploiement de technologies éprouvées à faibles émissions de carbone qui permettront de réduire les émissions de GES d’ici 2030. Le Ministère a également continué à administrer le deuxième volet du FEFEC initial, le fonds du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, qui fournit près de 494 millions de dollars à l’appui de projets qui génèrent une croissance propre, réduisent les émissions de GES et aident le Canada à respecter ses engagements en vertu de l’Accord de Paris.
En 2022-2023, ECCC a travaillé à mieux communiquer les répercussions des changements climatiques et à améliorer les communications fondées sur la science. Ce travail comprenait un partenariat avec LaSciencedAbord pour son initiative climatique. LaSciencedAbord s’efforce de partager les meilleures données scientifiques disponibles pour lutter contre la désinformation sur les changements climatiques et améliorer la littératie climatique. En 2022-2023, le soutien d’ECCC a aidé l’initiative à bâtir un réseau d’organisations scientifiques et communautaires, à élaborer et à partager de l’information scientifique sur les changements climatiques et la santé et à diriger des recherches sur la façon dont les gens naviguent dans la mer de renseignements sur les changements climatiques et sur la valeur des sources d’information fiables.
En 2022-2023, le Canada a franchi une étape importante dans la lutte contre les émissions de méthane, avec la publication de la stratégie canadienne sur le méthane, intitulée « Plus vite et plus loin : La stratégie canadienne sur le méthane », en septembre 2022. La réduction des émissions de méthane est l’un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques à court terme. La Stratégie sur le méthane offre un moyen de réduire davantage les émissions de méthane dans l’ensemble de l’économie, tout en soutenant la technologie canadienne et en créant des emplois bien rémunérés. Elle s’appuie sur les progrès et les engagements existants du Canada, notamment le Plan de réduction des émissions pour 2030. Le Canada est le premier pays à s’être doté d’un règlement national sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier; il investit dans son secteur de calibre mondial des sciences et des technologies propres et il aide les autres pays à réduire leurs émissions de méthane. La Stratégie canadienne sur le méthane permet au Canada de continuer d’être un chef de file de la réduction des émissions de méthane au pays et de favoriser des réductions ambitieuses à l’échelle internationale. Le Canada continue de jouer un rôle actif dans les initiatives mondiales de réduction des émissions de méthane, notamment l’initiative mondiale sur le méthane, la Coalition pour le climat et l’air pur, l’Observatoire international des émissions de méthane et le Conseil de l’Arctique. La Stratégie sur le méthane décrit comment le Canada s’y prendra pour accomplir ce qui suit :
- prendre des mesures dans tous les secteurs de l’économie, y compris celui du pétrole et du gaz, pour réduire les principales sources d’émission de méthane;
- renforcer le secteur des technologies propres et fournir à l’industrie des outils pour réduire de façon rentable les émissions de méthane, tout en créant des emplois bien rémunérés;
- accroître les connaissances scientifiques et la capacité technique pour améliorer la détection, la mesure et la déclaration du méthane;
- respecter les cibles climatiques internationales au titre de l’Accord de Paris et de l’engagement mondial sur le méthane;
- solidifier son leadership international et fournir du financement, des outils et des pratiques exemplaires aux autres pays afin qu’ils réduisent leurs émissions.
Avantages de la réduction des émissions de méthane
La réduction des émissions de méthane peut également avoir des retombées positives sur la qualité de l’air et la santé publique dans le monde. De plus, le méthane contribue à la formation d’ozone troposphérique qui cause de graves problèmes de santé, comme une réduction de la fonction pulmonaire et les crises d’asthme, et est responsable d’un demi-million de morts prématurées sur la planète.
Grâce aux mesures décrites dans la Stratégie sur le méthane, le Canada réduira les émissions nationales de méthane de plus de 35 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2020. Cette réduction dépassera la cible de 30 % de l’Engagement mondial sur le méthane que le Canada a signé l’an dernier.
Lors de la COP27 en novembre 2022, le Canada a annoncé une coopération accrue avec les États-Unis pour réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier, en mettant l’accent sur le méthane. Le Canada s’est joint à la Déclaration commune des importateurs et des exportateurs d’énergie sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles, réaffirmant son engagement à réduire les émissions de méthane d’au moins 75 % d’ici 2030. Pour aider à atteindre ces objectifs, le Canada a publié un cadre de réglementation qui servira à éclairer les consultations et l’élaboration d’une réglementation plus stricte sur le méthane pétrolier et gazier. Il s’est également joint à l’Observatoire international des émissions de méthane pour aider à surveiller et à échanger les données sur les émissions de méthane recueillies par les satellites.
Le Ministère a continué d’administrer le Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat (FASC), une initiative de financement lancée en septembre 2020 qui investira environ 200 millions de dollars sur cinq ans. Le FASC appuie les projets canadiens qui contribuent à réduire les émissions de GES du Canada et à bâtir une économie durable carboneutre d’ici 2050.
Le FASC est soutenu par l’amende historique de 196,5 millions de dollars payée par Volkswagen pour avoir contourné les règles de protection de l’environnement du Canada, soit la plus importante amende environnementale de l’histoire du Canada. En 2022-2023, ECCC continuera d’utiliser les sommes versées dans ce fonds pour soutenir des initiatives environnementales dans le cadre de trois priorités : soutenir la sensibilisation des jeunes au climat et l’action communautaire pour le climat, faire avancer la science et la technologie dans le domaine du climat et soutenir les activités de recherche sur le climat menées par les groupes de réflexion et le milieu universitaire canadiens.
ECCC a annoncé en novembre 2022 que jusqu’à 58 millions de dollars du FASC seront investis dans 24 projets qui feront progresser la science et la technologie pour lutter contre les changements climatiques. Dirigés par 12 universités et une organisation non gouvernementale, ces projets renforceront les connaissances scientifiques du Canada et seront utilisés pour déterminer, accélérer et évaluer les mesures menant à la carboneutralité. Ces projets créeront également des emplois pour les Canadiens qui travaillent dans les domaines des sciences et de la technologie. Voici d’autres exemples d’initiatives financées.
- Un investissement de 5,9 millions de dollars dans Parlons sciences, qui mobilisera plus de 600 000 jeunes de partout au Canada dans la sensibilisation et l’action en matière de sciences du climat au moyen d’événements régionaux, de projets d’action, d’activités pratiques et d’une série de ressources numériques, notamment de l’information sur les carrières. En partenariat avec la Société royale du Canada (SRC), dont les membres du Collège des nouveaux chercheurs, artistes et scientifiques, Parlons sciences fait participer divers experts à l’élaboration d’événements pour les jeunes, à la formation de bénévoles et d’éducateurs, à des projets d’action et à des ressources. Toutes les activités et tous les événements de ce projet sont pertinents à l’échelle locale et seront accessibles aux enfants et aux jeunes de l’ensemble du pays.
- Le nouveau spectacle sur les mesures prises en matière de climat « Agir pour le climat » de Science Nord, qui a reçu un financement de 6 millions de dollars et a ouvert ses portes en juillet 2022. L’expérience théâtrale multimédia et immersive est l’un des éléments axés sur la prochaine génération du programme de sensibilisation global de Science Nord auprès des jeunes. Science Nord dirige une série de projets de sensibilisation à impact élevé pour mobiliser la prochaine génération de Canadiens dans les enjeux cruciaux des changements climatiques. Ces projets comprennent Agir pour le climat, des expositions itinérantes et une campagne numérique d’action climatique. Grâce à ces initiatives, Science Nord rejoindra deux millions de jeunes partout au Canada, ce qui améliorera leur compréhension des changements climatiques et les incitera à prendre des mesures pour réduire les émissions de GES.
- Le projet Inspiring Youth to Climate Action (Encourager les jeunes à agir pour le climat) du Halifax Discovery Centre, qui a reçu 6 millions de dollars et s’associera à 30 centres de sciences à l’échelle du pays pour mobiliser quelque 200 000 jeunes de chaque province et territoire afin de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques.
- Le projet Youth Climate Action Now (YouCAN) de la Clean Foundation, qui a reçu 4,5 millions de dollars pour mobiliser 70 000 jeunes et leur donner les moyens d’agir pour lutter contre les changements climatiques dans leur propre vie et leur collectivité, notamment en offrant un apprentissage professionnel à 2000 éducateurs pour leur donner des outils qui leur permettront de soutenir les jeunes dans leurs initiatives de lutte contre les changements climatiques.
- Le Projet 2050, ou défis communautaires pour le climat d’Éco Héros, qui a reçu 3,3 millions de dollars pour mobiliser 300 000 enfants âgés de 6 à 12 ans partout au Canada et les aider à prendre des mesures collectives à la maison, à l’école et dans leurs communautés.
Comme il est indiqué dans le nouveau plan climatique du Canada, Un environnement sain et une économie saine, ECCC a continué de travailler avec les partenaires fédéraux, les provinces, les territoires, les organismes de conservation, les peuples autochtones, le secteur privé et la société civile pour mettre en œuvre de nouveaux investissements dans les solutions climatiques axées sur la nature. Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont deux crises pour lesquelles des solutions intégrées et complémentaires sont à la fois cruciales et urgentes. Le Canada a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de solutions, en partie parce qu’il possède l’une des plus grandes réserves de carbone au monde dans ses vastes paysages de forêts, de milieux humides, de tourbières et d’autres écosystèmes riches en carbone. Les programmes financés en 2022-2023 dans le cadre de l’initiative globale du Fonds pour des solutions climatiques naturelles comprennent :
- 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour planter deux milliards d’arbres (dirigé par RNCan);
- 1,4 milliard de dollars sur 10 ans pour améliorer le potentiel de séquestration du carbone dans les terres humides, les tourbières, les prairies et les terres cultivées par l’intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN);
- 185 millions de dollars sur 10 ans pour établir le nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada).
En 2022-2023, ECCC a investi 41,1 millions de dollars dans 39 projets locaux du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN) partout au Canada afin de réduire les émissions de GES grâce à la protection, à l’amélioration de la gestion et à la restauration des écosystèmes. De plus, ECCC a investi 3,6 millions de dollars dans 22 projets stratégiques sectoriels du FSCAN afin de mobiliser les secteurs des forêts, de l’agriculture, du développement urbain, des mines et du pétrole et du gaz pour mettre à jour, élaborer et mettre en œuvre des politiques et des outils visant à réduire les émissions nettes de GES. Un autre montant de 3,6 millions de dollars a été investi dans 15 projets dans le cadre du volet Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones afin de renforcer leurs capacités et d’entreprendre des activités sur le terrain pour la restauration écologique, l’amélioration de la gestion des terres et la conservation. Quatre améliorations méthodologiques ont été apportées pour la consignation des solutions climatiques naturelles dans le Rapport d’inventaire national. Le nouveau plan climatique du Canada intègre les solutions climatiques naturelles comme l’un de ses cinq piliers. Il complète également les efforts internationaux du Canada, notamment dans les pays en développement où le Canada s’est engagé à verser au moins 20 % du financement prévu dans son engagement de financement climatique à des projets qui tirent parti de solutions climatiques naturelles produisant des avantages connexes pour la biodiversité.
Résultat ministériel : Les communautés, les économies et les écosystèmes canadiens sont plus résilients
En 2022-2023, le Centre canadien des services climatiques (CCSC) a continué de travailler avec des partenaires et des parties prenantes pour aider les Canadiens à accroître leur résilience aux changements climatiques. Les initiatives sont axées sur l’information, la formation, l’orientation et les ressources à l’appui de décisions éclairées en matière de climat. Le CCSC, en collaboration avec ses partenaires, a publié de nouveaux renseignements et de nouvelles fonctions sur Donnéesclimatiques.ca, notamment des données sur l’intensité, la durée et la fréquence (IDF), un indicateur de précipitations extrêmes, tenant compte des changements climatiques et la diffusion des projections de la Phase 6 du Projet d’intercomparaison de modèles couplé (CMIP6) pour la température, les précipitations et les indices connexes. Plusieurs améliorations et caractéristiques ont été ajoutées à la Carte des actions en adaptation (lancée en 2021 en collaboration avec RNCan) afin d’accroître sa fonctionnalité et sa convivialité et d’ajouter 75 nouveaux exemples de mesures d’adaptation.
Le CCSC a également lancé la série de conférences sur les services climatiques, qui vise à offrir une tribune aux experts des services climatiques de partout au pays afin qu’ils puissent partager leur travail et leur expertise avec un public non technique. Le CCSC a élaboré et mis à l’essai de nouvelles ressources d’apprentissage pour les publics autochtones et a offert des séances de formation personnalisées, dont un cours d’introduction sur l’utilisation des données climatiques pour les fonctionnaires fédéraux, et une formation ciblée pour les professionnels du secteur de la santé, les gestionnaires de sites contaminés et le secteur de l’énergie. Le CCSC a continué de fournir du soutien pour les demandes de renseignements reçues au Centre d’aide des services climatiques, répondant à plus de 700 clients de partout au Canada (une augmentation de plus de 35 % par rapport à 2021-2022), tout en maintenant des cotes élevées de satisfaction de la clientèle.
En 2022-2023, le CCSC s’est préparé pour entreprendre l’élaboration de la Stratégie relative aux données climatiques (SDC). La Stratégie est un engagement clé de la lettre de mandat 2021 du ministre d’ECCC, qui demande la création d’une stratégie visant à « s’assurer que le secteur privé et les collectivités ont accès à des données utiles sur le climat et pour orienter la planification et les investissements en infrastructure ». L’intention et la portée de cet engagement ont été explorées, de même que la structure de gouvernance pour la stratégie. Les travaux d’élaboration de la stratégie commenceront officiellement en 2023-2024.
ECCC a publié la première Stratégie nationale d’adaptation pour commentaires finaux en novembre 2022. La stratégie est le fruit de deux années de collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les principaux experts et intervenants, et les citoyens de tout le pays. Elle établit une vision commune de la résilience aux changements climatiques au Canada et s’appuie sur un ensemble de principes directeurs pour veiller à ce que les investissements et les solutions en matière d’adaptation au Canada soient justes, inclusifs et équitables. Elle rassemble des acteurs de l’ensemble du Canada par des priorités communes, une action cohérente et une approche tenant compte de l’ensemble de la société pour la réduction des risques liés aux changements climatiques. La Stratégie fixe des buts ambitieux et des objectifs à court terme dans cinq domaines qui sont essentiels pour renforcer la résilience climatique dans l’ensemble de la société:
- réduire les risques de catastrophes liées aux changements climatiques;
- améliorer les résultats en matière de santé et de bien-être;
- protéger et rétablir les milieux naturels et la biodiversité;
- construire et entretenir des infrastructures résilientes;
- favoriser une économie forte et appuyer les travailleurs.
ECCC a également continué de fournir des projections de modèles climatiques mondiaux et régionaux, en utilisant différents scénarios futurs d’émissions de GES et en assurant la diffusion aux utilisateurs et aux intervenants partout au pays pour éclairer la planification de l’adaptation, la conception de l’infrastructure et l’évaluation des risques. Cet effort continu est important pour veiller à ce que les décisions soient prises en fonction des plus récentes données scientifiques sur le climat.
Le Plan d’action pour l’adaptation du gouvernement du Canada a été publié en novembre 2022, parallèlement à la Stratégie nationale d’adaptation. Le Plan d’action est la contribution du gouvernement fédéral à la mise en œuvre de la Stratégie. Il énonce des mesures stratégiques et ciblées pour aider à atteindre les buts et les objectifs de la Stratégie. Le Plan d’action prévoit environ 1,6 milliard de dollars en nouveaux investissements, notamment pour la réduction des risques de feux de forêt et d’inondations, la construction d’infrastructures et de collectivités résilientes, la préparation de nos systèmes de santé aux changements climatiques et l’accélération de l’adaptation au sein de notre environnement et de notre économie.
En 2022-2023, ECCC s’est également associé au consortium Ouranos sur les changements climatiques pour planifier la septième série de conférences internationales Adaptation Futures, qui aura lieu à Montréal en octobre 2023.
Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture (le 29 septembre 2022) ECCC et Agriculture et Agroalimentaire Canada ont annoncé des investissements pouvant atteindre 1,4 million de dollars et 10 millions de dollars respectivement pour appuyer les initiatives de réduction des émissions de déchets de la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority Autorité régionale de gestion des déchets de La Redcliff Cypress) et de Purénergie Inc.
- La Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority (Autorité régionale de gestion des déchets de La Redcliff Cypress), située à Redcliff, en Alberta, réduira les émissions de dioxyde de carbone et de méthane en détournant les déchets organiques d’un site d’enfouissement grâce à une installation de traitement du compost.
- Purénergie Inc., dans le canton de Havelock, en Ontario, construira une installation de réacheminement des déchets qui détournera les déchets organiques d’un site d’enfouissement et les transformera au moyen d’un processus de digestion anaérobie pour produire du biogaz et des engrais.
Ce financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), qui investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et appuie l’adoption de technologies propres pour un large éventail de bénéficiaires partout au Canada.
De plus, en septembre 2022, ECCC a annoncé des investissements pouvant atteindre 250 millions de dollars sur quatre ans, dans le cadre du FEFEC, qui contribueront à rendre le chauffage plus abordable pour les familles de l’ensemble du pays. Axé sur les ménages à faible revenu, ce financement aidera les propriétaires qui utilisent actuellement du mazout domestique à se tourner vers des sources de chauffage plus abordables et plus écologiques, comme des thermopompes électriques. Étant donné le coût actuel de l’énergie, le remplacement du chauffage au mazout par une thermopompe pourrait permettre aux propriétaires de maison d’économiser des milliers de dollars par année en frais de chauffage.
Résultat ministériel : Le Canada contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la résilience mondiale aux changements climatiques
En plus de ses mesures nationales, le Canada a continué de jouer un rôle de chef de file pour faire progresser l’élimination progressive du charbon à l’échelle internationale. Le charbon est l’une des sources les plus importantes d’émissions de carbone et de pollution atmosphérique dans le monde, où la production d’électricité à partir du charbon a d’importantes répercussions négatives sur l’environnement et la santé. Environ 40 % de l’électricité mondiale (et 6 % de celle du Canada) provient de la combustion du charbon. En 2022-2023, le Canada coprésidait toujours l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon, une coalition de gouvernements (nationaux et infranationaux), d’industries, d’entreprises et d’institutions financières, codirigée par le Canada et le Royaume-Uni, qui sont déterminés à mettre fin aux émissions provenant du charbon à l’appui de la lutte mondiale contre les changements climatiques. Ensemble, les membres se sont engagés à éliminer progressivement près de 35 % de la capacité charbonnière totale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui représente environ 20 % de la capacité mondiale en charbon à l’extérieur de la Chine.
En novembre 2022, le Canada, de concert avec le Royaume-Uni, a annoncé la publication de Énergiser au-delà du charbon, le premier examen mondial sur l’état de l’élimination progressive du charbon, qui présentait l’expérience du Canada en matière de politiques d’élimination progressive du charbon et les efforts communautaires en vue d’une transition équitable de la production d’électricité à partir du charbon dans le comté de Leduc, en Alberta. La publication du rapport a marqué cinq années de progrès de la part de l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon, qui a annoncé que l’Alliance comptait maintenant plus de 165 membres et veille à une réduction de plus de 75 % de la production d’électricité à partir du charbon dans les pays membres de l’OCDE d’ici 2030. Plus de 30 institutions financières représentant plus de 17 billions de dollars d’actifs se sont jointes à l’Alliance, s’engageant à mettre en œuvre des politiques rigoureuses pour freiner le financement de l’énergie au charbon, conformément à la Campagne Objectif zéro des Nations Unies, la plus grande coalition mondiale d’organisations qui visent les objectifs de carboneutralité.
En plus des progrès réalisés par l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon, ECCC a annoncé deux nouvelles initiatives visant à aider les pays en développement à faire la transition vers l’énergie propre, lesquelles sont financées dans le cadre de l’engagement de financement climatique de 5,3 milliards de dollars du Canada :
- une contribution de 5 millions de dollars au Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est afin de soutenir l’élimination progressive du charbon en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam;
- une contribution de 5 millions de dollars à l’OCDE pour soutenir son programme de mobilisation de fonds et d’investissements consacrés à l’énergie propre.
Lors de la COP27, les représentants du Canada se sont battus pour que le monde ne recule pas en ce qui concerne l’abandon progressif des subventions aux combustibles fossiles et du charbon, lequel demeure la principale source d’émissions de CO2, et ont réitéré l’engagement du Canada à supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles d’ici 2023, soit deux ans plus tôt que l’échéance fixée par le Groupe des Vingt (G20). L’accord appelle également les banques multilatérales de développement et les institutions financières à réformer leurs pratiques, à assurer un meilleur accès au financement climatique et à concevoir des modèles opérationnels pour répondre de manière adéquate à l’urgence climatique mondiale.
Le Canada, avec près de 200 autres pays, a renforcé ses engagements climatiques à la COP27 en concluant un accord sur le Plan de mise en œuvre de Sharm el-Sheikh, la prochaine étape de l’ambition climatique en vertu de l’Accord de Paris. Les changements climatiques sont une crise mondiale qui touche tous les pays, mais pas tous également. Les pays en développement lancent des appels urgents à l’aide pour combattre les pires impacts pour lesquels ils sont les moins préparés. La COP a obtenu un résultat historique avec la création d’un fonds d’aide aux pays en développement particulièrement vulnérables aux pertes et aux dommages causés par les effets néfastes des changements climatiques.
À la COP27, le Canada a réaffirmé son engagement à aider les plus vulnérables du monde à lutter contre les effets des changements climatiques en annonçant plusieurs initiatives pratiques totalisant 84,25 millions de dollars dans le cadre de son engagement financier international de 5,3 milliards de dollars pour le climat et d’autres sources de financement. De plus, 24 millions de dollars seront investis dans des domaines critiques, comme les pertes et les dommages, l’accès au financement climatique et la gouvernance climatique, et 4 millions de dollars seront versés aux petits États insulaires en développement (PEID) des Caraïbes, dont le Bélize, la Grenade, la Guyane et Sainte-Lucie, pour les aider à réduire leurs émissions de méthane et à atteindre leur cible climatique en vertu de l’Accord de Paris. Le Canada est demeuré inébranlable dans son engagement, notamment en travaillant en partenariat pour atteindre l’objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains dès que possible.
Le Canada s’est engagé à verser 10 millions de dollars pour appuyer l’initiative des Systèmes d’alerte précoce face aux risques posés par le climat (CREWS). Ce financement fait partie de l’engagement renouvelé du Canada à l’égard du développement et de l’amélioration de Systèmes d’alerte précoce multi dangers dans les pays en développement. En finançant l’initiative CREWS, le Canada aide les pays particulièrement vulnérables aux catastrophes liées au climat et aux conditions météorologiques à avoir accès à des renseignements et à des services météorologiques et climatiques fiables. Le Canada a également annoncé qu’il se joignait à l’Initiative des pays les moins avancés (PMA) pour une adaptation et une résilience efficaces (LIFE-AR) , qui place les personnes et les collectivités au cœur des efforts d’adaptation aux changements climatiques. Des initiatives locales et reflétant la parité entre les sexes comme celles-ci sont au cœur de l’approche du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques.
Systèmes de données visant à aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques
En 2022-2023, le Canada a continué d’aider les pays partenaires à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques, à renforcer leur résilience et à faire la transition vers un avenir propre et à faibles émissions de carbone. Cette aide comprend un engagement de 4,5 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer les pays de l’Alliance du Pacifique (le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie) dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de MDV du climat. Les systèmes de MDV sont essentiels pour que les pays élaborent des politiques et des mesures d’atténuation solides et efficaces, car ils fournissent aux gouvernements des renseignements transparents, exacts et comparables sur les sources d’émissions.
Le Ministère a également octroyé 20 millions de dollars sur quatre ans pour aider quatre pays d’Afrique de l’Ouest (le Ghana, le Libéria, la Gambie et le Togo) à renforcer leurs systèmes nationaux de mesure, de déclaration et de vérification (MDV) du climat. Les systèmes MDV constituent une étape déterminante pour que les pays puissent élaborer des politiques et des mesures d’atténuation solides et efficaces, car ils fournissent aux gouvernements des renseignements transparents, précis et comparables sur les sources d’émissions.
En collaboration avec Développement économique Canada pour le Pacifique, ECCC a annoncé en novembre 2022 plusieurs initiatives pratiques totalisant 24 millions de dollars, qui répondent directement aux besoins et aux priorités des pays en développement. Financés dans le cadre de l’engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada pour le financement international de la lutte contre les changements climatiques, les projets répondent directement aux besoins et aux priorités des pays en développement dans trois domaines critiques :
- Pertes et dommages : Les contributions au mécanisme de financement du Bouclier mondial aideront à rendre les pays vulnérables aux changements climatiques plus résilients et à protéger la vie et les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles.
- Gouvernance climatique : Les contributions visant à aider les pays en développement à renforcer leurs capacités institutionnelles réelles pour faire progresser la mise en œuvre et la transparence de leur contribution déterminée au niveau national.
- Financement pour le climat : Avant la COP27, le Canada et l’Allemagne ont publié un rapport d’étape sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques. Il y est question des progrès collectifs à réaliser et des mesures clés à prendre par les pays développés pour respecter l’engagement de recueillir conjointement 100 milliards de dollars américains en financement climatique par an, dès que possible.
À la COP27 en novembre 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre de l’Environnement du Chili ont officiellement lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone. Il s’agit d’une initiative dirigée par le Canada qui demande à tous les pays d’adopter un régime explicite de tarification du carbone comme élément central de leurs stratégies climatiques. Ce partenariat informel des administrations engagées à l’égard de la tarification du carbone vise à élargir la tarification de la pollution en renforçant les systèmes existants et en favorisant les systèmes émergents.
Le Défi crée un forum de dialogue et de coordination pour accélérer l’adoption de la tarification du carbone à l’échelle mondiale. Les partenaires du Défi comprennent le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Chili et la Corée du Sud. L’Union européenne et des organisations internationales, dont l’Agence internationale de l’énergie et la Banque mondiale, soutiennent également cette initiative. À l’heure actuelle, environ 23 % des émissions mondiales de GES sont couvertes par la tarification du carbone. Le Défi mondial de la tarification du carbone vise à atteindre un objectif collectif de 60 % des émissions mondiales d’ici 2030.
En mai 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a accueilli la sixième réunion ministérielle sur l’action climatique (MoCA6) à Stockholm, en Suède. La réunion a eu lieu à mi-chemin entre la COP26 tenue à Glasgow à la fin de 2021 et la COP27 en Égypte à la fin de 2022. Le Canada a mis l’accent sur trois priorités clés :
- encourager les pays à planifier et à atteindre des objectifs accrus de réduction des gaz à effet de serre (appelés contributions déterminées au niveau national);
- protéger la biodiversité et la nature, une mesure essentielle à l’atteinte des objectifs climatiques collectifs;
- aider les pays en développement à contribuer aux solutions climatiques et à s’adapter aux effets des changements climatiques en atteignant l’objectif de 100 milliards de dollars en financement climatique d’ici 2023.
En 2022-2023, le Canada a continué de demander l’inclusion de dispositions environnementales ambitieuses, exhaustives et exécutoires dans ses accords de libre-échange avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), l’Inde, l’Indonésie, l’Ukraine et le Royaume-Uni. ECCC négocie des obligations visant à maintenir une gouvernance environnementale rigoureuse lors de la libéralisation du commerce et des investissements et s’engage à coopérer sur une gamme d’enjeux environnementaux mondiaux, notamment le commerce illégal des espèces sauvages, les pêches durables, la gestion forestière, les changements climatiques et les technologies propres. ECCC dirige la mise en œuvre de ces engagements dans le cadre des accords de libre-échange, des accords environnementaux et d’autres instruments de coopération bilatérale et régionale du Canada avec des partenaires commerciaux importants, notamment les États-Unis, le Mexique, le Chili, l’Union européenne, et des pays parties à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste.
En 2022-2023, le Canada a accueilli la 20e séance de la Commission de l’Accord de coopération environnementale entre les gouvernements du Canada et du Chili, à Santiago, marquant ainsi le 25e anniversaire de l’Accord de coopération environnementale Canada-Chili. Le Canada a codirigé des ateliers sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, a coprésidé un sommet sur les technologies propres pour l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et a fait progresser la coopération trilatérale concernant l’Accord États-Unis-Mexique.
Résultat ministériel : Les peuples autochtones participent à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques.
La mobilisation des peuples autochtones fait partie intégrante de l’approche d’ECCC pour s’acquitter de toutes ses responsabilités fondamentales, notamment la croissance propre et les changements climatiques. On retrouve des exemples des efforts déployés par le Ministère visant à mobiliser de façon significative les peuples autochtones dans la lutte contre les changements climatiques dans une grande partie des énoncés précédents, notamment :
- la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan de réduction des émissions pour 2030;
- le Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur l’action climatique;
- les investissements du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui vise à aider les Nations Kwadacha et Heiltsuk à établir et à accroître leur capacité de traitement de matières organiques;
- l’intégration du savoir autochtone à la science du climat, notamment dans le cadre de la série de séminaires pangouvernementaux intitulée Voix Autochtones;
- la représentation des peuples autochtones dans les délégations et les forums internationaux, comme la 27e Conférence des Parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies, et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GEIC);
- l’intégration des connaissances et des renseignements autochtones pour l’amélioration du Programme de surveillance des sables bitumineux;
- le renforcement des capacités et la réalisation d’activités sur le terrain pour la restauration écologique, la gestion des terres et la conservation par l’intermédiaire d’investissements dans les volets des Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones.
Il importe de souligner que les efforts du Ministère pour mobiliser de façon significative les peuples autochtones sont également au cœur de sa prestation et dans toutes ses responsabilités essentielles. Par conséquent, d’autres efforts notables sont présentés tout au long du présent rapport.
Analyse comparative entre les sexes plus
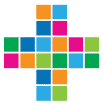
Il est bien connu que les changements climatiques au Canada exacerbent les défis actuels et les facteurs de stress pour la santé des peuples autochtones du Canada. Les changements climatiques ont également des répercussions disproportionnées sur les collectivités nordiques, rurales, éloignées et côtières, les générations plus jeunes et plus âgées, les personnes ayant des problèmes de santé ou des handicaps, les groupes à faible revenu, les femmes et les personnes combinant plusieurs de ces identités. ECCC continuera de tenir compte des répercussions de ses politiques, règlements et programmes sur les changements climatiques afin d’éviter, dans la mesure du possible, tout autre effet négatif sur les populations touchées. ECCC a préparé une analyse comparative entre les sexes plus qui est publiée à l’annexe 7 du Plan de réduction des émissions pour 2030. Le gouvernement continuera de mener une ACS Plus supplémentaire pour chaque initiative de politique, de réglementation et de programme afin de maximiser les avantages et de réduire au minimum les obstacles à l’accès aux initiatives, à la participation ou aux autres avantages pour les personnes les plus touchées par les effets négatifs des changements climatiques.
L’approche du Canada prévoit une tarification ambitieuse du carbone à l’échelle mondiale et retourne tous les produits du régime fédéral à l’administration d’origine. La plupart des produits sont retournés au moyen d’un système de remboursement aux ménages afin de réduire les coûts pour les Canadiens à faible revenu et marginalisés et de favoriser l’abordabilité. Une majoration de 10 % de ces paiements est accordée aux ménages des collectivités rurales et des petites collectivités. Les produits appuient également des secteurs clés, notamment les petites entreprises, les gouvernements autochtones et les agriculteurs. Dans le cadre du régime fédéral, une aide est offerte aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux résidents des collectivités rurales et des petites collectivités, aux utilisateurs de carburant aviation dans les territoires, aux exploitants de serres et aux centrales qui produisent de l’électricité dans des communautés éloignées.
Compte tenu des effets répandus et souvent disproportionnés des changements climatiques sur différents segments de la société, notamment leur capacité à exacerber les inégalités existantes et à aggraver les risques parmi les populations déjà touchées, ECCC a poursuivi son engagement auprès d’un ensemble diversifié et inclusif de partenaires pour éclairer l’élaboration de la Stratégie nationale d’adaptation. La Stratégie énonce une vision inclusive pour le Canada dans le contexte des changements climatiques et repose sur un ensemble de principes directeurs pour veiller à ce que les investissements et les solutions en matière d’adaptation au Canada soient justes, inclusifs et équitables. ECCC poursuit son engagement continu avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse dans le cadre de tables bilatérales de haut niveau pour appuyer l’autodétermination et permettre des solutions climatiques dirigées par les Autochtones. Sur le plan international, les considérations relatives à l’ACS Plus sont incluses dans la négociation et la mise en œuvre d’accords de libre-échange et sont intégrées aux activités bilatérales et régionales de coopération environnementale avec des partenaires internationaux. Le Canada continue également de mettre en œuvre le Plan d’action en faveur de l’égalité entre les sexes adopté en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Plan vise à accroître la participation et le leadership des femmes dans la lutte contre les changements climatiques et à mieux intégrer les considérations liées à l’égalité entre les sexes dans les plans et les politiques climatiques nationaux. Au cours des cinq prochaines années, 80 % du financement du Canada pour le climat ciblera également les résultats en matière d’égalité entre les sexes conformément à la Politique d’aide internationale féministe du Canada. En vertu de cette politique, les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements doivent intégrer l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes et des filles.
Objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030Note de bas de page 5 des Nations Unies

En présentant une vue d’ensemble des engagements et mesures du gouvernement fédéral en matière de durabilité environnementale, la Stratégie fédérale de développement durable de 2019 à 2022, élaborée et coordonnée par ECCC, s’inscrit dans le cadre de la réponse apportée par le Canada au Programme de développement durable des Nations unies. La poursuite de la mise en œuvre par ECCC d’activités qui lui permettent d’assumer sa responsabilité essentielle consistant à prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques contribuera directement à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable (ODD). Par exemple, la tarification de la pollution par le carbone et la mise en œuvre de divers règlements, notamment en ce qui concerne l’électricité propre et les VES, permettront de lutter efficacement et directement contre les changements climatiques et leurs conséquences en réduisant les émissions de GES et en stimulant les investissements dans l’innovation propre (objectifs 7 et 13); parallèlement, des initiatives telles que des incitations à l’action climatique et le financement de partenariats favoriseront une croissance économique inclusive et durable (objectif 8) et rendront les villes plus sûres et plus durables (objectif 11). Les infrastructures résilientes et les approches innovantes et inclusives du développement industriel seront soutenues grâce aux subventions du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (objectif 9), qui encouragera également les pratiques durables en matière de commerce, d’emploi et de consommation (objectif 12). Le Canada contribue également à la mise en place d’initiatives et d’accords internationaux efficaces en matière de changements climatiques en faisant pression pour que des mesures soient prises à l’échelle mondiale pour que l’Accord de Paris soit mis en œuvre (objectif 13). L’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques se concrétise par l’intermédiaire de divers partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que les banques multilatérales de développement, les fonds multilatéraux pour le climat, les organisations de la société civile et le secteur privé, et vise à soutenir les pays en développement dans leurs efforts d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements (objectif 17). L’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques est en phase avec sa Politique d’aide internationale féministe, et son approche inclusive met fortement l’accent sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles. ECCC continuera à travailler avec Emploi et Développement social Canada à la mise en œuvre, pour l’ensemble de la société, d’une Stratégie nationale pour le Programme 2030.
Ensemble, les initiatives d’ECCC forment une approche globale visant à faciliter la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone, à réduire les émissions de GES, à assurer une croissance propre et durable et à promouvoir l’innovation en matière de technologies et de procédés industriels, laquelle permettra de créer des industries et des emplois durables et d’améliorer la compétitivité du Canada. Les programmes d’ECCC aideront également les régions et collectivités à prévoir les effets des changements climatiques et à s’y adapter, afin d’atténuer les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être.
Dans le cadre du plan fédéral de mise en œuvre du Programme 2030, le gouvernement s’engage à considérer les ODD en suivant les principes liés aux droits de la personne et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones en respectant et en protégeant pleinement leurs droits. En 2021, la Loi [fédérale] sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale, obligeant tous les ministères à s’aligner dans leurs activités sur les droits énoncés dans cette déclaration. La mise en œuvre de cette loi par ECCC permettra d’établir des liens entre la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la protection et le respect des droits des peuples autochtones.
Pour en savoir plus sur les mesures qui sont liées à cette responsabilité essentielle et contribuent aux ODD des Nations unies, veuillez consulter la Stratégie ministérielle de développement durable d’ECCC de 2020 à 2023.
Innovation et expérimentation
Programme de recherche appliquée sur l’action pour le climat (PRAAC)
Le PRAAC, un partenariat entre le Bureau du Conseil privé, RNCan et ECCC, vise à tirer parti des sciences comportementales pour encourager les citoyens et les organisations à lutter contre les changements climatiques partout au Canada. La phase 1 consistait en une étude longitudinale de l’opinion publique réalisée en huit vagues entre décembre 2021 et mars 2023. Les principaux résultats de l’étude ont fourni de précieux éclairages sur les comportements à l’égard de priorités essentielles et ont été transmis aux communicateurs en matière de changement climatique dans l’ensemble du gouvernement pour qu’ils les utilisent dans la planification des communications, ainsi qu’aux responsables des politiques et des programmes afin d’aider à la prise de décisions fondées sur des données probantes. Cinq chercheurs en sciences comportementales, répartis dans l’ensemble du département, travaillent sur des expériences rapides en ligne afin de mettre à l’essai et d’évaluer des interventions possibles et de comprendre les obstacles qui empêchent l’adoption de comportements respectueux de l’environnement. Ces chercheurs établissent des plans et partenariats pour expérimenter des interventions dans des contextes réels ou dans le cadre de fonctions gouvernementales.
Les résultats d’un projet de recherche à méthodes mixtes sur les difficultés rencontrées par les bénéficiaires de financements provenant du FEFEC ont contribué à l’adoption d’une approche nettement plus transparente en matière de communications entre ECCC et ses intervenants externes. Ce travail a également entraîné des modifications dans les communications de l’équipe avec les candidats aux financements du FEFEC lors des évaluations de projets. Des partenariats en matière de littératie climatique ont également été mis en place à la suite des recherches et des réflexions de PARCA.
Utilisation des satellites pour l’élaboration de la politique sur les GEZ
Les essais de technologies et de systèmes satellitaires de mesure des émissions de GES n’ont pas permis de surveiller les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier au Canada. Les taux enregistrés semblent plus élevés que ceux attendus pour des installations pétrolières et gazières standard au Canada. Les émissions épisodiques ou temporaires posent également des problèmes, étant donné qu’il peut ne pas y en avoir pendant la période d’observation par satellite.
Les conditions météorologiques peuvent également constituer un défi, ce qui se traduit par un faible pourcentage d’observations réussies. De nombreux facteurs influencent les capacités des satellites, notamment les nuages, le vent, la réflectivité solaire, l’eau et la qualité des données antérieures. En raison de leurs limites technologiques, les satellites ne peuvent pas encore mesurer avec précision les émissions au-dessus des zones humides, de la neige ou des installations en mer au Canada.
Les améliorations futures apportées par les prochaines générations de satellites, telles que l’amélioration des capacités de prévision et l’abaissement des seuils de détection, seraient utiles dans le cadre de la boîte à outils de réduction des émissions globales de méthane, mais nécessiteraient toujours l’utilisation de méthodes au sol pour compenser les limites de la technologie satellitaire. La technologie satellitaire actuelle ne présente qu’un intérêt limité dans le cadre de la stratégie du Canada en matière de réduction des émissions de méthane d’ici à 2030.
Principaux risques
La capacité du Ministère à présenter des résultats à la population canadienne en matière de croissance propre et de lutte contre les changements climatiques nécessite une collaboration étroite avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones et internationaux, ainsi qu’avec le secteur privé, les organisations à but non lucratif et la société civile. Si ces relations de collaboration se détériorent, les partenaires extérieurs risquent de ne pas coopérer efficacement ou effectivement sur des questions essentielles à la réalisation du mandat d’ECCC.
Afin d’assurer une mise en œuvre coordonnée de l’action climatique du Canada et de fournir des résultats à la population canadienne, le ministère a établi et entretenu des relations stratégiques avec ses homologues fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones. ECCC s’efforce de rationaliser ses activités autant que possible, notamment en regroupant certaines d’entre elles en fonction des priorités régionales. La collaboration bilatérale et régionale avec les provinces et les territoires permet à ECCC d’adapter les approches et mesures aux priorités communes, tout en prenant en compte les circonstances uniques de chaque administration.
Les trois tables de discussions bilatérales sur la croissance propre et les changements climatiques, réunissant de hauts responsables et fondées sur des distinctions, ont poursuivi leurs travaux en 2022-2023 pour trouver des moyens novateurs de promouvoir l’action climatique menée par les Autochtones et de renforcer les partenariats sur le climat. Ces réunions conjointes continuent de démontrer les avantages d’une collaboration soutenue. Par exemple, en juillet 2022, le Comité mixte sur l’action climatique Premières Nations-Canada (CMAC) a publié son quatrième rapport annuel à l’intention du premier ministre et du chef national de l’Assemblée des Premières Nations. Le CMAC offre une occasion unique aux représentants du gouvernement fédéral et des Premières Nations de travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un modèle de partenariat pour l’action climatique, afin de construire ensemble un avenir inclusif, propre et prospère. Comme cela a été annoncé dans le PRÉ 2030 et le budget 2022, le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir un programme de Leadership autochtone en matière de climat (LAC) qui transformera et renouvellera la relation entre le Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis en ce qui concerne les changements climatiques. Cette initiative vise à fournir un financement stable à long terme aux peuples autochtones pour qu’ils puissent mettre en œuvre leurs propres mesures de lutte contre les changements climatiques, à leur permettre de participer aux décisions relatives au climat prises par le gouvernement du Canada et à lever les obstacles systémiques qui les empêchent de jouer un rôle de premier plan dans l’action climatique.
Le ministère a également veillé à ce que tous ses programmes soient conçus de manière à tenir compte des conséquences et des risques liés aux changements climatiques, ce qui lui permet de continuer à remplir son mandat en protégeant ses actifs et en évitant les interruptions de service. L’adaptation aux changements climatiques permet au ministère de tirer parti de toutes les possibilités de gérer les incertitudes connexes. Pour que les opérations et services ministériels puissent résister aux changements climatiques et se poursuivre malgré ces derniers, ECCC a continué à mettre en œuvre son Plan d’adaptation ministériel et a déterminé les mesures prioritaires à prendre pour faire face aux risques liés aux changements climatiques.
Résultats obtenus
Le tableau ci-dessous présente, en ce qui concerne la responsabilité essentielle « prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques », les résultats prévus, les indicateurs de résultats, les objectifs et les dates cibles pour 2022-2023, ainsi que les résultats réels pour les trois exercices les plus récents si ces résultats sont disponibles.
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Émissions de GES des véhicules utilitaires légers. |
En cours d’examen; ECCC est en train de mettre au point un indicateur qui rendra mieux compte de la nature de ces règlements; il sera inclus dans le plan ministériel dès que possibleNote de bas de page 6 . |
En cours d’examen. |
Augmentation de 21 % [année modèle 2018]. |
Augmentation de 23 % [année modèle 2019] Le rendement a tendance à être légèrement inférieur à l’objectif fixé, et ce pour trois raisons principales : 1) l’expiration du crédit d’impôt pour les véhicules polycarburants continue d’avoir un effet négatif sur le rendement pour plusieurs fabricants; 2) le choix des consommateurs continue de se déplacer, ou s’est déplacé, d’un segment à l’autre, en particulier de celui des voitures à celui des véhicules utilitaires légers; 3) le choix des consommateurs s’est porté sur des véhicules dont l’empreinte est légèrement plus importante au sein des segments. |
26 % |
Émissions de GES des véhicules utilitaires lourds. |
Déclaration pour l’année modèle 2021 : Pourcentage d’augmentation du rendement en matière d’émissions de GES pour les années modèle 2021 à 2023, d’après la déclaration du constructeur, par rapport à l’année modèle 2018 : • 2 % : camionnettes et fourgonnettes lourdes; • 13 % : véhicules articulés; • 8 % : véhicules spécialisés. |
Avril 2023. |
• 13 % : camionnettes et fourgonnettes lourdes. • 20 % : véhicules articulés. • 9 % : véhicules spécialisés. [année modèle 2019]. |
• 15 % : camionnettes et fourgonnettes lourdes. • 19 % : véhicules articulés. • 9 % : véhicules spécialisés. [année modèle 2020] |
• 3 % : camionnettes et fourgonnettes lourdes. • 10 % : véhicules articulésNote de bas de page 7 . • 11 % : véhicules spécialisés. [année modèle 2021] |
Émissions de carbone noir, telles qu’elles figurent dans l’Inventaire des émissions de carbone noir au Canada. |
Diminution de 25 % par rapport au niveau de référence des émissions nationales calculé pour 2013 (et calculé annuellement). |
Décembre 2025 |
Réduction de 16 % par rapport au niveau de référence (31 kt en 2019)Note de bas de page 8 . |
Réduction de 22 % par rapport au niveau de référence (29 kt en 2020)Note de bas de page 9 . |
Réduction de 30 % par rapport au niveau de référence (26 kt en 2021). |
Émissions d’hydrofluorocarbures (HFC). |
Réduction de 10 % de la consommation par rapport à la valeur de référence calculée pour les HFC, soit 18 008 795 tonnes de CO2eNote de bas de page 10 . |
Décembre 2022 |
23 % en dessous du niveau de référence pour l’année calendaire 2020. |
38,5 % en dessous du niveau de référence pour l’année calendaire 2021. |
24,1 %. |
Réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier. |
Diminution annuelle en vue d’une réduction de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2012. |
Décembre 2025. |
Résultats non disponibles. |
Réduction de 45 % (32 Mt CO2e), estimée en fonction des mesures de mise en conformité en 2020Note de bas de page 11 . |
Réduction de 35 % (37 Mt CO2e8) par rapport au niveau de référence de 2012. L’estimation est basée sur le Rapport d’inventaire national publié au printemps 2023 (incluant les données jusqu’à l’année calendaire 2021). |
Les réductions d’émissions sont obtenues en vertu de la norme sur les carburants propres, qui s’appuie sur le Règlement sur les carburants renouvelablesNote de bas de page 12 . |
Réduction des émissions annuelles de GES de plus 20 Mt. |
Décembre 2030. |
Résultats non disponibles; le projet de règlement pour la classe des liquides a été publié le 19 décembre 2020, les projets de règlement pour les classes des gaz et des solides l’ayant été en 2021. |
Résultats non disponibles. |
Résultats non disponibles. |
Pourcentage de centrales électriques à charbon satisfaisant à leurs obligations réglementaires en matière d’intensité des émissions de GES. |
100 % |
Décembre 2022. |
Résultats non disponibles Le rapport complet sera disponible en 2021-2022Note de bas de page 13 . |
100 % |
100 % |
Des systèmes de tarification de la pollution par le carbone sont en place au Canada. |
L’ensemble des provinces et des territoires disposent de systèmes de tarification de la pollution par le carbone qui satisfont aux exigences de rigueur du modèle fédéral, faute de quoi le filet de sécurité fédéral s’applique. |
Mars 2022 |
Les 13 provinces et territoires. |
Les 13 provinces et territoires. |
Les 13 provinces et territoires. |
Réduction des émissions de GES liées aux activités d’ECCC. |
Réduction des émissions de GES liées aux activités d’ECCC (installations et parc automobile) de 40 % par rapport aux 21 549 tonnes de l’année de référence 2005-2006. |
2025 |
42 % |
40,4 % |
39,6 % |
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Élaboration d’indicateurs en collaboration avec les peuples autochtones afin de garantir leur participation à la mise en œuvre du CPC, grâce à trois tables de discussions distinctes réunissant de hauts responsables issus des communautés des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse. | Cet indicateur sera supprimé une fois que l’élaboration des indicateurs en collaboration avec les peuples autochtones sera terminée. | L’objectif est d’élaborer des indicateurs avant le 31 mars 2023. | En 2020-2021, le ministère a continué à faire avancer les travaux menés avec les partenaires autochtones concernant l’élaboration conjointe d’indicateurs, tout en s’attaquant aux problèmes de mobilisation posés par la pandémie de COVID-19. | Aucune activité d’élaboration conjointe d’indicateurs n’a été entreprise en 2021-2022, car cet indicateur sera supprimé et remplacé en 2023-2024 par un nouvel indicateur montrant les progrès qu’accomplit ECCC pour garantir que les peuples autochtones contribuent à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques. | Aucune activité d’élaboration conjointe d’indicateurs n’a été entreprise en 2022-2023, car cet indicateur sera supprimé et remplacé en 2023-2024 par un nouvel indicateur montrant mieux les progrès qu’accomplit ECCC pour garantir que les peuples autochtones contribuent à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques. |
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant cumulé des financements privés mobilisés par l’intermédiaire des fonds d’investissement publics du Canada. | Augmentation, d’année en année, des montants cumulés mobilisés dans le cadre des financements privés de la lutte contre les changements climatiques (dans l’ensemble, le rapport entre les financements privés mobilisés et les fonds d’investissement publics du Canada est d’au moins 1 à 0,5). | Indicateur de cumul à long terme. | Résultats non disponibles. Les résultats relatifs aux financements privés mobilisés en 2020 devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2021. |
Entre 2017 et 2020, le Canada a mobilisé 205,7 millions de dollars canadiens de financements privés dédiés à la lutte contre les changements climatiques, à partir d’un financement public de 270,88 millions de dollars canadiens dans le cadre de l’engagement du Canada à financer la lutte contre les changements climatiques à hauteur de 2,65 milliards de dollars (ce qui équivaut à un ratio de 0,759). | Entre 2017 et 2021, le Canada a mobilisé 312,4 millions de dollars canadiens de financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 367,5 millions de dollars canadiens dans le cadre de l’engagement du Canada à financer la lutte contre les changements climatiques à hauteur de 2,65 milliards de dollars (ce qui équivaut à un ratio de 0,85)Note de bas de page 14 . |
| Réductions des émissions de GES grâce à des initiatives internationales financées par le Canada. | Réductions cumulées plus importantes d’année en année, par rapport au niveau de référence, atteignant un minimum de 200 millions de tonnes de GES. | Indicateur de cumul à long termeNote de bas de page 15 . | Une réduction cumulée estimée à 222,2 Mt de GES est censée résulter de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à ce jour à 2,65 milliards de dollars. | Une réduction cumulée estimée à 228,6 Mt de GES est censée résulter de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à ce jour à 2,65 milliards de dollars. | Une réduction des émissions de GES estimées à 223,7 Mt est censée résulter de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à ce jour à 2,65 milliards de dollarsNote de bas de page 16 . |
| Nombre cumulé de personnes ayant bénéficié du financement de l’adaptation par le Canada dans les pays en développement. | Au moins 10 millions de personnes. | Décembre 2030. | Un nombre cumulé de 5,9 millions de personnes montrant une résilience accrue est censé résulter de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à ce jour à 2,65 milliards de dollars. | Un nombre cumulé de 6,6 millions de personnes montrant une résilience accrue est censé résulter de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à ce jour à 2,65 milliards de dollars. | On estime à 8,04 millions le nombre de personnes qui devraient montrer une résilience accrue aux changements climatiques grâce aux fonds versés jusqu’à présent dans le cadre de l’engagement du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, qui s’élève à 2,65 milliards de dollars. |
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de particuliers, d’entreprises et de gouvernements qui accèdent à des services climatiques et utilisent l’information climatique pour prendre des décisions éclairées | Pour les rapports annuels : augmentation par rapport au niveau de référence. Pour les rapports quinquennaux : définition du niveau de référenceNote de bas de page 17 . |
Pour les rapports annuels : chaque année, en mars. Pour les rapports quinquennaux : mars 2028. |
201 272 visites. | 262 812 visites. | 296 974 visites. 98 % des particuliers, entreprises et gouvernements qui accèdent à des services climatiques indiquent qu’ils ont l’intention d’utiliser les informations climatiques pour prendre des décisions éclairées. |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources financières budgétaires (en dollars)*
Le tableau ci-dessous présente, en ce qui concerne la responsabilité essentielle « prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques », les dépenses budgétaires prévues en 2022-2023, ainsi que les dépenses réelles durant ce même exercice.
| Budget principal des dépenses de 2022-2023 |
Dépenses prévues en 2022-2023 |
Total des autorisations (pouvant être utilisées) pour 2022-2023 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2022–23 |
Différence (dépenses réelles moins dépenses prévues) pour 2022-2023** |
|---|---|---|---|---|
| 478 116 465 | 478 116 465 | 589 591 492 | 407 374 384 | -70 742 081 |
* Les revenus disponibles sont déduits de l’ensemble des chiffres présentés dans le présent document.
** Les dépenses réelles pour 2022-2023 sont inférieures aux dépenses prévues pour 2022-2023, principalement en raison de l’excédent lié au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et à l’Observatoire de veille de l’atmosphère du globe du Dr Neil Trivett situé à Alert (Nunavut). L’écart est compensé par les dépenses pour le Programme international du Canada en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, par les augmentations économiques liées à la compensation et par les paiements versés aux Nations Unies, aux universités pour appuyer la recherche, aux organismes nationaux à but non lucratif et au programme « Croissance propre et atténuation des changements climatiques ».
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources humaines (équivalents temps plein – ETP)*
Le tableau ci-dessous indique, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère avait besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023.
| ETP prévus en 2022–2023 | ETP réels en 2022–2023 | Différence (ETP réels moins ETP prévus) pour 2022-2023 |
|---|---|---|
| 897 | 883 | -14 |
* Les totaux peuvent différer d’un tableau à l’autre et à l’intérieur d’un même tableau en raison de l’arrondissement des chiffres. Les nombres d’ETP, dans l’ensemble du document, incluent les étudiants.
Les informations relatives aux finances, aux ressources humaines et au rendement en ce qui concerne l’inventaire des programmes d’ECCC sont accessibles sur le site « InfoBase du GC ».
Prévention et gestion de la pollution
DescriptionNote de bas de page 18
Collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres entités afin de développer et de gérer des normes, lignes directrices et règlements liés à l’environnement, et d’autres mesures de gestion du risque, en vue de réduire les rejets et de surveiller les niveaux de contaminants dans l’air, l’eau et le sol; promouvoir les lois et les règlements environnementaux et veiller à leur application.
Résultats
Résultat ministériel : L’environnement canadien est protégé des substances nocives
ECCC dirige la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, du Programme zéro déchet de plastique du Canada afin de réduire la pollution plastique, d’améliorer la production, l’utilisation et la gestion durables des plastiques, et de permettre la transition vers une économie circulaire des plastiques. Le gouvernement collabore avec ses partenaires, dont les provinces et territoires, pour mettre en œuvre la Charte sur les plastiques dans les océans et la Stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique et son plan d’action grâce à une série de solutions complémentaires applicables tout au long du cycle de vie des plastiques.
Réutilisation et autres processus de conservation de la valeur
En novembre 2022, ECCC a organisé un symposium multilatéral sur la réutilisation, en partenariat avec l’Union européenne dans le cadre de son projet de réduction des déchets plastiques au Canada. Le symposium a permis de présenter des solutions et politiques de réutilisation innovantes mises en œuvre par des administrations-chefs de file et d’examiner les obstacles rencontrés et les possibilités offertes afin de guider le gouvernement sur la voie à suivre en matière de promotion de la réutilisation. Un rapport de consultation est disponible . La réutilisation est un « processus de conservation de la valeur » (PCV). La refabrication, la remise à neuf et la réparation constituent d’autres PCV. Il s’agit d’activités clés de l’économie circulaire, car elles permettent de maintenir un produit en service ou de prolonger sa durée de vie utile au-delà de sa durée de vie prévue, tout en préservant sa valeur intrinsèque. Elles contribuent à accroître la durabilité et la résilience des économies et de l’environnement.
En 2022-2023, ECCC a continué à collaborer étroitement avec ses partenaires du CCME, contribuant à la publication du document intitulé Orientations pour faciliter la cohérence des politiques et des programmes de responsabilité élargie des producteurs pour le plastique et d’une Feuille de route pour renforcer la gestion des produits en plastique à usage unique ou jetables. Le Ministère a également poursuivi la mise en œuvre du Plan d’action, notamment en élaborant des orientations et en déterminant les bonnes pratiques en matière de lutte contre les sources de pollution plastique, de sensibilisation et d’information des consommateurs, et d’amélioration de la gestion de la fin de vie des équipements de pêche et d’aquaculture.
Par ailleurs, le Canada a continué de jouer un rôle de premier plan au niveau international dans la lutte contre les déchets plastiques et la pollution en s’appuyant sur l’économie circulaire et une approche fondée sur le cycle de vie des produits . Conformément à la résolution 5/14 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, un comité de négociation intergouvernemental a été créé en 2022 pour élaborer un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique d’ici à 2024. Le Canada collabore avec d’autres pays et parties prenantes, notamment en tant que membre fondateur de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, afin de mettre au point un accord ambitieux et efficace portant sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques. Le Canada se réjouit à l’idée de réunir la communauté internationale à l’occasion de la quatrième session de ces négociations, qui se tiendra à Ottawa en avril 2024.
Sept organismes fédéraux (ECCC, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, le Conseil national de recherches du Canada, Statistique Canada et Transports Canada) ont reçu des fonds dans le cadre du budget 2023 pour travailler dans cinq domaines prioritaires :
- l’élargissement des connaissances sur les plastiques dans l’environnement et l’économie;
- l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion;
- le soutien à l’innovation et à la transformation du marché;
- la prévention et la réduction de la pollution plastique;
- la réduction des déchets provenant des activités fédérales.
En 2022-2023, ECCC a de nouveau apporté son soutien à Statistique Canada pour la publication annuelle de son Compte pilote des flux physiques des matières plastiques. Il s’agit d’un compte environnemental et économique innovant qui permet d’estimer le flux de matières plastiques dans l’économie canadienne. Ce compte présente des ventilations par catégorie de produits, par type de résine et par province ou territoire. Il porte sur les années de référence 2012 à 2019 et retrace l’ensemble du cycle de vie des plastiques, de la production à l’élimination finale, en passant par la réutilisation et le recyclage, les données présentées étant accessibles à tout le monde.
En outre, ECCC a continué d’organiser les Défis canadiens d’innovation sur les plastiques. Au cours de l’année 2022-2023, trois bénéficiaires de subventions de la phase 2 ont conçu des prototypes innovants :
- le film multicouche recyclable d’Axipolymer utilisé pour l’emballage alimentaire;
- le papier recyclé renforcé au graphène de Magemi Mining Inc., une solution durable de remplacement des emballages en plastique;
- le projet de GreenMantra Recycling Technologies visant à utiliser des déchets de construction en polystyrène pour produire des additifs pour le polystyrène afin de créer de nouveaux isolants en polystyrène plus légers et plus performants avec une teneur en matières recyclées plus élevée.
Plus de 600 000 dollars ont été obtenus du secteur privé pour ces projets.
En tant que ministère à vocation scientifique, ECCC a organisé un atelier de mobilisation des connaissances sur la science des plastiques en novembre et décembre 2022. Dans le cadre de cet atelier, des experts du monde universitaire et du gouvernement fédéral se sont réunis pour faciliter l’échange des données actuelles de la recherche et de la science sur la pollution plastique, discuter de ces données et examiner leur contribution à l’élaboration de la politique. Le Ministère a également continué de mener et de soutenir des activités de recherche et de surveillance visant à détecter et à évaluer les effets des microplastiques sur l’environnement.
Le gouvernement du Canada a finalisé, en juin 2022, la rédaction du Règlement interdisant les plastiques à usage unique. Le Canada a ainsi tenu son engagement d’interdire certains plastiques à usage unique (PUU) nocifs. Depuis le 20 décembre 2022, le Canada interdit la fabrication, la vente et l’importation pour la vente de certains PUU nocifs. Les six catégories d’articles en PUU choisies l’ont été parce qu’elles sont très présentes dans l’environnement, sont potentiellement nocives (pour la faune et son habitat), sont difficiles à recycler et que des solutions de remplacement sont facilement disponibles. Ces produits sont les sacs de plastique, les ustensiles, les articles pour la restauration contenant des plastiques difficiles à recycler, les bâtonnets à mélanger et les pailles (à quelques exceptions près).
Afin de donner aux entreprises canadiennes suffisamment de temps pour qu’elles puissent effectuer la transition et épuiser leurs stocks existants, la vente de ces articles sera interdite à partir de décembre 2023. Le gouvernement interdira également l’exportation de plastiques appartenant à ces six catégories d’ici à la fin de 2025, ce qui fera du Canada le premier pays du monde, parmi ses pairs, à imposer une telle interdiction. L’interdiction de la fabrication et de l’importation de porte-cannettes (utilisés pour maintenir ensemble plusieurs cannettes ou bouteilles de boissons) devrait entrer en vigueur en juin 2023.
Le règlement sur les PUU reflète les commentaires reçus dans le cadre de consultations approfondies, notamment ceux des entreprises qui ont indiqué avoir besoin de conseils sur l’adoption de produits et de systèmes de remplacement disponibles. Le gouvernement a réagi en publiant, en juillet 2022, un document intitulé Guide pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique du Règlement interdisant les plastiques à usage unique (RIPUU). Ce document décrit les bonnes pratiques visant à réduire l’utilisation des PUU et à choisir des plastiques moins polluants ou des solutions de remplacement sans plastique pour les six catégories de PUU énumérées dans le règlement. Le gouvernement a également publié des lignes directrices techniques pour aider les acteurs soumis au RIPUU à comprendre leurs obligations.
Les interdictions édictées par le RIPUU seront mises en application progressivement entre 2022 et 2025. Les interdictions relatives à la fabrication et à l’importation de sacs de caisse, d’ustensiles, d’articles pour la restauration fabriqués à partir de plastiques problématiques ou contenant de tels plastiques, de touillettes et de pailles (à quelques exceptions près) sont entrées en vigueur en décembre 2022. Le RIPUU devrait permettre d’éviter la production de plus de 1,3 million de tonnes de déchets plastiques et de 22 000 tonnes de pollution plastique sur une période de dix ans.
En 2022-2023, le gouvernement a également franchi les prochaines étapes de la mise en œuvre de son programme de réglementation des plastiques. Cela s’est traduit par la publication de deux documents de consultation en juillet 2022 : l’un sur les règles proposées pour favoriser le recyclage et le compostage du plastique grâce à un étiquetage précis et l’autre sur le projet de registre fédéral des plastiques.
- Les règles d’étiquetage proposées permettraient : d’améliorer la conception des emballages plastiques, de guider les choix des consommateurs quant aux plastiques qu’ils achètent et à la manière dont ils doivent les utiliser et les éliminer et d’améliorer le rendement des systèmes de recyclage afin de produire des plastiques recyclés en plus grande quantité et de meilleure qualité. Le gouvernement élabore actuellement une réglementation qui comprendrait des règles d’étiquetage et des exigences minimales en matière de teneur en matières recyclées pour certains produits en plastique.
- Le projet de registre fédéral des plastiques viendrait en aide aux provinces et territoires qui rendent les producteurs de plastique responsables de leurs déchets plastiques, car il exigerait des entreprises qu’elles rendent compte de la quantité de produits en plastique qu’elles mettent sur le marché canadien et de la manière dont ces produits sont récupérés pour ne pas terminer leur cycle de vie dans des sites d’enfouissement.
Modernisation des services de réglementation
ECCC a lancé une initiative de modernisation des services de réglementation afin d’améliorer les processus et systèmes servant à collecter, gérer et distribuer les données et informations associées à la gestion de la réglementation environnementale. L’initiative vise à mettre en place des systèmes numériques modernes offrant des avantages importants aux parties réglementées et améliorant l’efficacité des activités du ministère.
En 2022-2023, ECCC a continué à se concentrer sur les partenariats et les initiatives clés découlant du One Ocean Summit en vue de réduire la pollution plastique et de protéger les océans du Canada. Ainsi, ECCC s’engage notamment à :
- participer à la coalition de la haute ambition sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) afin de renforcer la protection de la biodiversité marine;
- souscrire à l’engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques (New Plastics Economy Global Commitment), qui réunit plus de 500 entreprises et gouvernements déterminés à prendre rapidement des mesures pour réduire la pollution plastique;
- aider à l’élaboration d’un nouvel instrument international ambitieux et juridiquement contraignant sur la pollution plastique, en tant que membre inaugural de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique;
- verser 4 millions de dollars au Programme des Nations Unies pour l’environnement afin de soutenir un processus de négociation équitable, ouvert et inclusif;
- protéger la santé des océans en mettant au point une nouvelle stratégie de l’économie bleue à l’échelle du gouvernement.
ECCC a continué de collaborer avec ses partenaires et homologues nationaux et internationaux en 2022-2023 pour promouvoir l’économie circulaire, en s’appuyant sur le Forum mondial de l’économie circulaire de 2021 et sur l’étude du Conseil des académies canadiennes intitulée Un tournant décisif et en investissant dans la recherche sur les politiques afin de déterminer les possibilités claires offertes au Canada en matière de maintien de la valeur des matériaux et des produits au sein de l’économie. ECCC a également collaboré avec Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) pour commencer à étudier comment mettre en œuvre un droit de réparer au Canada.
Le Ministère a continué à travailler avec les provinces et départements, par l’intermédiaire du CCME, sur un plan d’action en deux phases visant à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique, adoptée en 2018. La stratégie présente une vision de l’économie circulaire des plastiques. Cette approche vise à favoriser la transformation des plastiques tout au long de leur cycle de vies, soit de leur conception jusqu’à leur fabrication, en passant par leur utilisation et leur récupération.
Le Projet de loi S-5 (Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé) a reçu la sanction royale le 13 juin 2023. Le projet de loi modernise la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et constitue la première série de modifications globales de la LCPE depuis plus de 20 ans; il vise à :
- mieux protéger les populations vulnérables, qui sont les plus touchées par la pollution;
- favoriser la réconciliation avec les Autochtones en confirmant la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne le consentement préalable, libre et éclairé et le rôle du savoir autochtone dans la prise de décisions relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine, et en ajoutant de nouvelles exigences en matière de rapports sur la mise en œuvre de la LCPE pour ce qui est des peuples autochtones du Canada;
- exiger un nouveau plan de priorités en matière de gestion des produits chimiques, évaluer davantage les effets cumulés de l’exposition à plusieurs produits chimiques et établir une liste de surveillance pour favoriser la transition vers des produits chimiques plus sûrs;
- favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes et de stratégies d’essai de remplacement scientifiquement fondées afin de réduire le recours à l’expérimentation animale sur les vertébrés;
- intégrer un objectif environnemental dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD) afin que les risques environnementaux associés aux médicaments puissent être gérés et qu’un cadre de réglementation environnementale modernisé pour les médicaments puisse être mis en place dans le cadre de la LAD.
Les modifications apportées à la LCPE tiennent également compte, pour la première fois au niveau fédéral, du droit à un environnement sain au Canada dans le cadre de l’application de cette loi. Il s’agit d’une base solide sur laquelle il sera possible de s’appuyer pour continuer à agir dans l’ensemble du pays pour assurer un avenir sûr et sain à l’ensemble de la population.
En 2022-2023, le gouvernement a soutenu le projet de loi d’initiative parlementaire C-226, intitulé Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par le gouvernement d’élaborer une stratégie de justice environnementale et d’examiner le lien entre le groupe ethnique et le statut socio-économique des personnes et leur exposition aux risques environnementaux.
Le projet de loi C-226 créerait une nouvelle loi obligeant le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à élaborer une stratégie nationale visant à encourager, partout au Canada, les efforts déployés pour promouvoir la justice environnementale et pour étudier, prévenir et combattre le racisme environnemental. Cela se ferait en collaboration avec toutes les personnes, entités, organisations ou communautés intéressées, y compris les représentants des gouvernements et des communautés autochtones du Canada. Le ministre serait tenu d’élaborer la stratégie dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du projet de loi et de rendre compte de son efficacité tous les cinq ans.
L’élaboration d’une telle stratégie nationale ajouterait deux éléments importants aux efforts déployés pour lutter contre le racisme systémique et les inégalités liées à l’inclusion des peuples autochtones, des communautés noires et des communautés racialisées dans les décisions et initiatives en matière d’environnement. Le processus d’élaboration de la stratégie permettrait aux communautés marginalisées d’aider à définir le problème et de contribuer aux solutions, et une stratégie nationale contribuerait à encadrer les mesures que doivent prendre un large éventail d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.
Afin de protéger l’environnement et la population canadienne contre les substances nocives, ECCC a continué à mettre en œuvre, en collaboration avec Santé Canada, le plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Au 30 septembre 2021, les deux ministères avaient examiné 4144 des 4363 substances chimiques dont l’évaluation avait été jugée prioritaire en 2006. Les autres substances chimiques prioritaires établies continuent d’être évaluées en fonction des besoins. Depuis la création du PGPC en 2006, plus de 210 mesures de gestion des risques visant des substances toxiques ont été mises en place. En 2022-2023, les responsables du programme du PGPC ont publié cinq versions définitives d’instruments de gestion des risques, dont des règlements, des lignes directrices et d’autres dispositions relatives aux substances toxiques. Dans le cadre du PGPC, ECCC a également entrepris un certain nombre d’autres activités et initiatives, dont :
- des activités de contrôle et de surveillance visant l’air, les oiseaux, les poissons, l’eau, les sédiments, les eaux usées et les biosolides, dans le cadre de l’évaluation et de la gestion des risques;
- plusieurs projets de rechercheNote de bas de page 19 portant sur le devenir chimique, la bioaccumulation et les effets des substances prioritaires du PGPC, telles que les retardateurs de flamme, les substances perfluoroalkylées, les terres rares et les nanomatériaux;
- la publication d’un rapport d’évaluation de la mesure du rendement afin de communiquer à la population canadienne des informations sur l’efficacité des mesures de gestion des risques mises en place pour des substances toxiques;
- des investissements pour la modification du Guichet unique en ligne pour les soumissions d’ECCC pour permettre de continuer à mettre en œuvre le PGPC et de rationaliser et améliorer la collecte de données, la production de rapports et la diffusion de l’information.
Reconnaissant que certaines populations au Canada (femmes enceintes, enfants, personnes âgées, communautés autochtones, etc.) sont plus vulnérables aux substances nocives, le ministère continue de veiller à ce que leurs besoins et leur situation soient pris en compte lors du choix des mesures de gestion des risques.
En octobre 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre de la Santé ont lancé des consultations afin de déterminer comment le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pourrait mieux protéger la santé humaine et l’environnement. Pour ce faire, il faudrait que le processus d’évaluation des risques et de prise de décision en matière de réglementation soit plus ouvert et plus transparent et favorise les innovations biotechnologiques qui profitent à la population canadienne. En modernisant la réglementation, ECCC et Santé Canada travaillent ensemble pour s’assurer que les nouveaux organismes vivants créés ou utilisés dans le cadre des biotechnologies sont correctement évalués avant d’être introduits sur le marché canadien.
Avantages des biotechnologies
Les biotechnologies consistent à utiliser des organismes vivants pour fabriquer de nouveaux produits ou technologies destinés à améliorer les conditions de vie sur terre et la santé de notre planète. Elles sont utilisées dans des domaines tels que la santé, l’agriculture, l’aquaculture et l’environnement, et remontent à l’aube des civilisations, lorsque les humains ont commencé à faire fermenter des aliments. Les organismes vivants comprennent les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons, les levures, les protozoaires, les algues, les virus, les cellules eucaryotes en culture et d’autres organismes tels que les animaux et les végétaux.
En 2022-2023, ECCC a terminé d’aligner son Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements sur le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. ECCC et Santé Canada ont également continué à soutenir les organisations régionales représentant les Premières Nations afin d’organiser des réunions publiques au sujet de la protection de l’environnement sur les terres de réserve.
Le Ministère a également poursuivi sa collaboration avec les partenaires autochtones, les parties prenantes, les utilisateurs des terres et les communautés et a mené des activités de recherche et de surveillance afin d’aider à la prise de décisions concernant les contaminants présents dans les écosystèmes canadiens et les aliments récoltés de manière traditionnelle. ECCC a continué à surveiller les tendances d’évolution des contaminants prioritaires dans les écosystèmes, en particulier dans les environnements nordiques et arctiques, afin de soutenir les initiatives nationales et internationales de gestion des produits chimiques, de renforcer la sécurité et la sûreté alimentaires et de permettre la préservation des modes de vie traditionnels.
En 2022-2023, ECCC a continué de fournir des conseils d’experts pour aider les gardiens fédéraux à évaluer et à assainir leurs sites contaminés. Le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) a pour objectif de garantir l’assainissement des sites les plus prioritaires et de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. Parmi les 17 gardiens du PASCF, des activités d’évaluation ont eu lieu sur 84 sites (dont 34 ont déjà été évalués) et des activités d’assainissement ont été menées sur 731 sites (dont 53 ont déjà été assainis). En 2022-2023, ECCC a évalué 12 sites et mené des activités d’assainissement sur 41 sites dont le ministère est responsable. En collaboration avec d’autres ministères, ECCC a également mené 31 examens de classification de sites pour confirmer leur admissibilité à un financement, examiné 28 documents techniques fournis par des gardiens fédéraux, élaboré quatre documents d’orientation et organisé quatre séances de formation et trois séances de mobilisation pour aider les ministères gardiens à gérer leurs sites contaminés. En plus de soutenir ces activités du PASCF, ECCC a aussi fourni une aide spécialisée à des sites qui ne font pas partie du PASCF.
Les critères d’admissibilité au financement de la phase IV du PASCF ont été élargis pour permettre au programme de mieux répondre aux besoins des peuples autochtones. En 2022-2023, une approche envisageable a été élaborée pour recenser les sites contaminés dans les zones où vivent des peuples autochtones, des minorités racialisées et visibles et des personnes à faible revenu, et pour établir des priorités en matière d’assainissement de ces sites.
ECCC a présenté en novembre 2022 la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 (SFDD). Cette dernière version intègre désormais les contributions de 101 organismes fédéraux. Bien qu’il s’agisse de la cinquième stratégie fédérale de développement durable du Canada, c’est la première qui est élaborée dans le cadre d’une Loi fédérale sur le développement durable renforcée et qui accroît la responsabilisation grâce à des objectifs mesurables et limités dans le temps et à la participation de l’ensemble du gouvernement.
La SFDD regroupe les priorités du gouvernement du Canada en matière de développement durable, notamment l’atteinte de la carboneutralité, la conservation de la nature et de la biodiversité pour les générations futures, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, la réconciliation avec les communautés des Premières Nations, inuites et métisses, la réduction de la pauvreté et le soutien à l’innovation et à la croissance économique.
C’est également la première SFDD à être axée sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et à présenter de manière équilibrée les dimensions environnementales, sociales et économiques du développement durable. En outre, il s’agit de la première SFDD à inclure des contributions directes des Autochtones reflétant les points de vue du Conseil consultatif sur le développement durable et des organisations autochtones nationales ainsi que des exemples d’initiatives de développement durable menées par les Autochtones.
Le programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE) a continué à fournir des données et des informations permettant de suivre les résultats obtenus par le Canada dans des domaines tels que les changements climatiques, la qualité de l’air, la qualité et la disponibilité de l’eau, ainsi que la protection de la nature. Il s’agit du principal instrument permettant de mesurer les progrès accomplis par le Canada dans le cadre de sa SFDD et de rendre compte à la population canadienne de l’état de l’environnement. En 2022-2023, 29 indicateurs environnementaux ont été publiés dans le cadre du programme des ICDE.
Résultat ministériel : Les Canadiens ont une eau propre
En 2022-2023, ECCC a continué à assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur les pêches. Cela implique l’élaboration de règlements fixant des exigences strictes concernant tous les rejets dans l’eau, ainsi que l’application et la mise en œuvre de l’interdiction prévue par la Loi sur les pêches lorsqu’il n’existe pas de règlement. L’ECCC est responsable de l’application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, qui interdit le rejet de polluants dans des eaux fréquentées par des poissons.
Pour mieux protéger les ressources en eau douce du Canada, ECCC a continué d’élaborer en 2022-2023 un certain nombre de règlements destinés à protéger les ressources en eau douce du Canada. Le ministère a notamment mené des consultations pour poursuivre l’élaboration d’un projet de Règlement sur les effluents des mines de charbon et d’un éventuel règlement sur les effluents des sables bitumineux, ainsi que des travaux visant à modifier le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et à moderniser le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
Gestion de l’eau douce par le Canada
Le Canada dispose d’un cinquième des réserves mondiales d’eau douce. Le gouvernement fédéral a continué à prendre des mesures pour protéger cette précieuse ressource, en collaboration avec ses partenaires des administrations provinciales, territoriales et municipales, les organisations environnementales et les communautés autochtones. Des lacs plus sains sont synonymes de croissance économique, de possibilités de loisirs accrues et d’écosystèmes sains et durables.
En 2022-2023, ECCC a continué à concentrer ses efforts sur l’assainissement, la réhabilitation et la protection des écosystèmes des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent, du lac Winnipeg et d’autres grands lacs et rivières qui comptent parmi les ressources en eau douce les plus importantes du Canada. Il s’agissait notamment de mener les travaux scientifiques nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau, ainsi qu’à la conservation et à l’assainissement des écosystèmes aquatiques dans ces étendues d’eau vitales. Le ministère a continué à mobiliser les partenaires autochtones dans la conservation et la réhabilitation des ressources en eau douce, notamment en mettant en œuvre les principaux accords sur l’eau et en soutenant les projets menés par les Autochtones conformément aux recommandations des récentes évaluations concernant l’eau douce. Le Ministère a également continué à renforcer la mobilisation du public dans le cadre de la conservation et de la réhabilitation grâce aux sciences participatives, et à financer des activités de conservation et de protection de l’eau par l’intermédiaire de diverses initiatives axées sur les écosystèmes, notamment :
- un financement de 440 000 $ provenant de l’Initiative des écosystèmes du Canada atlantique pour la réalisation de trois nouveaux projets visant à résoudre directement les problèmes de qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Wolastoq [Wəlastəkw] (aussi nommée « fleuve Saint-Jean »); trois organisations basées au Nouveau-Brunswick, en collaboration avec des organisations autochtones locales et des jeunes, mèneront ces initiatives d’assainissement de l’eau pour aider à protéger l’environnement local contre les polluants, tels que les plastiques et les bactéries nocives;
- un investissement de plus de 3,9 millions de dollars sur trois ans dans 39 nouveaux projets menés en Ontario dans le cadre de l’initiative de protection des Grands Lacs, qui fait partie du Plan d’action pour l’eau douce du gouvernement du Canada; les 39 projets respectent les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et de l’Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs; parmi les projets soutenus, citons :
- l’Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara financé pour mener une évaluation et proposer des options de gestion des sédiments contaminés dans la partie est du ruisseau Lyons, dans le secteur préoccupant de la rivière Niagara;
- le Conseil des Mohawks d’Akwesasne financé pour participer à l’évaluation et à l’assainissement du secteur préoccupant du fleuve Saint-Laurent, notamment à la prise de décisions concernant les restrictions de la consommation de poisson, l’accès aux plages et les problèmes ayant une incidence sur les populations de poissons et d’animaux sauvages;
- l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Maitland financé pour mobiliser les organisations non gouvernementales, les municipalités et le public dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions à l’échelle communautaire visant à améliorer la qualité de l’eau dans les affluents et les eaux proches du rivage, à renforcer la protection des rives naturelles et à restaurer les habitats dégradés;
- des investissements de 41,2 millions de dollars et de 23,1 millions de dollars sur cinq ans provenant respectivement des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent de 2011 à 2026;
- la poursuite des efforts liés à la mise en œuvre du Protocole d’entente Canada-Manitoba portant sur le lac Winnipeg et le bassin du lac Winnipeg en collaboration avec les Autochtones et les autres partenaires pour réduire les quantités de nutriments dans le bassin; le Canada a investi 1,6 million de dollars dans des actions menées par les parties prenantes pour contribuer à la réduction des quantités de nutriments, faire progresser la science et encourager la participation et la collaboration des peuples indigènes;
- un investissement de 25 millions de dollars dans la Région des lacs expérimentaux de l’Institut international du développement durable pour soutenir les travaux scientifiques nouveaux et en cours sur l’eau douce, renforcer les collaborations scientifiques nationales et internationales et soutenir les projets visant à améliorer les capacités de recherche et l’échange de connaissances, tant au Canada qu’à l’étranger.
En 2022-23, l’ECCC a continué à coordonner la mise en œuvre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) entre le Canada et les États-Unis, mis à jour en 2012, et à définir les priorités binationales en matière d’activités scientifiques et de mesures pour la période 2023-2025 dans le cadre de l’AQEGL. Les actions menées en coopération avec d’autres ministères fédéraux, la province de l’Ontario, des agences fédérales et étatiques des États-Unis, des communautés et organisations autochtones et d’autres partenaires se concentrent sur des défis majeurs, tels que les espèces envahissantes et l’excès de nutriments, qui contribuent à la formation d’algues toxiques, et sur d’autres mesures visant à protéger et à préserver les Grands Lacs. Les activités et réalisations nationales et binationales liées à la mise en œuvre de l’AQEGL de 2012 entre 2020 et 2022 ont été décrites dans le Rapport d’étape des Parties de 2022.
En partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, le ministère assure la mise en œuvre de l’Accord Canada-Ontario [de 2021] concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs (2021-2026), qui est aligné sur l’AQEGL et aide le Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l’AQEGL, et poursuit la mise en œuvre du Plan d’action Canada-Ontario pour le lac Érié.
Le Ministère a également poursuivi la mise en œuvre du nouveau Plan de protection des océans (PPO 2.0). Cela implique le renforcement des capacités d’ECCC en matière d’expertise scientifique et d’application de la loi pour que le ministère puisse réagir en cas d’incidents maritimes. De plus, ECCC a continué à collecter des données sur les sensibilités environnementales dans les zones prioritaires qui sont très sensibles ou exposées à des risques de pollution marine. Enfin, le Ministère a poursuivi l’élaboration d’un cadre de rétablissement qui permettra : de clarifier les différents rôles et responsabilités en matière de rétablissement; de coordonner et d’orienter les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour limiter le plus possible les répercussions à long terme des déversements d’hydrocarbures en mer causés par les navires, en surveillant et en gérant les conséquences à long terme de ces déversements; et de soutenir les activités de rétablissement, qui visent à assainir les zones touchées au sein d’un écosystème fonctionnel.
Dans le cadre de cette initiative et en collaboration avec ses partenaires, le Ministère a amélioré sa capacité à réagir en cas de déversement de produits chimiques dans les écosystèmes d’eau douce grâce à des inspections des rives, à des études scientifiques sur de nouveaux types d’hydrocarbures, pour mieux comprendre leur comportement, et à des contributions à la recherche sur les propriétés physiques et chimiques du bitume déversé.
ECCC a continué à travailler sur l’amélioration du système de gouvernance et de gestion des ressources en eau douce en 2022-2023. Il s’agissait notamment de continuer à travailler à la création de la nouvelle Agence de l'eau du Canada, qui collaborera avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d’autres acteurs pour trouver les meilleurs moyens de garantir la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l’eau.
En particulier, ECCC et la Première Nation Tsleil-Waututh (Colombie-Britannique) ont conclu en mai 2022 un accord historique, le premier du genre, pour la cogestion de la baie de Burrard dans le cadre du Programme sur l’immersion en mer d’ECCC. Le rejet de toute substance dans la mer, y compris sur les fonds marins, n’est pas autorisé, sauf si un permis a été délivré. Dans le cadre de cet accord, le ministère des Traités, des Terres et des Ressources de la Première Nation Tsleil-Waututh et ECCC travailleront ensemble pour évaluer les risques liés aux pratiques d’immersion en mer. Pour soutenir ce travail important, ECCC débloquera un total de 500 000 dollars au cours des cinq prochaines années. L’accord reconnaît le rôle essentiel de la Première Nation Tsleil-Waututh, qui collabore avec le Canada pour surveiller, protéger et restaurer la santé de la baie de Burrard, et sa longue expérience en matière de gestion des terres.
Résultat ministériel : Les Canadiens ont un air pur
En 2022-2023, ECCC a poursuivi son étroite collaboration avec les provinces et territoires pour mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA). Il s’agit d’une approche globale visant à réduire la pollution de l’air extérieur au Canada. Le Ministère, en collaboration avec Santé Canada, a continué à travailler avec les provinces, les territoires et les parties prenantes pour mettre à jour les normes de qualité de l’air ambiant pour les particules fines (PM2,5Note de bas de page 20 ).
ECCC a continué de surveiller les niveaux des principaux polluants atmosphériques en 2022-2023, en collaboration avec les provinces et les territoires dans le cadre du Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique. Le Ministère a tiré parti de son supercalculateur pour mener des travaux de recherche et de modélisation afin de comprendre les processus chimiques atmosphériques et leurs incidences sur les écosystèmes et la santé humaine, pour améliorer les modèles de prévision des effets des contaminants atmosphériques sur la qualité de l’air, et pour fournir des scénarios utilisés pour l’élaboration des politiques.
Par ailleurs, le Ministère a continué à élaborer, à utiliser et à tenir à jour la cote air santé (CAS) en collaboration avec Santé Canada. En 2022-2023, la CAS a été consultée par 1,37 million de personnes sensibles aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé. En outre, ECCC a continué à rendre compte de la qualité de l’air et des émissions, notamment dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques du Canada, afin de respecter les exigences internationales en matière de production de rapports.
Sur le plan international, ECCC a continué à participer activement aux forums internationaux portant sur la réduction de la pollution atmosphérique transfrontalière et à y jouer un rôle de premier plan. Les travaux d’ECCC ont notamment consisté à mettre en avant une gérance de l’environnement basée sur le respect constant des obligations liées à la qualité de l’air dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et, en particulier, de son Protocole [modifié] relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), qui est entré en vigueur en 2019.
En 2022-2023, le Canada a continué à respecter ses engagements en matière de réduction des émissions pour 2020 et au-delà dans le cadre du Protocole de Göteborg et à s’attaquer aux principaux polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote, les dioxydes de soufre, les composés organiques volatils et les particules fines.
ECCC a également continué à élaborer, à appliquer et à modifier les règlements visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques provenant de sources industrielles, de véhicules, de moteurs, de combustibles et de produits destinés aux particuliers ou aux entreprises. Cela implique de continuer à agir pour :
- appliquer le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, ainsi que divers instruments non réglementaires visant à lutter contre les émissions de polluants atmosphériques provenant de secteurs industriels;
- appliquer le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier), publié en novembre 2020, qui vise à réduire la pollution atmosphérique provenant des raffineries de pétrole, des usines de valorisation et de certaines installations pétrochimiques;
- élaborer des règlements visant à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement des hydrocarbures liquides et continuer à évaluer les possibilités de réduire la pollution atmosphérique provenant d’autres sources dans le secteur pétrolier et gazier;
- appliquer les règlements existants sur la qualité des combustibles en ce qui concerne le soufre, le benzène, le plomb et d’autres contaminants;
- appliquer le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, publié en décembre 2020;
- se préparer à la mise en œuvre du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, qui vient d’être finalisé et qui vise à réduire les émissions de COV d’environ 130 catégories et sous-catégories de produits de soins personnels, de produits d’entretien automobile et ménager, d’adhésifs, de dissolvants d’adhésifs, de produits d’étanchéité et de calfeutrage, etc.
En 2022-2023, les agents de l’autorité d’ECCC sur le terrain ont continué à veiller au respect de la législation environnementale et des règlements connexes qui visent à interdire ou à limiter la pollution de l’air et de l’eau. Ces agents ont effectué, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de la Loi sur les pêches, 3330 inspections, dont 349 liées à des priorités fondées sur le risque, telles que l’exploitation minière, les combustibles et la production d’électricité.
Ces inspections ont donné lieu à 25 nouvelles enquêtes menées en vertu de la réglementation en matière de pollution et à la mise en œuvre de 603 mesures d’application de la loi, dont des sanctions administratives pécuniaires (SAP), des ordonnances exécutoires, des contraventions, des avertissements et des mesures de substitution. Les enquêtes ont abouti à 10 condamnations et à 7 nouvelles poursuites. En 2022-2023, les poursuites ont donné lieu à des pénalités d’un montant total de 22 090 000 dollars. En outre, les sanctions pécuniaires découlant des SAP s’élevaient à 199 600 dollars.
Les mesures d’application de la loi relatives à la pollution de l’air et de l’eau en 2022-2023 comprenaient notamment une :
- ordonnance rendue en avril 2022 obligeant la société CaNickel Mining Ltée à payer 200 000 dollars après qu’elle a plaidé coupable devant la Cour provinciale du Manitoba pour deux infractions consistant en des violations du Règlement sur les effluents des mines de métaux pris en vertu de la Loi sur les pêches;
- amende de 600 000 dollars infligée à Husky Oil Operations Ltée en avril 2022 pour violation de l’article 36(3) de la Loi sur les pêches en raison d’un déversement d’environ 2,8 millions de litres d’eau de traitement (un sous-produit de la production de pétrole et de gaz) à partir du pipeline Westhazel, en 2018;
- amende de 15 millions de dollars imposée en juin 2022 à ArcelorMittal Canada inc. et 7 623 704 Canada Inc. pour infraction à la Loi sur les pêches et au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM), en raison d’incidents survenus au complexe minier de Mont-Wright, à Fermont (Québec), entre le 25 mai 2011 et le 14 mai 2013.
Les amendes payées par les contrevenants sont versées au Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement du Canada, qui les utilise pour des initiatives utiles de protection et de conservation de l’environnement. Le Ministère a également continué à concentrer ses efforts sur le renforcement des capacités en accueillant et en formant des agents de l’autorité nouvellement recrutés, et en offrant aux agents déjà en poste une formation pour le renouvellement de leur certification.
Analyse comparative entre les sexes plus
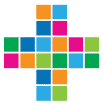
ECCC a continué d’appliquer une approche axée sur l’ACS+ dans le cadre de l’élaboration de recommandations stratégiques, de programmes et de mesures visant à lutter contre la pollution de l’air et à améliorer la qualité de l’air. Les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé peuvent être aggravés chez les personnes qui présentent de multiples facteurs de risque. Par exemple, une personne peut être plus gravement touchée par la pollution de l’air si elle est âgée, souffre de pathologies chroniques et vit dans une zone où la pollution de l’air est élevée qu’une personne qui ne présente qu’un seul facteur de risque. En 2022-2023, le Ministère a continué de veiller à ce qu’un plus grand nombre de populations à risque, notamment les communautés autochtones situées sous le vent par rapport à de grands complexes industriels et celles exposées aux fumées d’incendies de forêt, participent au travail d’amélioration de la qualité de l’air. De même, le Ministère a continué de collaborer avec les communautés autochtones à la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada et à des initiatives concernant la qualité de l’eau dans les principaux écosystèmes d’eau douce, dont ceux des Grands Lacs, du lac Winnipeg des bassins versants du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Wolastoq [Wəlastəkw] (aussi nommée « fleuve Saint-Jean »). Les projets visaient à répondre aux préoccupations des communautés, à accroître la participation des populations autochtones à la prise de décision et à la gestion des accords sur l’eau et à promouvoir l’utilisation du savoir autochtone dans les initiatives en matière de qualité de l’eau. Les travaux d’identification et de gestion des substances nocives menés par ECCC ont continué à s’appuyer sur des informations scientifiques et à mettre en évidence l’importance d’une bonne gestion des risques dans la réduction des risques liés à l’exposition aux produits chimiques toxiques pour les groupes vulnérables. Cela a permis d’adapter le matériel de promotion de la conformité pour mieux prendre en compte les profils culturels et linguistiques des publics cibles. Le ministère a également amélioré ses pratiques de recrutement pour que son personnel responsable de l’application de la loi soit plus représentatif de la population canadienne.
Objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030Note de bas de page 21 des Nations Unies

Les divers programmes et stratégies relevant de la responsabilité essentielle d’ECCC en matière de prévention et de gestion de la pollution contribuent de manière substantielle à plus de la moitié des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Le contrôle continu de l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et des principales dispositions de la Loi sur les pêches, associé à la mise en œuvre du PGPC, au respect des obligations du Canada au titre des accords multilatéraux sur l’environnement concernant la pollution atmosphérique, les substances chimiques et les déchets, à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’eau douce dans les principales étendues d’eau du Canada et à la promotion des règlements visant à protéger la qualité de l’air et de l’eau et à promouvoir les combustibles propres, ont contribué à préserver la santé et le bien-être de l’ensemble de la population (objectif 3). Tout cela permettra également de favoriser une gestion durable de l’eau et de l’assainissement (objectif 6), de promouvoir des pratiques de production et de consommation durables (objectif 12) et de lutter contre les changements climatiques (objectif 13).
Grâce à la mise en œuvre de mesures nationales et internationales axées sur la gestion responsable des déchets, la protection des océans et l’élimination et la réduction des déchets plastiques et de la pollution dans l’environnement, ECCC encouragera l’utilisation durable des ressources marines (objectif 14) et favorisera des approches inclusives du développement durable, de l’industrialisation et de l’urbanisation (objectif 8, objectif 9, objectif 11 et objectif 15). En outre, ECCC continuera à jouer un rôle actif de partenaire et de chef de file dans l’action mondiale en matière de prévention et de gestion de la pollution (objectif 17).
Dans le cadre du plan fédéral de mise en œuvre du Programme 2030, le gouvernement s’engage à considérer les ODD en suivant les principes liés aux droits de la personne et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones en respectant et en protégeant pleinement leurs droits. En 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies) a reçu la sanction royale obligeant tous les ministères à s’aligner dans leurs activités sur les droits énoncés dans cette déclaration. La mise en œuvre de la loi par ECCC permettra d’établir des liens entre la prévention et la gestion de la pollution, la lutte contre la double crise de la biodiversité et des changements climatiques, et la protection et le respect des droits des peuples autochtones.
Pour en savoir plus sur les mesures qui sont liées à cette responsabilité essentielle et contribuent aux ODD des Nations unies, veuillez consulter la Stratégie ministérielle de développement durable d’ECCC de 2020 à 2023.
Innovation et expérimentation
Réduction de la consommation de plastiques grâce aux sciences comportementales
Deux chercheurs en sciences comportementales expérimentent des méthodes permettant d’informer les consommateurs sur les substances chimiques contenues dans les produits et d’améliorer les taux de collecte des plastiques destinés à être recyclés. Les résultats préliminaires d’une étude menée en mars 2023 et visant à mettre à l’essai des modèles et formats d’étiquette et à en analyser l’efficacité montrent que les étiquettes comportant une référence à ECCC et un symbole signalant un danger sont les plus efficaces. Les recommandations relatives à la divulgation des substances chimiques contenues dans les produits s’appuieront sur les résultats de l’étude. Une autre étude en ligne a été lancée en mars 2023 pour déterminer ce qui importe le plus aux gens lorsqu’ils achètent des produits.
Consultation des parties prenantes sur la promotion de la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les substances chimiques contenues dans les produits
Des consultations nationales sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement et l’étiquetage ont été organisées du printemps à l’automne 2022. ECCC, avec le soutien financier du Centre d’innovation en matière de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, a mis à l’essai une approche de type « laboratoire de politiques » pour contribuer à l’élaboration de solutions en matière de transparence de la chaîne d’approvisionnement et d’étiquetage, et ce afin de mieux comprendre leurs avantages et inconvénients.
Parmi les principales idées recueillies, citons l’utilisation de solutions numériques pour améliorer la communication au sujet des substances chimiques contenues dans les produits, la nécessité de mettre en place des exigences nationales et internationales cohérentes en matière d’échange d’informations afin d’éviter les redondances et l’alourdissement du fardeau réglementaire, ainsi que l’alignement sur les initiatives internationales en cours. Les données recueillies lors des consultations nationales serviront à l’élaboration d’une stratégie plus globale de communication concernant les substances chimiques contenues dans les produits, laquelle devrait être publiée en 2023.
Principaux risques
Les partenariats sont essentiels à la mise en œuvre des programmes de lutte contre la pollution par le Ministère. Pour veiller à ce que les programmes d’ECCC soient coordonnés avec ceux de ses partenaires et intervenants, et ne pas risquer de compromettre la réalisation des objectifs communs, le ministère a continué à établir et à entretenir des relations. Par exemple, ECCC a poursuivi sa collaboration avec les partenaires, parties prenantes, utilisateurs des terres et communautés autochtones en continuant à surveiller les tendances d’évolution des contaminants prioritaires dans les écosystèmes, notamment dans les environnements nordiques et arctiques, afin de promouvoir les initiatives nationales et internationales de gestion des produits chimiques, la sécurité et la sûreté alimentaires, et le maintien des modes de vie traditionnels.
ECCC a continué à encourager une approche raisonnable et collaborative en ce qui concerne les initiatives phares, afin de susciter au maximum l’adhésion des secteurs ciblés et des partenaires. Par exemple, depuis décembre 2022, la fabrication et l’importation, pour la vente, de certains plastiques à usage unique nocifs sont interdites au Canada. Afin d’atténuer les éventuels risques d’une faible adhésion des secteurs ciblés, les entreprises canadiennes disposent d’un délai suffisant pour effectuer la transition et épuiser leurs stocks existants, étant donné que la vente de ces produits sera interdite à partir de décembre 2023. Le Ministère continuera à collaborer avec d’autres ministères, les provinces, les territoires et l’industrie pour mener à bien son ambitieux programme.
Résultats obtenus
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de Canadiens vivant dans des zones où les normes de qualité de l’air sont respectéesNote de bas de page 22 . | 85 % | Décembre 2030 | 68 %Note de bas de page 23 | 71 %Note de bas de page 24 | 64 %Note de bas de page 25Note de bas de page 26 |
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de systèmes d’assainissement où les normes de qualité des effluents sont respectées. | 100 % | Décembre 2040 | 77 % | 77 % | Résultats pas encore disponiblesNote de bas de page 27 |
| Indicateur de rendement | Objectif | Date à laquelle l’objectif sera atteint | Résultats réels pour 2020–2021 |
Résultats réels pour 2021–2022 |
Résultats réels pour 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de mesures prises en temps utile pour protéger l’environnement contre les produits chimiques présentant un risque pour l’environnement au CanadaNote de bas de page 28 . | 100 % | 31 mars 2023 | Sans objet | Sans objet | 93 %Note de bas de page 29 |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources financières budgétaires (en dollars)
Le tableau ci-dessous présente, en ce qui concerne la prévention et la gestion de la pollution, les dépenses budgétaires pour 2022-2023, ainsi que les dépenses réelles pour cet exercice.
| Budget principal des dépenses de 2022-2023 |
Dépenses prévues en 2022-2023 |
Total des autorisations (pouvant être utilisées) pour 2022-2023 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2022–23 |
Différence (dépenses réelles moins dépenses prévues) pour 2022-2023* |
|---|---|---|---|---|
| 379 219 765 | 379 219 765 | 412 163 483 | 390 259 703 | 11 039 938 |
* Les dépenses réelles pour 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses prévues pour 2022-2023, principalement en raison de l’augmentation des dépenses liées aux initiatives relatives à l’écosystème des Grands Lacs, compensée par un nouveau financement dans le cadre du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux et de l’extension du réseau d’oléoducs Trans Mountain.
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources humaines (ETP)
Le tableau suivant indique, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère avait besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023.
| ETP prévus en 2022–2023 | ETP réels en 2022–2023 | Différence (ETP réels moins ETP prévus) pour 2022-2023 |
|---|---|---|
| 2 220 | 2 255 | 35 |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Conservation de la nature
DescriptionNote de bas de page 30
Protéger et rétablir des espèces en péril et leurs habitats, assurer la conservation et la protection de populations saines d’oiseaux migrateurs; mobiliser les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les parties prenantes et le public afin d’augmenter les aires protégées et contribuer aux activités de conservation et d’intendance; étendre et gérer les aires protégées du Ministère; et collaborer avec des partenaires du Canada et à l’international pour faire progresser la conservation de la biodiversité et du développement durable.
Résultats
Résultat ministériel : La faune et les habitats du Canada sont préservés et protégés.
Patrimoine naturel bonifié
Le 20 décembre 2022, à Montréal, le Canada et les 195 autres pays membres ont conclu des négociations dans le cadre de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la plus grande conférence sur la biodiversité de l’histoire. Après 13 jours de négociations, les Parties à la COP15 se sont entendues sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.Cet accord historique vise à protéger la nature, à freiner et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 et à mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050. Les principaux objectifs du Canada sont intégrés au cadre, à savoir : protéger 30 % des terres et des eaux d’ici 2030, respecter les droits et les rôles des peuples autochtones et s’attaquer aux principaux facteurs de la perte de biodiversité, notamment la pollution et la surexploitation de la nature.
Comité consultatif sur la nature
En 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a mis sur pied le Comité consultatif sur la nature afin d’appuyer le gouvernement dans ses efforts pour freiner et inverser la perte de milieux naturels d’ici 2030 et de parvenir à un rétablissement complet de la nature d’ici 2050. Le Comité consultatif sur la nature est un groupe d’experts aux perspectives diversifiées dont la responsabilité est de formuler, à l’intention du Ministère et du Ministre, des conseils stratégiques et des recommandations sur la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des terres et des ressources. Le comité contribuera à la résolution des enjeux les plus pressants du Ministère, y compris l’élaboration de la Stratégie nationale sur la biodiversité après 2030, la progression vers des cibles de conservation par zone, comme la conservation de 25 % et de 30 % des terres et des océans du Canada d’ici 2025 et 2030, respectivement, et le soutien d’initiatives de gestion des espèces sauvages et des espèces en péril.
Au cours de la COP15, le Canada a pris de nouveaux engagements majeurs et a consenti d’importants nouveaux investissements en matière de conservation de la nature, y compris :
- la signature de l’Accord Canada–Yukon sur la nature, visant à faire progresser la conservation et la protection de la nature sur l’ensemble du territoire et à soutenir le leadership autochtone en matière de conservation;
- un appui de 800 millions de dollars à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones (une fois terminés, ces projets pourraient assurer la protection d’un million de kilomètres carrés supplémentaires au Canada);
- des fonds nouveaux et supplémentaires de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à protéger la nature;
- un montant de 255 millions de dollars destiné à des projets qui aident les pays en développement à bâtir un avenir solide, notamment en luttant contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes.
À la COP15, le Canada s’est également engagé à se joindre au Défi de Bonn. Il s’agit d’une initiative mondiale qui vise à mettre 350 millions d’hectares de paysages dégradés et déboisés sur la voie du rétablissement d’ici 2030. Le Canada s’est engagé à remettre en état environ 19 millions d’hectares par l’entremise de programmes gérés par ECCC, Parcs Canada et RNCan; ces programmes appuient la remise en état des paysages et des écosystèmes sur le terrain. Parmi ceux-ci, le programme 2 milliards d’arbres offre un soutien financier sur 10 ans aux organisations pour la plantation d’arbres. Le Canada est l’un des rares pays dotés de vastes écosystèmes naturels en santé. Les forêts, les milieux humides, les tourbières, les prairies et les autres écosystèmes du pays sont une part importante du patrimoine, de la prospérité future et du bien-être du Canada. La remise en état des écosystèmes et des paysages est une puissante solution fondée sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et redonner un habitat aux espèces sauvages.
Solutions climatiques fondées sur la nature
Le Canada a annoncé l’initiative horizontale du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Les résultats attendus de cette initiative sont notamment la réduction des émissions de GES, la remise en état des écosystèmes, la prévention de la perte de biodiversité et l’amélioration du bien-être des humains et de leur résilience face aux changements climatiques. Afin de contribuer à orienter des décisions fondées sur des données probantes en ce qui concerne la nature durable et résiliente dans les villes et de soutenir le bien-être physique et mental des personnes, ECCC a lancé un programme de recherche transdisciplinaire en écologie urbaine. Ce programme propulsera une nouvelle manière de mener des recherches sur la biodiversité et de mobiliser les connaissances au moyen d’un cadre socio écologique. Il servira également à faire progresser les engagements du Canada pris dans le cadre de la cible 12 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal (CMB), qui vise à accroître la place de la nature dans les villes ainsi que l’accès des personnes à des espaces verts.
En avril 2022, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se sont engagés à accélérer la création de nouvelles aires protégées dans la province. Reconnaissant l’importance de la biodiversité et des efforts de conservation de la nature qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs environnementaux élargis et à renforcer la résilience aux changements climatiques, les deux gouvernements ont convenu de travailler ensemble pour ce qui suit :
- créer une aire protégée dans le bassin versant de la rivière Eagle, en consultation avec les communautés autochtones, d’ici 2025;
- conclure un accord pour faire progresser les possibilités en matière de conservation marine sur la côte du Labrador, en partenariat avec les communautés autochtones du Labrador.
Les deux gouvernements ont également convenu d’examiner la possibilité de créer d’autres aires marines nationales de conservation, des réserves nationales de faune en milieu marin, des parcs nationaux, et des aires marines de conservation administrées par Pêches et Océans Canada à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont convenu, en outre, de faire avancer les négociations relatives à un accord sur la nature qui visera à faire progresser les solutions à plusieurs enjeux liés à la nature, notamment la protection de l’habitat des espèces en péril et des oiseaux migrateurs.
En 2022-2023, ECCC a désigné Edéhzhíe comme réserve nationale de faune, en plus de son statut d’aire protégée Dehcho. Edéhzhíe est une zone intacte des Territoires du Nord-Ouest qui a une importance pour les Premières Nations du Dehcho. Il s’agit d’un sanctuaire culturel où les Dehcho Dene peuvent retourner pour se ressourcer sur le plan spirituel et se reconnecter et se réconcilier avec la terre. Cette zone constitue également un habitat essentiel du caribou boréal et du bison des bois, de même qu’un lieu d’importance pour la sauvagine et d’autres oiseaux migrateurs. La désignation vient garantir que les terres, les eaux et la biodiversité d’Edéhzhíe sont protégées de manière permanente par les dispositions de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. De plus, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a pris des mesures pour protéger Edéhzhíe de toute future exploration ou exploitation minérale, pétrolière ou gazière. Afin de soutenir ces mesures de protection, le gouvernement du Canada a versé 10 millions de dollars au fonds de soutien d’Edéhzhíe, assurant ainsi un financement à long terme pour la gestion de la zone, sous la gouverne des Premières Nations du Dehcho.
Le Ministère s’est aussi engagé, avec Canards illimités Canada, à investir 5,6 millions de dollars sur trois ans pour réduire les GES. Cette réduction sera rendue possible grâce au renforcement des activités de conservation de la biodiversité dans les milieux humides et les zones côtières du sud du Canada dans les six provinces de l’est, soit de l’Ontario à Terre-Neuve-et-Labrador. Canards illimités Canada utilisera les fonds pour remettre en état et conserver des milieux humides et secs dégradés, faire l’acquisition de milieux exposés à un risque élevé de perte au profit d’autres utilisations des terres et acquérir de l’habitat pour permettre la migration de l’intérieur des terres vers les marais salés côtiers. Ce projet ciblera jusqu’à 15 espèces en péril inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril et assurera la protection permanente de milieux humides et secs pour un stockage à long terme de grandes quantités de carbone.
En 2022-2023, le gouvernement a annoncé qu’il investira jusqu’à 90 millions de dollars sur trois ans pour prolonger le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN). Cet investissement permettra d’acquérir 180 000 hectares de terres écosensibles supplémentaires et de créer de nouvelles aires protégées et de conservation partout au pays. Ces fonds supplémentaires pour le Programme de conservation du patrimoine naturel seront gérés dans le cadre d’accords conclus avec Conservation de la nature Canada, Canards illimités Canada et Habitat faunique Canada, au nom de fiducies foncières locales et régionales dans l’ensemble du pays. Pour chaque dollar de financement fédéral, le programme ira chercher au moins 1,50 $ en fonds de contrepartie de sources non fédérales, y compris des contreparties non financières comme des dons de terrains par des propriétaires fonciers et des sociétés privées. L’investissement du gouvernement mobilisera donc au moins 225 millions de dollars en financement total pour la poursuite de l’objectif du Canada qui consiste à protéger 30 % des terres et des eaux intérieures d’ici 2030Note de bas de page 31 . Un excellent exemple de ce modèle s’est produit en 2022, lorsque Conservation de la nature Canada (CNC) et ses collaborateurs, l’entreprise forestière Domtar ainsi que des appuis de l’étranger, se sont mobilisés pour la protection de forêts et de milieux humides d’importance mondiale. Ensemble, ils ont conclu un accord visant la conservation de plus de 1500 km2 de terres privées, soit deux fois la superficie de Toronto, ce qui en fait le plus grand accord de conservation de l’histoire du Canada. Ces terres comprenaient les 100 lacs et les 1300 km de rivières, de ruisseaux et de littoral qui composent la forêt Hearst, dans le nord de l’Ontario.
En 2022-2023, ECCC s’est aussi engagé à investir 11,3 millions de dollars sur trois ans, dans le cadre de l’initiative Patrimoine naturel bonifié du Canada, afin de renforcer les activités de conservation de la biodiversité dans 19 réserves de biosphère de l’UNESCO à travers le Canada. Ces réserves de biosphère sont notamment celles de Clayoquot Sound, en Colombie-Britannique, de Riding Mountain, au Manitoba, de l’Escarpement du Niagara, en Ontario, de Manicouagan-Uapishka, dans la région québécoise de Baie-Comeau, et de Fundy, au Nouveau-Brunswick.
Communiquer les données sur la biodiversité pour appuyer la conservation
La gestion et la diffusion des données sur les espèces en péril sont essentielles pour soutenir leur conservation. En 2022-2023, ECCC a publié l’Ensemble de données nationales sur l’habitat essentiel des espèces en péril (https://t.co/sXm9hS4PmW), donnant ainsi libre accès à l’emplacement de l’habitat essentiel de plus de 250 espèces en péril au Canada. Cette information permettra aux Canadiens de localiser et de protéger l’habitat essentiel près de chez eux.
Les réserves de biosphère sont un modèle qui illustre la manière dont les collectivités peuvent entrer en relation avec la nature dans des contextes sains et durables. Elles inspirent les Canadiens et leur donnent les moyens de travailler ensemble pour s’attaquer aux problèmes mondiaux, comme la perte de biodiversité et les changements climatiques. En investissant dans les réserves de biosphère canadiennes, le Ministère fait progresser les travaux de conservation dans des zones riches en diversité culturelle et biologique. À titre d’exemple, la réserve de biosphère de la Baie Georgienne recevra plus de 585 000 $ de Patrimoine bonifié Canada sur trois ans. Ces fonds serviront à soutenir les activités de conservation dans la réserve et contribueront à l’objectif du Canada de conserver 25 % des terres et des eaux intérieures d’ici 2025, puis de progresser vers 30 % d’ici 2030. Pour toute la durée du projet, les partenaires travailleront ensemble pour rétablir, maintenir et accroître la biodiversité dans les zones tampons entourant les zones protégées centrales de la réserve de biosphère, qui englobe la rive est de la baie Georgienne et s’étend sur environ 175 km, de la rivière Severn à la rivière des Français, en Ontario. On espère qu’au cours des prochaines années, les zones gérées comprises dans les zones tampons de la réserve de biosphère seront reconnues comme d’autres mesures de conservation efficacesNote de bas de page 32 (AMCE), ce qui permettrait de les intégrer au réseau de conservation reconnu du Canada.
Villes amies des oiseaux
Le gouvernement du Canada a fait équipe avec l’autrice Margaret Atwood pour annoncer que 14 villes canadiennes sont désormais certifiées en tant que villes amies des oiseaux par Nature Canada. Le Ministère a insisté sur l’importance des villes dans le maintien des populations d’oiseaux, qui contribuent à enrichir les milieux urbains.
Le Ministère a modernisé le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) en 2022-2023 dans le cadre de l’engagement du Canada de protéger et de conserver les oiseaux migrateurs. Le Canada abrite près de 400 espèces d’oiseaux migrateurs, et leur santé est un indicateur de la santé des écosystèmes naturels qui nous soutiennent tous. Partout au pays, les oiseaux sont un emblème de l’amour des Canadiens pour la nature, ainsi qu’une part importante du mode de vie, de la culture et de la subsistance des communautés autochtones. Les modifications au ROM rendent le règlement plus facile à comprendre pour les Canadiens, qui pourront plus facilement s’y conformer, et améliorent la capacité du gouvernement à gérer et à protéger efficacement les oiseaux migrateurs au Canada. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs modernisé garantit également que les peuples autochtones sont fidèlement représentés et que leurs droits d’exploitation existants, reconnus et affirmés par la Loi constitutionnelle de 1982, sont respectés. Parmi ceux-ci figurent le droit d’utiliser, de donner, de vendre ou d’échanger des plumes, le droit de chasser, de donner ou d’échanger des oiseaux migrateurs, et le droit de récolter leurs œufs.
En outre, en décembre 2022, le Ministère a annoncé des investissements de 1,998 million de dollars sur trois ans pour soutenir une vaste gamme de programmes de surveillance et de conservation des oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril, partout au Canada. Les résultats de ces projets aideront à la planification du rétablissement des espèces en péril et à la protection de leur habitat essentiel. Les programmes seront exécutés avec le concours de citoyens scientifiques bénévoles, recrutés et gérés par Oiseaux Canada. Ils se dérouleront dans un vaste éventail de milieux à travers le pays afin de produire des données sur la situation et la répartition des oiseaux au Canada.
En 2022-2023, des représentants des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ainsi que des représentants du Conseil des leaders des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont poursuivi leurs efforts pour parvenir à un accord sur la nature. Les accords sur la nature, élaborés en collaboration avec les provinces et les territoires avec la pleine participation des partenaires autochtones, visent à faire progresser la conservation au Canada, à renforcer le leadership et les partenariats autochtones, et à mettre en place des approches coordonnées et harmonisées, des initiatives ciblées et des investissements à coûts partagés pour la conservation de la nature, la protection des habitats et des écosystèmes, la protection et le rétablissement des espèces en péril, la conservation et la gestion des oiseaux migrateurs, et les solutions aux changements climatiques fondées sur la nature. Les accords contribueront également à soutenir une relance verte en assurant la mise en œuvre coordonnée de solutions axées sur la nature aux changements climatiques.
Résultat ministériel : Les espèces en péril canadiennes sont rétablies
Patrimoine naturel bonifié
En 2022-2023, ECCC a continué de remplir ses obligations et ses engagements découlant de la Loi sur les espèces en péril (LEP), y compris le soutien de l’évaluation des espèces en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Le Ministère a également travaillé à réduire les arriérés d’inscription des espèces en péril, à ramener le degré de conformité à la LEP quant au nombre de documents de rétablissement des espèces en péril exigés par la Loi à 93 % grâce à la publication de programmes de rétablissement, de plans de gestion et de plans d’action et à présenter un rapport mis à jour sur les mesures prises par les provinces et les territoires ainsi que par le gouvernement fédéral pour la protection de l’habitat essentiel des espèces terrestres.
Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a nommé six membres au Conseil autochtone national sur les espèces en péril (CANEP). Conformément à l’article 8.1 de la LEP, le CANEP conseille le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et formule des recommandations sur l’application de la LEP. Il fournit également des conseils et des recommandations à l’ensemble des ministres responsables de la LEP et à leur ministère (y compris ECCC, Parcs Canada et le ministère des Pêches et des Océans). Le conseil s’est réuni en personne en janvier 2023 pour discuter des priorités de son mandat.
ECCC a également continué à faire progresser son approche de conservation des espèces terrestres en péril par l’entremise de la politique sur la LEP, de l’amélioration de ses programmes et de la mise en œuvre de l’Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada (APC-EP). Cette dernière énonce des principes visant à orienter la mise en œuvre collaborative de mesures de conservation par les gouvernements provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral, notamment la collaboration renforcée entre les gouvernements et les peuples autochtones pour la conservation des espèces en péril et de la biodiversité ainsi que l’établissement de critères pour la désignation des lieux, des secteurs et des espèces qui sont des priorités communes en matière de conservation. Le fonds du Patrimoine naturel bonifié (PNB) du Canada fournit ensuite du financement pour soutenir des projets axés sur ces priorités communes.
Dans le cadre des lieux prioritaires du PNB, des projets sont financés dans le but de mobiliser les partenaires et les intervenants, d’établir des cadres de gouvernance, d’approfondir l’élaboration de plans de mise en œuvre de la conservation axée sur les espèces multiples et les écosystèmes et de mettre en œuvre les mesures prioritaires sur le terrain.
En novembre 2022, dans le cadre de l’initiative des lieux prioritaires du PNB, le gouvernement a annoncé un financement de plus de 27,5 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir 67 projets pour les espèces en péril dans 11 lieux prioritaires à travers le Canada. Le lieu prioritaire du paysage forestier de l’Île-du-Prince-Édouard, qui renferme une grande biodiversité et sert d’habitat pour des espèces en péril, en est un exemple. En 2022, trois projets totalisant jusqu’à 2,75 millions de dollars sur quatre ans ont été approuvés ou renouvelés pour soutenir la mise en œuvre continue de mesures de conservation dans ce lieu prioritaire. Ces mesures comprennent un soutien pour que l’Island Nature Trust puisse travailler avec les propriétaires fonciers de milieux humides boisés et de forêts riveraines, sèches et côtières à l’Île-du-Prince-Édouard, afin de cerner et de protéger l’habitat des espèces en péril. Il est connu que cet habitat forestier abrite 13 espèces en péril, dont la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la Paruline du Canada. En outre, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que la Société de conservation Abegweit recevront un financement continu pour soutenir les projets existants dans le lieu prioritaire du paysage forestier.
Le Delta Farmland and Wildlife Trust a également reçu du financement dans le cadre de l’initiative des lieux prioritaires pour les espèces en péril du PNB afin de réaliser des travaux pour la protection de l’habitat de prairie en milieu agricole à Delta, dans le lieu prioritaire du sud-ouest de la Colombie-Britannique. Dans le cours inférieur du delta du fleuve Fraser, il ne reste que 5 % des prairies indigènes. Le Delta Farmland and Wildlife Trust travaille en collaboration avec les agriculteurs pour retirer temporairement des champs de la production agricole, y planter des graminées indigènes et les laisser tels quels en tant que prairies pour les espèces en péril et les espèces autrement préoccupantes. Ces travaux ciblent quatre espèces, à savoir le Grand héron, l’Effraie des clochers, l’Hirondelle rustique et le Hibou des marais.
De plus, dans le cadre de l’initiative sur les espèces prioritaires du PNB, le Ministère a annoncé un financement pouvant atteindre 34,1 millions de dollars pour soutenir 13 nouveaux projets axés sur le rétablissement et la protection de certaines des espèces les plus emblématiques du Canada, partout au pays. Jusqu’à présent, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont désigné six espèces prioritaires communes, à savoir le caribou boréal, le caribou des montagnes du Sud, le caribou de Peary, le caribou de la toundra, le Tétras des armoises et de bison des bois. Ces espèces ont été intégrées à l’Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada. Les espèces désignées comme prioritaires ont en commun ce qui suit : elles font face à des scénarios de menaces complexes et sont réparties sur de vastes territoires, elles ont (ou avaient) de vastes aires de répartition géographique, elles ont une signification particulière pour de nombreux Canadiens, elles ont généralement une importance culturelle particulière pour les peuples autochtones et elles remplissent une importante fonction écologique. La conservation de ces espèces prioritaires peut avoir des avantages importants pour d’autres espèces en péril, la faune en général et les valeurs connexes de la biodiversité.
L’Approche pancanadienne cible également trois secteurs prioritaires, à savoir l’agriculture, la foresterie et le développement urbain. Chacun de ces secteurs prioritaires a été choisi en fonction de ses répercussions sur les espèces en péril et pour son envergure et sa pertinence à l’échelle nationale. Les travaux ont progressé de manière importante dans tous les secteurs prioritaires, notamment ceux qui concernent le soutien aux projets d’innovation au sein des secteurs, la création de mécanismes de collaboration et l’élaboration de cadres stratégiques sectoriels pour la conservation des espèces en péril. En 2021, des investissements financiers fédéraux totalisant 1,2 million de dollars ont financé 10 projets pluriannuels.
En 2022-2023, ECCC a investi 14,2 millions de dollars pour 74 projets dans le cadre de l’initiative des partenariats autochtones, un autre sous-ensemble connexe du financement du PNB distinct de l’Approche pancanadienne qui vise à soutenir le leadership autochtone dans la conservation des espèces en péril et à améliorer les relations avec les peuples autochtones. Les projets qui reçoivent un soutien concernent ce qui suit : les espèces prioritaires (caribou et bison des bois), la surveillance de la santé des espèces fauniques, l’inclusion des connaissances et des priorités des autochtones dans la planification de la conservation d’espèces multiples et les obligations d’ECCC de consulter et de collaborer en vertu de la LEP.
Gestion de la conservation des oiseaux au Canada atlantique
Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la nature, la biodiversité et les espèces en péril du Canada. Les populations d’oiseaux sont d’excellents indicateurs de la santé de l’eau, de l’air et de la terre. Lorsque l’habitat des oiseaux est sain, les communautés en profitent également par l’entremise d’une réduction des inondations et de l’érosion, de la filtration des eaux souterraines et du maintien d’écosystèmes résilients. Malgré leur grande adaptabilité, les recherches montrent que de nombreuses populations d’oiseaux diminuent considérablement. C’est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a établi un partenariat avec Oiseaux Canada, assorti d’une contribution de 384 594 $ de la part du Ministère, afin de gérer des projets locaux de conservation pour la protection des oiseaux migrateurs en péril et leur habitat dans la région du Canada atlantique.
Le Ministère s’est également engagé à verser plus de 3,7 millions de dollars en financement sur trois ans, à partir de 2022-2023, par l’entremise du Fonds autochtone pour les espèces en péril. Ce dernier finance actuellement 33 projets de conservation à travers le Canada. Les projets seront dirigés par des nations et des organisations autochtones, selon leurs valeurs, leurs intérêts et leurs connaissances uniques en matière de mesures de rétablissement des espèces en péril. Le Fonds autochtone pour les espèces en péril joue un rôle important dans la conservation des espèces en péril terrestres de l’ensemble des territoires autochtones. Il appuie le leadership autochtone à long terme dans la gestion des terres, des eaux, des animaux et des végétaux, de même que dans la mise en œuvre de la LEP.
Au cours de l’exercice 2022-2023, le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril a financé, à hauteur de 6,5 millions de dollars, 67 projets de conservation à travers le Canada, dirigés principalement par des organisations non gouvernementales en environnement qui prennent des mesures de rétablissement des espèces en péril dans leur collectivité. Le Programme joue un rôle important dans la conservation des espèces terrestres en péril partout au pays en soutenant l’action locale pour l’intendance des terres, des eaux, des animaux et des végétaux ainsi que la mise en œuvre de la LEP.
En avril 2022, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont conclu un accord en vue de soutenir la conservation et le rétablissement du caribou boréal, une espèce emblématique, dans la province. Le caribou boréal est inscrit comme espèce menacée tant sur la liste de la LEP que sur celle de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. L’accord renforce le programme continu de conservation du caribou de l’Ontario et le plan d’action pour le caribou du gouvernement fédéral, au moyen d’une coopération et d’un investissement dans des mesures de surveillance, de signalement, de protection, de rétablissement, de planification, de gestion et d’intendance.
En décembre 2022, le Ministère a aussi annoncé que le gouvernement du Canada appuiera les mesures du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour la conservation du caribou de la toundra. Cette annonce s’accompagne d’un investissement de 3,8 millions de dollars dans trois projets de conservation. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest versera de son côté un financement égal de 3,8 millions de dollars. Les trois projets permettront de surveiller le caribou de la toundra, son habitat et les menaces susceptibles de toucher les hardes des Territoires du Nord-Ouest, en combinant la science et les connaissances à la fois occidentales et autochtones. Les projets visent également à conserver et à protéger les populations de caribous de la toundra et leur habitat, en s’efforçant de réduire au minimum les répercussions des activités humaines et des prédateurs et en cernant l’habitat important pour le caribou, comme les sites de mise bas et les voies migratoires, pour le conserver. Ces mesures ont été ciblées comme étant prioritaires dans le programme de rétablissement du caribou de la toundra dans les Terrioires-du-Nord-Ouest, en 2020.
En 2022-2023, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), ECCC a continué de transmettre des connaissances et des renseignements pour l’évaluation de projets qui touchent à des questions liées aux changements climatiques, à la qualité de l’air, à la qualité de l’eau, à la préparation en cas d’urgence environnementale et à la biodiversité. Ces contributions comprenaient la formulation de conseils sur la caractérisation des effets et de l’efficacité des mesures d’atténuation. En particulier, le Ministère a poursuivi, en 2022-2023, l’élaboration de la version définitive du guide technique relatif à l’évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC). Alors que l’ESCC donne des indications sur la manière dont les changements climatiques devraient être pris en compte dans les évaluations d’impacts pour garantir une transparence, une clarté, une cohérence et une certitude à l’égard des processus plus grandes, les documents d’accompagnement fourniront des directives techniques supplémentaires sur des éléments précis de l’ESCC afin de permettre aux promoteurs d’être mieux préparés aux évaluations d’impacts, et ainsi faire en sorte d’accélérer le processus d’évaluation.
Utilisation de mesures allternatives en matière de conformité et d’application de la loi
En décembre 2022, la société Ocean’s Seafood remplissait les critères d’un accord sur les mesures de rechange, lequel a été conclu après que des accusations aient été déposées contre la société en vertu de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Dans le cadre de cet accord, la société a versé une contribution de 30 000 $ au Fonds pour dommages à l’environnement. Elle a également remis à la Couronne de la viande d’anguille importée afin de retirer du marché les produits importés illégalement. En outre, l’entreprise devait mettre en œuvre un programme de formation des employés axé sur la conformité à la Loi. Comme l’entreprise a mis en œuvre toutes les mesures prévues dans l’accord sur les mesures de rechange, les accusations contre l’entreprise ont été retirées.
Tout au long de 2022-2023, ECCC a maintenu les activités en cours pour protéger les espèces sauvages et leur habitat des actions des entreprises et des particuliers. Les agents d’application de la loi sur la faune d’ECCC ont continué à mener des inspections et des enquêtes selon l’approche fondée sur les risques pour la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, la vérification de la conformité dans les milieux protégés fédéraux et l’intervention en cas de destruction d’habitat d’espèces sauvages, d’habitat essentiel et d’aires protégées. Ces activités comprenaient les suivantes :
- réponse à de multiples plaintes et renseignements reçus du public concernant la destruction de l’habitat et d’espèces sauvages;
- inspections, activités d’application de la loi et vérifications auprès de chasseurs, de même qu’une série d’opérations-éclairs aux postes frontaliers à la recherche de preuves d’exportations illégales d’espèces canadiennes et d’importations illégales d’espèces exotiques;
- participation, en octobre 2022, à l’opération Thunder 2020 d’INTERPOL, un effort international d’application des lois, déployé en collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes, visant à réprimer les crimes commis contre les espèces sauvages, dont la contrebande, le braconnage et le trafic. À la suite d’inspections dans le cadre de cette opération, les agents d’application de la loi sur la faune d’ECCC ont saisi de nombreuses cargaisons d’espèces visées par la CITES arrivées sans permis aux aéroports internationaux de Toronto, de Montréal et de Calgary ainsi qu’à des gares de marchandises à travers le pays, notamment de l’huile de crocodile, des cactus raquettes, des parties d’hippopotames et de morses, des ocadies de Chine (tortues) vivantes, un crâne de girafe et de nombreuses autres espèces.
Dans le cadre de leurs activités, les agents d’application de la loi sur la faune ont répondu à plus de 126 plaintes et renseignements reçus du public concernant la destruction de l’habitat et d’espèces sauvages. Ils ont réalisé 6657 inspections, dont 5830 étaient liées aux priorités fondées sur les risques, comme le contrôle des points d’entrée, des pourvoyeurs et des réserves nationales de faune. Les agents d’application de la loi ont déclenché 102 nouvelles enquêtes en vertu des lois sur la faune en vigueur et mis en œuvre 470 mesures d’application de la loi, à savoir l’imposition de sanctions administratives pécuniaires, des ordonnances de conformité, des poursuites judiciaires, des contraventions, des avertissements et des mesures de rechange.
Les enquêtes ont donné lieu à 4 condamnations et à 11 nouvelles poursuites. Au total, des sanctions de 260 959 de dollars ont été imposées à la suite d’activités d’application de la loi entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Les articles confisqués étaient notamment des ingrédients médicinaux, des produits finis, des spécimens morts, des spécimens vivants et des trophées de chasse. Les sanctions administratives pécuniaires, dont la valeur atteignait 169 000 de dollars, ont été imposées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Les montants perçus sous forme de sanctions ont été versés au Fonds pour dommages à l’environnement.
En outre, en appui à l’engagement de freiner le commerce illégal des espèces sauvages pris dans la lettre de mandat du ministre, le Ministère a, en 2022-2023, collaboré avec des organisations partenaires afin d’accroître la collecte et l’analyse de renseignements, et réalisé diverses inspections en s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques.
Résultat ministériel : Les peuples autochtones sont impliqués dans la conservation
Lors de la COP15, en décembre 2022, le premier ministre a annoncé un financement de 800 millions de dollars pour quatre initiatives de financement de projets à perpétuité (FPP) dirigées par des Autochtones. Les initiatives sont toutes dirigées par des promoteurs autochtones qui sont déterminés à collaborer pour protéger et conserver la nature. Le modèle des FPP réunira des organisations autochtones, des gouvernements, des ONGE et des organisations philanthropiques afin de tirer le maximum du financement durable pour la protection à long terme de la nature, notamment en réalisant d’importants progrès vers l’atteinte de l’objectif du Canada de conserver 25 pour cent des terres et des eaux intérieures d’ici 2025, et d’en conserver 30 pour cent d’ici 2030. Les quatre initiatives de FPP seront réalisées dans les régions suivantes :
- les Territoires du Nord-Ouest, avec la participation de gouvernements et d’organisations autochtones à travers le territoire;
- la mer de Great Bear dans la biorégion du plateau Nord, en Colombie-Britannique;
- la région de Qikiqtani, au Nunavut;
- les basses-terres de la baie d’Hudson, en Ontario, y compris la côte ouest de la baie.
En 2022-2023, la Première Nation des Chipewyans d’Athabasca (PNCA), la Première Nation crie Mikisew (PNCM) et le gouvernement du Canada ont signé un accord de conservation en vertu de l’article 11 de la LEP afin de collaborer à faire progresser le rétablissement et la protection du caribou boréal dans le nord-est de l’Alberta. L’accord prévoit des mesures de soutien aux activités de conservation dirigées par les Autochtones et établit de nouveaux modes de partenariat entre les nations autochtones et le gouvernement du Canada. Les mesures de conservation sont notamment l’élaboration d’un plan d’intendance autochtone pour le caribou boréal, la collecte des connaissances autochtones, la formation sur les pratiques de remise en état de l’habitat et un programme pilote de gardiens autochtones pour améliorer la surveillance du caribou et de son habitat sur le terrain. ECCC soutient les mesures de conservation prévues à l’accord au titre de l’article 11 au moyen d’accords de contribution de quatre ans conclus avec la PNCA (462 500 dollars/quatre ans) et la PNCM (490 500 dollars/quatre ans).
De septembre à novembre 2022, le Ministère a sollicité des expressions d’intérêt pour le financement, jusqu’à 40 millions de dollars, de projets de conservation par zone dirigés par des Autochtones. Pour être admissibles à du financement, les projets devaient être dirigés par des Autochtones, contribuer à l’atteinte des cibles de conservation du Canada au cours des prochaines années et avoir le soutien des gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés ou de l’autorité compétente. Les Autochtones du Canada sont des gardiens de l’environnement terrestre, aquatique et glaciaire depuis longtemps, et ils sont les premiers leaders en développement durable et en gestion des ressources. C’est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de soutenir le leadership autochtone en matière de conservation, au moment où nous devons faire face à la double crise de la perte de biodiversité et des changements climatiques.
Dans le cadre des investissements historiques du Canada pour la conservation de la nature prévus au budget de 2021, soit 2,3 milliards de dollars sur cinq ans pour l’initiative du Patrimoine naturel bonifié, ECCC investira jusqu’à 340 millions de dollars sur cinq ans en fonds nouveaux pour soutenir le leadership autochtone en matière de conservation. De ce financement, un montant pouvant atteindre 173 millions de dollars servira à financer des initiatives de gardiens autochtones nouvelles et existantes, ainsi que l’établissement des réseaux de gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. À la COP15, en décembre 2022, le lancement du nouveau Réseau des gardiens des Premières Nations a été annoncé, ce qui représente un grand pas vers la réconciliation et l’autodétermination. Ce réseau permettra l’établissement d’un modèle d’autodétermination centré sur la nation et d’un modèle de réconciliation et de partenariat de nation à nation pour la gestion responsable des terres et des eaux marines. L’initiative des gardiens autochtones soutient les peuples autochtones dans la protection et la conservation de l’environnement, le développement et le maintien d’économies durables, et la poursuite des liens profonds entre les cultures autochtones et la nature.
Gardiens autochtones
Les gardiens autochtones sont « les yeux et les oreilles sur le terrain » dans les territoires autochtones, de même qu’un exemple unique de réconciliation en action. Ils surveillent la santé écologique, entretiennent les sites culturels et protègent les zones et les espèces sensibles. Les initiatives des gardiens soutiennent les Autochtones dans la protection des terres, des eaux et des glaces sur leur territoire ancestral au moyen d’initiatives d’intendance sur le terrain, centrées sur les communautés. Les gardiens autochtones favorisent également la santé sociale et communautaire grâce à des liens entre la terre, la culture et la langue.
Depuis sa création en 2018, le programme des gardiens a apporté un soutien à plus de 170 initiatives, qui ont contribué au renforcement des capacités et à la création d’emplois dans les communautés autochtones partout au pays. Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir le leadership des peuples autochtones afin d’aider à conserver les écosystèmes, à protéger les cultures autochtones et à développer des économies durables pour les générations futures. La lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité exige un effort collectif et des changements systémiques dans nos rapports avec la nature. Ces changements doivent comprendre le respect des connaissances et de la science autochtones issues de l’expérience des Premières Nations, des Inuits et des Métis en tant que gardiens des terres, des eaux et des glaces.
En 2022-2023, ECCC a annoncé un financement de près de 30 millions de dollars pour plus de 80 initiatives de gardiens par des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le pays. Ces initiatives visent à s’attaquer à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité, qui sévit d’un océan à l’autre, et à profiter aux communautés autochtones, à l’environnement naturel et aux espèces en péril, dont le caribou boréal. ECCC s’est également engagé à produire des connaissances en collaboration avec les peuples autochtones afin de renforcer les activités de conservation locales. Les scientifiques de la faune d’ECCC sont en relation avec les communautés autochtones pour acquérir une compréhension approfondie des besoins en matière d’habitat des espèces en péril, comme le caribou de Peary, et des menaces qui pèsent sur elles.
En décembre 2022, le Ministère s’est engagé à financer, à hauteur de 5,8 millions de dollars, 14 initiatives dirigées par des Autochtones dans le cadre de l’initiative des solutions climatiques naturelles dirigées par des Autochtones. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature est un fonds de 1,4 milliard de dollars sur dix ans qui contribuera au soutien de projets de conservation, de remise en état et d’amélioration des zones humides, des tourbières et des prairies afin de capter et de stocker le carbone. De cette somme, jusqu’à 76,9 millions de dollars serviront à offrir un soutien ciblé aux Autochtones dans le cadre du volet de financement des solutions climatiques naturelles dirigées par des Autochtones. Les initiatives dirigées par des Autochtones, qui se déroulent partout au pays, sont axées sur le renforcement des capacités et la réduction des émissions de GES, en plus de procurer d’importants bienfaits pour renforcer la santé et la résilience des nations et des communautés.
Le portrait le plus complet de la biodiversité du Canada jusqu’à maintenant
En novembre 2022, le Ministère a publié le document intitulé Espèces sauvages 2020 : la situation générale des espèces au Canada, une initiative réalisée en collaboration avec les provinces et les territoires qui présente le portrait le plus complet de la biodiversité du Canada jusqu’à maintenant. Avec l’objectif d’approfondir la compréhension de la situation et de la répartition des espèces sauvages dans l’ensemble du pays, le rapport sur les espèces sauvages fait, pour la première fois, le point sur plus de la moitié des espèces connues au Canada. Il traite de 50 534 espèces, soit plus de 20 000 de plus par rapport à l’édition précédente, publiée cinq ans auparavant. Les résultats du rapport indiquent que 80 pour cent des espèces évaluées ne sont pas en péril, contre 20 % qui font face à un certain degré de risque de disparition du Canada.
L’Accord sur la nature entre le Canada et le Yukon prévoit un financement de 5,9 millions de dollars en fonds fédéraux pour favoriser la participation des Autochtones. De cette somme, 4,3 millions de dollars seront versés aux bénéficiaires autochtones pour soutenir leur collaboration et leur participation à la planification de la conservation et aux travaux sur les espèces en péril dans le cadre de l’Accord.
Le 17 décembre 2022, lors de la COP15, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest ainsi que Danny Gaudet, Ɂek’wahtı̨dǝ́ (chef) du gouvernement Délı̨nę Got’ı̨nę, ont signé une lettre d’intention visant à soutenir l’établissement de l’aire protégée et de conservation autochtone de Sahtú K’aowe autour du Grand lac de l’Ours (Tsá Tué), dans les Territoires du Nord-Ouest. Tsá Tué, qui se classe au huitième rang des plus grands lacs du monde, est important sur le plan culturel pour les peuples dénés et précieux sur le plan écologique pour le Canada. Le lac chevauche le cercle polaire arctique, et il est entouré de forêt boréale. Sa superficie dépasse les 31 000 km2, soit environ 0,3 % de la masse continentale du Canada, et il est l’un des écosystèmes les plus intacts au monde. Le bassin hydrographique du Tsá Tué procure un important habitat pour des espèces emblématiques du Canada, dont le bœuf musqué, l’orignal et le caribou.
Analyse comparative entre les sexes plus
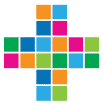
En 2022-2023, ECCC a poursuivi ses travaux pour concrétiser ses objectifs de protection et de rétablissement des espèces, tout en reconnaissant que les réserves et les terres autochtones procurent souvent un refuge aux espèces en péril et aux oiseaux migrateurs. Les peuples autochtones du Canada possèdent également des connaissances traditionnelles essentielles pour l’atteinte de ces objectifs. Afin de garantir la prise en compte des systèmes de connaissances autochtones, tout en réduisant les effets de la fatigue de consultation et de la collecte à répétition de connaissances sur les espèces, le Ministère a concentré ses efforts sur des approches de conservation visant des espèces multiples et sur l’amélioration de la coordination entre les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Dans ses efforts visant à remplir les engagements du Canada en matière de biodiversité, ECCC a sollicité activement la participation de divers groupes de personnes, dont les communautés autochtones, aux initiatives de conservation. ECCC a réalisé annuellement une enquête auprès des partenaires autochtones pour recueillir leurs commentaires quant au caractère significatif de ses efforts de mobilisation. Le Ministère a continué de fournir des conseils d’experts et des connaissances spécialisées dans le cadre du processus d’évaluation fédéral, afin de soutenir les décisions en matière de développement des ressources qui atténuent les effets néfastes sur les populations en péril.
Programme de développement durable à l’horizon 2030Note de bas de page 33 et objectifs de développement durable des Nations Unies

Dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril, ECCC s’efforce d’empêcher la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d’espèces sauvages disparues du Canada, en voie de disparition ou menacées, et de gérer les espèces préoccupantes de manière à éviter qu’elles deviennent en voie de disparition ou menacées. Les mesures indépendantes visant des espèces précises sont complémentées par des mesures stratégiques visant des espèces multiples et axées sur les écosystèmes. Ces dernières sont centrées sur un ensemble de lieux, d’espèces et de secteurs prioritaires définis en collaboration avec les provinces et les territoires du Canada, réunis autour d’une approche pancanadienne.
L’Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada, de même que les nouveaux investissements considérables qui l’accompagnent pour les aires protégées (fédérales et autres) dans le cadre de l’initiative du Patrimoine naturel bonifié, complémentent des mesures continues pour la protection des milieux humides, la gestion de l’habitat et la conservation des espèces sauvages marines et terrestres. Ensemble, ces mesures servent à conserver la biodiversité ainsi que la qualité et la viabilité des écosystèmes naturels, à préserver et à restaurer la qualité de l’air et de l’eau, et à favoriser la durabilité de l’utilisation des terres et des pratiques de récolte des espèces sauvages.
Les activités d’ECCC visant à conserver la nature et à protéger les espèces en péril marines et terrestres de même que leur habitat contribuent aux objectifs de développement durable (ODD) suivants : villes et communautés durables (objectif 11), vie aquatique (objectif 14) et vie terrestre (objectif 15).
En tant que responsable des négociations et de la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité biologique (CDB) ainsi que d’autres conventions, notamment sur la mobilisation des ressources et le financement relatif à la biodiversité, ECCC contribue également à l’objectif 17. Ces travaux visent à garantir un financement adéquat pour que les objectifs et les cibles de la stratégie sur la biodiversité puissent être atteints dans le cadre des ODD qui touchent à la protection, à la remise en état et à l’utilisation durable de la biodiversité et de la nature. Le Ministère vise ainsi à garantir la cohérence entre les activités nationales et internationaux et nationaux en matière de biodiversité.
Le plan fédéral de mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 engage le gouvernement à aborder les ODD d’une manière qui soit guidée par les principes des droits de la personne et qui fasse progresser la réconciliation avec les peuples autochtones par le respect et la pleine protection de leurs droits. En 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale, obligeant ainsi tous les ministères à ajuster leurs travaux pour qu’ils respectent les droits qui y sont énoncés. La mise en œuvre de la Loi à ECCC sera l’occasion de lier la protection, la gestion et la conservation au respect et à la protection de tous les droits des peuples autochtones.
Pour de plus amples renseignements sur les mesures prises dans le cadre de cette responsabilité essentielle contribuant aux ODD, veuillez consulter la Stratégie ministérielle de développement durable d’ECCC de 2020 à 2023.
Innovation et expérimentation
Innovation en matière de surveillance des espèces sauvages
Depuis plusieurs années, ECCC expérimente de nouvelles approches de surveillance des populations d’espèces sauvages et les compare avec les méthodes de relevés traditionnelles. Certaines de ces expériences se sont poursuivies en 2022-2023, dont les essais d’enregistreurs audio numériques pour la surveillance des oiseaux migrateurs, par exemple. Ces essais comprenaient l’évaluation d’une interface en ligne pour interpréter les enregistrements, le mise au point de méthodes faisant intervenir l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage profond (AP) pour la validation des identifications, et la comparaison des résultats avec ceux obtenus par des observateurs sur le terrain.
Principaux risques
La capacité du Ministère de mobiliser les principales parties prenantes et d’inclure les points de vue des communautés autochtones dans les décisions est essentielle à l’exécution des travaux techniques de surveillance des populations d’espèces sauvages sur le terrain et à la production de résultats en matière de conservation. Afin de garantir des partenariats et une mobilisation porteurs de résultats, et ainsi atténuer les risques pour l’exécution de son mandat, ECCC a collaboré avec des partenaires externes pour tirer profit des sources existantes de données scientifiques et faire progresser les activités de conservation essentielles. Cela comprenait :
- des partenariats avec Oiseaux Canada et Canards illimités Canada pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs et des milieux humides;
- la ratification du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal lors de la COP15 en décembre 2022;
- l’intégration des points de vue des communautés autochtones lors de la conclusion de l’accord avec les Territoires du Nord-Ouest pour la protection d’Edéhzhíe et de Tsá Tué (Grand lac de l’Ours).
Le maintien d’une gestion et d’une utilisation efficaces des renseignements est aussi essentiel à la capacité d’ECCC de prendre, en temps opportun, des décisions fondées sur des données probantes en matière de conservation. Ainsi, en suivant la feuille de route de la Stratégie numérique et la Stratégie liée aux données et à l’analyse, le Ministère a poursuivi la mise en œuvre d’une approche stratégique quant aux investissements dans des systèmes de gestion de l’information de même que dans des infrastructures et des outils permettant une gestion et une circulation appropriées de l’information. Ces aspects sont d’une importance capitale lorsqu’il s’agit, par exemple, de fournir une expertise et des conseils qui tiennent compte des facteurs liés à la biodiversité lors de l’évaluation de projets dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Résultats obtenus
| Indicateur de rendement | Cible | Date d’atteinte de la cible | 2020-2021 Résultats réels |
2021-2022 Résultats réels |
2022-2023 Résultats réels |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage d’espèces d’oiseaux migrateurs qui se trouvent dans les plages de populations ciblées. | 70 % | Décembre 2030 | Résultats non connus | Résultats non connusNote de bas de page 34 | Résultats non connusNote de bas de page 35 |
| Pourcentage d’aires canadiennes conservées comme aires protégées et par d’autres mesures de conservation efficaces par zone. | Augmentation pour atteindre 17 % à 20 % par rapport à la référence de 10,6 % en 2015 (milieux terrestres et eaux intérieures) | Mars 2025 | 12,5 % | 13,5 %Note de bas de page 36 | 13,6 % en date de décembre 2022Note de bas de page 37 |
| Indicateur de rendement | Cible | Date d’atteinte de la cible | 2020-2021 Résultats réels |
2021-2022 Résultats réels |
2022-2023 Résultats réels |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage des espèces en péril pour lesquelles les changements dans les populations sont conformes aux objectifs de rétablissement et de gestionNote de bas de page 38 | 60 % | Mai 2025 | 42 % | 41 %Note de bas de page 39 | 43 %Note de bas de page 40 |
| Indicateur de rendement | Cible | Date d’atteinte de la cible | 2020-2021 Résultats réels |
2021-2022 Résultats réels |
2022-2023 Résultats réels |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage des peuples autochtones engagés auprès d’ECCC qui indiquent que cette participation a été significative | 61 % | En avril de chaque année | 64 % | 70 % | 66 %Note de bas de page 41 |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources financières budgétaires (en dollars)
Le tableau suivant montre, à l’égard de la conservation de la nature, les dépenses budgétaires et les dépenses réelles pour 2022-2023.
| Budget principal des dépenses 2022-2023 | Dépenses prévues 2022-2023 |
Autorisations totales pouvant être utilisées en 2022-2023 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2022-2023 | Écart (dépenses réelles moins dépenses prévues) en 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| 609 338 156 | 609 338 156 | 643 983 141 | 576 201 081 | -33 137 075 |
* Les dépenses réelles sont plus faibles que celles prévues pour l’exercice 2022-2023, principalement en raison de reports de fonds à des années ultérieures afin de conserver les terres et les eaux douces du Canada, de protéger les espèces, de faire progresser la réconciliation avec les Autochtones et d’accroître l’accès à la nature dans le cadre du Patrimoine naturel bonifié. L’écart s’explique également par la réduction des dépenses pour la Loi sur les espèces en péril, la protection de la nature, des parcs et des espaces sauvages du Canada (patrimoine naturel), et la mise en œuvre des solutions climatiques naturelles au Canada. Ces réductions sont compensées par des dépenses pour la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, des versements à des organismes sans but lucratif nationaux et à des Premières Nations, et des augmentations économiques liées à la compensation.
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources humaines (ETP)
Le tableau suivant indique, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère a besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023.
| ETP prévus 2022–2023 | ETP réels 2022–2023 | Écart (dépenses réelles moins dépenses prévues) en 2022-2023 |
|---|---|---|
| 1 477 | 1 487 | 10 |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes de Savoir polaire Canada sont accessibles dans InfoBase du GC.
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
DescriptionNote de bas de page 42
Surveiller les conditions météorologiques, l’eau, la qualité de l’air et les conditions climatiques, fournir à la population canadienne et aux secteurs ciblés des prévisions, de l’information et des avertissements au moyen d’un vaste éventail de modes de prestation de services, de réaliser des recherches, de concevoir et tenir à jour des modèles informatiques pour la prévision météorologique et d’autres conditions environnementales et de recueillir des données et en permettre l’échange avec d’autres services météorologiques nationaux et des organisations internationales.
Résultats
Résultat ministériel : Les Canadiens utilisent des renseignements météorologiques et des informations connexes faisant autorité pour prendre des décisions éclairées pour leur santé et leur sécurité
Ouragan Fiona
En septembre 2022, l’ouragan Fiona s’est abattu sur le Canada atlantique en tant que cyclone post-tropical et était accompagné de vents de la force d’un ouragan de catégorie 2. Cette tempête est arrivée avec la pression barométrique la plus basse jamais enregistrée pour une tempête sur les terres au Canada, avec une basse pression centrale de 931,15 hPa. Le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO) a joué un rôle essentiel en appuyant la communauté de la gestion des urgences. Le Centre a offert 114 séances d’information et produits techniques aux opérations et aux médias, dont des renseignements et des messages ciblés pour les secteurs et les industries vulnérables, ainsi que des séances d’information aux organisations autochtones.
Le Ministère a également dépêché des météorologues dans les centres provinciaux des opérations d’urgence pendant la tempête, ce qui a permis au CCPO de fournir un soutien direct et immédiat aux responsables de la gestion des urgences.
Les provinces ont reconnu que la mobilisation précoce et la coordination étroite avec les gestionnaires des urgences et d’autres partenaires clés avaient été déterminantes lors de leur préparation. Les séances d’information technique aux médias suivies de près ont contribué à une très grande sensibilisation et préparation du public. L’intérêt des médias internationaux à l’égard l’ouragan Fiona a dépassé celui de toute autre tempête tropicale antérieure.
Avec plus de 150 ans d’activité, le Service météorologique du Canada (SMC) a une longue et fière histoire de services rendus aux Canadiens. Il leur fournit des renseignements exacts et opportuns sur les conditions météorologiques et environnementales pour les aider à prendre des décisions concernant leur santé, leur sécurité et leur bien-être économique.
L’application MétéoCAN d’ECCC a continué de fournir des renseignements météorologiques en direct tout au long de l’exercice 2022-2023. L’application a été téléchargée plus de 2,5 millions de fois depuis son lancement en février 2019 et est consultée environ 680 000 fois par mois par les utilisateurs actifs. MétéoCAN fournit des observations et des prévisions météorologiques faciles à comprendre pour presque toutes les collectivités du Canada. Son centre de messages unique est utilisé pour fournir des renseignements contextuels sur la météo et le climat. Grâce à ce système, les Canadiens peuvent accéder aux conditions météorologiques actuelles et futures et recevoir des « notifications prioritaires » pour les alertes météorologiques partout au Canada.
En 2022-2023, ECCC a ajouté à l’application MétéoCAN une capacité de notifications personnalisées en fonction de seuils de cote air santé (CAS). Elle permet aux utilisateurs de configurer des notifications personnalisées en fonction de leur niveau de risque personnel et de leur sensibilité à la pollution atmosphérique.
Les Canadiens continuent d’accéder aux prévisions et avertissements météorologiques les plus récents : en visitant le site Web météo d’ECCC; en utilisant le système téléphonique automatisé Bonjour Météo; en accédant à l’information par l’intermédiaire de l’application MétéoCAN et du Système national d’alertes au public (SNAP); en écoutant les médias locaux.
En 2022-2023, ECCC a continué de tirer parti des médias sociaux pour élargir sa portée lorsqu’il informe les Canadiens de la possibilité d’événements météorologiques à forte incidence. Les avertissements météorologiques fournissent de l’information qui peut aider les Canadiens, notamment les personnes âgées vulnérables, les enfants, les sans-abris, les malades chroniques ou leurs aidants naturels, à prendre des décisions éclairées en réponse à différents scénarios météorologiques qui peuvent présenter des risques accrus pour eux. ECCC a également utilisé les plateformes d’échange d’information comme Facebook et X (Twitter) pour diffuser des messages sur la météo et obtenir des commentaires de la population canadienne.
Les Canadiens ont également accès à Bonjour Météo dans les deux langues officielles depuis l’automne 2021. Il s’agit d’un numéro sans frais accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet à toute personne en Amérique du Nord d’accéder à un répertoire des emplacements et d’obtenir des renseignements sur les alertes, ainsi que les plus récentes observations et prévisions pour un emplacement donné. En 2022-2023, le service Bonjour Météo a reçu plus de 5 millions d’appels.
Le Ministère a également continué de fournir des services d’interprétation et d’aide à la décision aux organismes provinciaux de gestion des urgences et de santé publique afin d’appuyer la préparation civile générale en cas d’événements météorologiques à fortes répercussions. Les météorologues d’ECCC ont continué de se concentrer sur les tempêtes et les événements environnementaux qui pourraient avoir des répercussions sur le Canada, et d’émettre des avertissements en fonction de la trajectoire, de l’emplacement et de l’intensité d’un événement météorologique. En 2022-2023, l’ouragan Fiona et la tempête de vent Derecho qui a traversé le sud de l’Ontario et du Québec sont les deux phénomènes météorologiques les plus violents ayant eu une incidence sur la sécurité des Canadiens et qui ont mobilisé le SMC et ses partenaires.
Diffusion des données météorologiques
Chaque jour, ECCC répond à entre 65 et 75 millions de demandes de données et de produits météorologiques et environnementaux de machine à machine. Les météorologues et les scientifiques du Ministère travaillent jour et nuit dans les centres de prévision partout au pays pour tirer parti des résultats des modèles de calculs de haute performance et les transformer en avertissements, en prévisions et en conseils d’experts sur les conditions météorologiques et les conditions météorologiques extrêmes. Ces renseignements sont diffusés par divers canaux et utilisés pour la prise de décisions par les autorités publiques, comme les gestionnaires des urgences, les intervenants et les Canadiens en général.
En 2022-2023, les systèmes à la fine pointe de la technologie d’ECCC en matière de prévisions météorologiques et environnementales, de diffusion et d’alerte rapide ont continué d’informer les Canadiens à l’approche des phénomènes météorologiques violents. Ils fournissent des avis et des avertissements sur les tempêtes, les vagues de chaleur, les conditions de qualité de l’air, les rivières atmosphériques et les ouragans. Les météorologues ont continué de mettre l’accent sur les tempêtes susceptibles de toucher le Canada et d’émettre des avertissements en fonction de la trajectoire, de l’emplacement et de l’intensité de l’événement météorologique.
En 2022-2023, la nouvelle technologie de diffusion immédiate (DI) d’ECCC a été mise à profit plus de 640 fois pour fournir aux Canadiens des avertissements de tornade. La nouvelle capacité d’alerte a été établie en 2021 et permet aux météorologues d’ECCC de tirer parti de la technologie de DI du SNAP. À son tour, la technologie de DI permet au Ministère d’aviser la population d’une zone donnée sur son téléphone cellulaire, ou par la télévision et la radio, de la possibilité d’un violent orage ou d’une tornade. La capacité de DI a été utilisée en mai 2022 pour avertir les Canadiens qu’une tempête de vent de type derecho se déplaçant rapidement et traversait le sud de l’Ontario et du Québec. La tempête a fait 11 morts, abattu des arbres et entraîné des pannes de courant importantes.
L’année 2022 a marqué le 35e anniversaire du Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO). Le CCPO est une source canadienne de renseignements météorologiques fiables sur les cyclones tropicaux qui se trouvent au Canada ou qui s’en approchent. La principale responsabilité du CCPO est de fournir des prévisions et des avertissements sur les cyclones tropicaux qui menacent le Canada ou les eaux canadiennes afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées pour protéger leur sécurité et leurs biens. L’une des principales responsabilités du CCPO est de collaborer efficacement avec les organismes de gestion des urgences de tous les ordres de gouvernement, non seulement lorsque ces tempêtes menacent, mais aussi avant le début de la saison.
Depuis sa création, le CCPO a émis plus de 2500 bulletins d’information sur les cyclones tropicaux pour plus de 125 tempêtes, fournissant ainsi des renseignements météorologiques essentiels aux entreprises et à la population sensibles aux conditions météorologiques. En moyenne, le CCPO réagit à trois ou quatre cyclones tropicaux chaque année, dont un ou deux touchent le sol canadien et deux ou trois menacent les eaux du large, peu importe le nombre de tempêtes prévues pour l’ensemble du bassin de l’Atlantique. Habituellement, les ouragans sont plus préoccupants dans les eaux canadiennes plus tard au cours de la saison, mais le CCPO surveille l’océan Atlantique toute l’année pour détecter tout cyclone tropical ou semblable qui pourrait toucher le Canada ou ses eaux.
En 2022-2023, ECCC a continué de mettre en œuvre le Programme canadien de remplacement des radars météorologiques canadiens. Cette initiative vise à remplacer la technologie désuète par 33 nouveaux radars d’ici mars 2024. Trente et un nouveaux systèmes de radars météorologiques ont été installés en mars 2023, et les deux autres radars devraient être installés d’ici la fin de 2023.
Les radars sont les principaux outils utilisés par les météorologues pour prévoir les phénomènes météorologiques violents à court terme associés aux orages, aux tornades, aux tempêtes de verglas et aux blizzards. Les nouveaux radars utilisent la technologie la plus moderne disponible et fournissent des renseignements hautement détaillés sur le type de précipitations et la structure des tempêtes. Ils permettent à ECCC de donner aux Canadiens le temps de se protéger et de protéger leurs biens contre les phénomènes météorologiques violents.
En 2022-2023, le système d’ordinateur haute performance (OHP) d’ECCC a été mis à niveau pour le rendre plus rapide et plus puissant. Les deux superordinateurs d’ECCC se classent maintenant parmi les 100 ordinateurs les plus rapides au monde. Cette mise à niveau permet l’avancement continu de la recherche et du développement et la livraison ininterrompue de données et de produits de prévisions opérationnelles. De plus, en 2022-2023, les données du réseau radar amélioré du Canada ont été intégrées en temps réel au système national de prévisions du Canada. Grâce à ces améliorations, ECCC consolide sa position parmi les trois principaux centres au monde pour l’exactitude des prévisions sur un ou deux jours en Amérique du Nord.
L’exploitation efficace des capacités d’observation de la Terre par satellite est de plus en plus importante pour les programmes et les services d’ECCC. En réponse à l’initiative Ingénieux, résilient, prêt : Stratégie canadienne de l’observation de la Terre par satellite, ECCC a travaillé avec des partenaires fédéraux en 2022-2023 pour produire une feuille de route interne d’observation de la Terre par satellite. Il s’agit de fournir un portefeuille d’activités qui répondent aux objectifs de la Stratégie et qui peuvent être mises de l’avant conformément à d’autres priorités.
ECCC a continué de fournir des données et de l’information sur les niveaux et les débits d’eau en temps réel aux clients provinciaux et territoriaux tout au long de 2022-2023. Ainsi, les Canadiens, les organisations provinciales et territoriales de gestion des urgences et les entreprises vulnérables aux conditions météorologiques peuvent mieux se préparer aux événements météorologiques et aux inondations, prendre des décisions sur les mesures d’atténuation et d’intervention et devenir plus résilients aux conséquences des changements climatiques. La surveillance systématique des niveaux et des débits d’eau demeure une priorité constante au Canada et continue d’être de plus en plus importante. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et l’Arctique canadien se réchauffe presque trois fois plus vite que le reste du monde. Un climat plus chaud se traduit par un plus grand nombre d’événements météorologiques extrêmes, notamment une augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations.
En 2022-2023, les Services hydrologiques nationaux (SHN) d’ECCC ont continué de moderniser et de renforcer leur capacité technique et leur infrastructure hydrométrique. Ils ont fait des progrès dans la mise en place de nouvelles technologies pour recueillir et analyser l’information sur l’eau. Les SHN ont également collaboré avec des partenaires clés, dont les provinces et les territoires, pour élaborer des produits et des services de prévision de la quantité d’eau. Ces travaux ciblaient les grands bassins du Canada et accéléraient considérablement la recherche, ce qui a mené à la mise au point de systèmes de prévision hydrométéorologique. ECCC a maintenant en place une série de produits opérationnels de prévision hydrologique disponibles en ligne afin d’appuyer les prévisions hydrologiques pour les provinces et les territoires et d’autres partenaires à l’échelle du Canada.
ECCC a également continué de fournir des avis d’experts et des recommandations aux conseils de gestion des eaux relevant de plusieurs juridictions et des eaux internationales. Ces travaux, qui seront terminés d’ici la fin de 2023-2024, représentent les composantes essentielles d’un investissement de 90 millions de dollars du gouvernement fédéral visant à moderniser les modèles et les systèmes d’ingénierie et offrir une meilleure prestation de services aux organismes partenaires qui participent à la gestion des eaux nationales et transfrontalières partout au Canada.
En 2022-2023, ECCC a poursuivi sa cogestion avec les conseils et les comités internationaux de gestion des eaux, conformément aux plans et aux engagements prévus dans le cadre d’un protocole d’entente (PE) de la Commission mixte internationale (CMI) et d’autres protocoles d’entente interprovinciaux. ECCC fournit un soutien en matière de données, de technologie, d’ingénierie et de communication aux conseils et aux comités de la CMI et participe à un total de 17 conseils de la CMI et à trois comités internationaux non membres de la CMI. Principales réalisations en 2022-2023 :
- Publication d’une ébauche du rapport post-inondation 2022 émis par le Comité de contrôle des niveaux d’eau du Conseil international du bassin du lac des Bois et lac à la Pluie pour recueillir les commentaires du public. Au printemps et à l’été 2022, la chaîne de lacs de Namakan et le lac à la Pluie ont atteint certains des niveaux d’eau les plus élevés jamais enregistrés. L’inondation a été une catastrophe naturelle qui a duré de nombreuses semaines, les lacs à la Pluie et Namakan ayant atteint des niveaux d’eau record.
- Achèvement de la deuxième année du Groupe d’étude international des rivières St. Mary et Milk grâce à une collaboration continue entre les divers ordres de gouvernement, notamment la mobilisation des nations autochtones et du public. Ces efforts collectifs devraient produire des avantages à long terme pour l’adaptation aux changements climatiques et l’utilisation optimale des ressources en eau disponibles.
- Finalisation de Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu et diffusion et archivage publics des données et des produits de l’étude.
- Lancement de la phase 2 de l’examen accéléré du Plan 2014 pour explorer les améliorations possibles au plan de réglementation existant aux fins de gestion des débits sortants du lac Ontario. S’appuyant sur la phase 1, la phase 2 de l’examen accéléré comprend une collecte de données approfondie, une modélisation sophistiquée et des analyses d’experts dans divers secteurs et régions et la mobilisation du public et l’établissement de relations avec les collectivités autochtones afin d’évaluer efficacement les modifications possibles au plan de réglementation (échéance : printemps 2025).
ECCC a également continué de participer à quatre conseils nationaux de gestion des eaux, dont les réalisations en 2022-2023 comprenaient ce qui suit :
- la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a continué d’appuyer la gestion collaborative des débits d’eau des principaux réservoirs pendant la troisième inondation importante en sept ans le long de la rivière des Outaouais;
- la Commission de contrôle du lac des Bois a continué de réglementer les niveaux et les débits d’eau conformément aux exigences du traité et de la loi. Au printemps et à l’été 2022, la région a connu des inondations historiques, notamment au lac des Bois, au lac Seul et aux rivières Winnipeg et English. Au cours de cette période, la Commission a agi sur une base urgente en appuyant les efforts d’intervention liés aux inondations à l’échelle locale, provinciale, fédérale ou de l’état, en fournissant des données, des prévisions et une expertise sur l’eau;
- la Régie des eaux des provinces des Prairies (REPP) a mis à jour les objectifs de qualité de l’eau pour 2021, qui sont fondés sur les lignes directrices les plus protectrices en matière d’utilisation de l’eau. Malgré les préoccupations liées aux faibles débits à l’été 2021, causés par une sécheresse quasi record dans de nombreuses régions du sud des Prairies, les engagements en matière de distribution ont été respectés dans toutes les rivières interprovinciales surveillées par la REPP;
- le Conseil du bassin du Mackenzie a présenté le Rapport de l’état de l’écosystème aquatique du bassin du fleuve Mackenzie de 2021. Le rapport de 2021 est un document en ligne qui associe les données scientifiques accessibles au public et les connaissances traditionnelles et autochtones pour quatre indicateurs aquatiques.
En 2022-2023, ECCC a continué d’appuyer la priorité du gouvernement du Canada visant à améliorer la résilience des collectivités les plus à risque d’inondations, en mettant l’accent sur la contribution à l’initiative du profil de risque national. ECCC a maintenu sa collaboration avec RNCan et Sécurité publique Canada (SPC) pour moderniser les pratiques exemplaires de cartographie uniforme des plaines inondables au Canada. ECCC a également continué de collaborer avec les provinces et les territoires au moyen des structures de gouvernance existantes afin d’éclairer les méthodes et les approches d’ingénierie de la cartographie des inondations utilisées pour évaluer les cartes des inondations et d’aider RNCan à faire progresser une norme nationale de cartographie des inondations. Ce programme appuie la diffusion de l’information sur les risques d’inondation au public et informe les décideurs à tous les niveaux et dans de nombreux secteurs, notamment la planification municipale et le développement urbain.
ECCC a également poursuivi l’élaboration d’un système national de prévision capable de générer des prévisions et des alertes en cas d’inondations côtières dans le but de mieux répondre à l’augmentation de la fréquence et de la gravité des ondes de tempête, et de favoriser des collectivités côtières résilientes et une navigation maritime plus sécuritaire près des côtes.
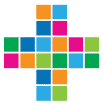
Analyse comparative entre les sexes plus
ECCC a continué de fournir des prévisions météorologiques, des avertissements et des conseils d’experts pour répondre aux besoins des Canadiens, notamment ceux qui sont le plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes et les événements environnementaux (comme les inondations). Au Canada, les populations touchées de façon disproportionnée ou différente peuvent comprendre les habitants des régions nordiques et rurales, les personnes âgées, les enfants, les personnes ayant des problèmes de santé ou des incapacités, les collectivités à faible revenu et les personnes sans abri. Afin d’améliorer la portée et l’accessibilité de son information, ECCC a adopté plusieurs stratégies pour mieux communiquer les risques à une grande variété de Canadiens et les préparer aux répercussions potentielles des conditions météorologiques dangereuses. ECCC a fourni des renseignements météorologiques et environnementaux au moyen d’une vaste gamme de plateformes de diffusion (dont l’application MétéoCAN, Radiométéo et les webinaires) et directement aux principaux décideurs, comme les organismes provinciaux de gestion des urgences et de santé publique. Le Ministère continue d’améliorer l’accessibilité et la documentation de ses données et services météorologiques et environnementaux en fonction des résultats des consultations auprès des parties prenantes.
Programme à l’horizon 2030 des Nations UniesNote de bas de page 43 et Objectifs de développement durable

Les observations, les prévisions et les avertissements météorologiques et environnementaux d’ECCC, notamment ses programmes de surveillance de l’eau, sont essentiels pour que les gouvernements, l’industrie et les citoyens de tout le pays puissent prendre des décisions quotidiennes visant à protéger les biens et à sauver des vies ou liées aux activités économiques qui dépendent des conditions météorologiques. Le travail d’ECCC visant à améliorer les services aux autorités publiques et à la collectivité de la gestion des urgences appuie les efforts déployés pour accroître la résilience des personnes pauvres et vulnérables et réduire leur exposition aux événements et aux urgences climatiques extrêmes (Objectif 1). Le travail d’ECCC dans le cadre du Programme sur la qualité de l’air et de la Cote air santé ainsi que ses avertissements de phénomènes météorologiques extrêmes contribuent à la santé et à la sécurité publiques (Objectif 3). De façon plus générale, les connaissances accumulées sur les régimes et les tendances météorologiques et climatiques appuient l’élaboration de stratégies efficaces à long terme pour la gestion de la qualité de l’eau et de l’air, et les mesures de lutte contre les changements climatiques (Objectif 13). La présence d’ECCC sur la scène internationale, comme sa participation à l’Organisation météorologique mondiale, aide à influencer et à faire progresser les priorités mondiales, notamment la fourniture de financement et d’expertise à l’appui de l’engagement du secrétaire général des Nations Unies de veiller à ce que tous les citoyens de la Terre soient protégés par des systèmes d’alerte précoce contre les conditions météorologiques extrêmes et les changements climatiques.
Le plan fédéral de mise en œuvre du Programme 2030 engage le gouvernement à aborder les objectifs de développement durable d’une manière guidée par les principes des droits de la personne. Il favorise la réconciliation avec les peuples autochtones en respectant et en protégeant pleinement leurs droits. En 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi sur la Déclaration des Nations Unies) a reçu la sanction royale, obligeant tous les ministères à harmoniser leur travail avec les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies. La mise en œuvre de la Loi par ECCC donnera l’occasion d’établir des liens entre les observations météorologiques, hydriques et environnementales, les prévisions et les connaissances accumulées, ainsi que la protection et le respect des droits des peuples autochtones.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prises dans le cadre de cette responsabilité essentielle qui contribuent aux ODD des Nations Unies, veuillez consulter la Stratégie ministérielle de développement durable de 2020 à 2023 d’ECCC.
Innovation et expérimentation
Renouvellement II – Aérologie
ECCC continue d’identifier de nouvelles façons d’améliorer les avertissements et les prévisions météorologiques pour les Canadiens au moyen de nouvelles technologies qui peuvent être intégrées aux réseaux de surveillance afin de tirer parti des données existantes et de combler les lacunes. Des résultats positifs ont été confirmés par l’expérimentation et la recherche sur l’utilisation des données du Programme de retransmission de données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) et des instruments qui utilisent la lumière laser pour l’étude des propriétés de l’atmosphère (lidar Doppler) dans les prévisions météorologiques.
La retransmission de données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) est maintenant opérationnelle dans les modèles numériques de prévisions météorologiques et environnementales du SMC, et l’expansion de ce projet est envisagée en raison des résultats positifs. Les évaluations préliminaires de l’utilisation des données du lidar Doppler dans les prévisions météorologiques ont donné des résultats encourageants, car des études de cas ont montré que les données recueillies à partir de cette technologie de pointe peuvent améliorer les prévisions à court terme (aussi appelées prévisions immédiates) et ont été utiles pour combler les lacunes géographiques dans les observations aérologiques. Le Ministère prévoit déployer deux lidars supplémentaires du SMC en 2023-2024.
Principaux risques
La prestation en temps opportun de renseignements et de services météorologiques et climatiques aux Canadiens dépend de l’entretien et de l’investissement continus dans les immobilisations et l’infrastructure technologique afin de prévenir la détérioration, d’assurer la fonctionnalité et de résister aux effets des changements climatiques. Cette situation pourrait être exacerbée par des événements plus fréquents et graves liés aux changements climatiques, comme des inondations, des sécheresses et des feux de forêt catastrophiques. Pour s’attaquer à ces risques, ECCC a continué d’améliorer sa planification des immobilisations et de la technologie, en partie en repérant de façon proactive les déficits d’infrastructure et en déterminant les priorités et les besoins de financement dans ces domaines. Par exemple, ECCC a continué de remplacer la technologie désuète par de nouveaux radars dans de nombreuses collectivités partout au Canada, et de moderniser et de renforcer le génie hydrologique, la capacité technique et l’infrastructure.
La capacité continue du Ministère d’accéder, de recueillir, de partager et d’analyser efficacement des données de plus en plus volumineuses et complexes est également étroitement liée à sa capacité de soutenir les opérations de base et de fournir en temps opportun des services et des renseignements météorologiques, environnementaux et d’analyse de calibre mondial aux Canadiens. Pour s’attaquer aux incertitudes et aux risques dans ce domaine, ECCC a continué de tirer parti de son expertise scientifique et de sa capacité informatique de pointe, notamment par l’amélioration continue des modèles de prévisions météorologiques et environnementales et des innovations techniques. Ensemble, ces progrès ont permis au Ministère de soutenir des collectivités résilientes et plus sûres, en donnant aux Canadiens plus de temps pour se protéger et protéger leurs biens.
Le Ministère a également continué d’explorer et de mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer la gouvernance et la transparence des données, à favoriser la connaissance des individus et la culture, et à soutenir une structure de données habilitante. Il a continué d’investir dans les systèmes de gestion de l’information, l’infrastructure, les outils et le personnel pour appuyer la gestion appropriée de l’information et l’exploration, l’interopérabilité et le partage de données sans faille. Entre autres choses, ce travail a permis de continuer à fournir des conseils d’experts et des recommandations aux offices des eaux intergouvernementaux et internationaux et a appuyé la prestation de services aux organismes partenaires qui participent à la gestion des eaux nationales et transfrontalières dans tout le pays le temps de se protéger et de protéger leurs biens.
Résultats obtenus
| Indicateurs de rendement | Objectifs | Date pour atteindre l’objectif | Résultats réels de 2020-2021 | Résultats réels de 2021-2022 | Résultats réels de 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice de rapidité et de précision des avertissements de temps violent, sur une échelle de 0 à 10. | Au moins 8,4 sur une échelle de 1 à 10. | Juin 2023 | 8,8 (moyenne mobile sur trois ans de 2018 à 2020) |
8,8 (moyenne mobile sur trois ans de 2019 à 2021) |
8,7 (moyenne mobile sur trois ans de 2020 à 2022)Note de bas de page 44 . |
| Pourcentage de partenaires du programme qui ont évalué leur satisfaction à l’égard des services hydrologiques d’ECCC à 8 sur 10 ou plusNote de bas de page 45 . | 80 % | 31 mai 2023 | Les premiers résultats seront présentés en 2022-2023. | 69 %Note de bas de page 46 | |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources financières budgétaires (en dollars)
Le tableau suivant montre, pour Prévisions des conditions météorologiques et environnementales, les dépenses budgétaires de 2022-2023, ainsi que les dépenses réelles pour cet exercice.
| 2022–2023 Budget principal |
2022–2023 Dépenses prévues |
2022–2023 Dépenses totales [autorisations utilisées] |
2022–2023 Dépenses réelles [autorisations utilisées] |
2022–2023 Écart [dépenses réelles moins dépenses prévues]* |
|---|---|---|---|---|
| 281 875 508 | 281 875 508 | 293 717 828 | 257 185 465 | -24 690 043 |
* Les dépenses réelles pour 2022-2023 sont inférieures aux dépenses prévues pour 2022-2023, principalement en raison de l’excédent dans le cadre des initiatives Revitalisation des services météorologiques du Canada et Force des collectivités de l’Arctique et du Nord.
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Ressources humaines (ETP)
Le tableau suivant montre, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère avait besoin pour s’acquitter de cette responsabilité de base en 2022-2023.
| ETP prévus en 2022–2023 | ETP réels en 2022–2023 | Écart en 2022-2023 [ETP réels moins ETP prévus] |
|---|---|---|
| 1 711 | 1 722 | 11 |
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC
Services internes
Description
Les Services internes comprennent ces groupes d’activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme étant des services à l’appui de programmes ou nécessaires pour permettre à une organisation de s’acquitter de ses obligations. Les Services internes désignent les activités et les ressources des 10 services distincts qui soutiennent l’exécution des programmes au sein de l’organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes d’un ministère. Ces services sont les suivants :
- services de gestion et de surveillance;
- services des communications;
- services juridiques;
- services de gestion des ressources humaines;
- services de gestion des finances;
- services de gestion de l’information;
- services de technologie de l’information;
- services de gestion des biens immobiliers;
- services de gestion du matériel;
- services de gestion des acquisitions.
Résultats
Ressources humaines
En 2022-2023, le Ministère est demeuré déterminé à fournir un environnement soutenant, respectueux et exempt de stigmatisation qui favorise le bien-être des employés. La culture de bienveillance d’ECCC repose sur le principe que tous les niveaux de l’organisation travailleront ensemble à bâtir une culture du travail caractérisée par l’humilité, la compassion, le courage et la collaboration, à l’appui de la santé psychologique, de la sécurité et du bien-être de tout le personnel. Nous misons sur la collaboration, l’inclusion et des conversations respectueuses, orientées par une idée claire de nos responsabilités collectives et individuelles pour y parvenir. Les cadres, les gestionnaires et les employés jouent tous un rôle important en prenant des mesures directes et concrètes pour provoquer un changement de culture et améliorer le milieu de travail.
En 2022-2023, ECCC a élaboré et promu ses ressources en matière de valeurs et d’éthique en milieu de travail, des outils de santé mentale et de mieux-être ainsi que des outils en matière d’accessibilité et un mécanisme de rétroaction. Tous ces éléments appuient la mise en œuvre de la Stratégie sur l’accessibilité du Ministère et le respect de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
ECCC a une réputation bien établie en ce qui a trait au soutien de la haute direction par la présentation de la culture de bienveillance aux nouveaux dirigeants. ECCC est reconnu pour son leadership dans la promotion d’un changement de mentalités et de comportements au sein du Ministère afin d’assurer le bien-être en milieu de travail conformément aux priorités du gouvernement en matière de santé mentale. Par exemple, son Guide de gestion de crise en santé mentale et les Cinq règles d’or pour les gestionnaires ont été adoptés comme pratiques exemplaires dans la fonction publique fédérale.
En 2022-2023, ECCC a poursuivi la mise en œuvre de sa Stratégie sur la diversité, l’inclusion et l’équité en matière d’emploi de 2021–2024. La Stratégie, qui a été lancée en juin 2021, a été inspirée par la rétroaction des réseaux d’ECCC ainsi que par l’appel à l’action en faveur de la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale du greffier du Conseil privé. La stratégie du Ministère comprend un plan d’action en vingt points qui énonce des mesures précises, audacieuses et mesurables pour constituer une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. Elle vise à combler les lacunes quant à l’équité en matière d’emploi selon quatre grands piliers : le recrutement; le perfectionnement et la rétention du personnel; l’éducation et la sensibilisation, et le soutien aux principaux éléments de la gouvernance, y compris les réseaux dirigés par les employés et la direction.
Les efforts du Ministère en matière de diversité, d’inclusion et d’équité en matière d’emploi ont abouti aux réalisations notables suivantes en 2022-2023 : la réduction des écarts au sein du Ministère quant à la représentation ministérielle, la refonte des lignes directrices sur la gestion des bassins de candidatures pour faciliter et accélérer les références et la modernisation des procédures de rapports internes pour lancer un tableau de bord ministériel sur l’équité en matière d’emploi qui fournit plus de données sur l’équité en matière d’emploi afin de suivre les progrès et de surveiller et de rajuster les stratégies.
ECCC a également continué de jouer son rôle comme ministère à vocation scientifique central et a fait progresser une approche ambitieuse à l’égard des communications scientifiques et des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Pour faciliter cette démarche, ECCC continuera de renforcer la reconnaissance et le soutien par la dynamisation du Comité des femmes en science et en technologie. De plus, ECCC a continué d’encourager et d’appuyer la création et les activités d’un large éventail de réseaux et de comités d’employés qui se consacrent à accroître la sensibilisation à la diversité, à favoriser l’inclusion de divers points de vue et à saisir les idées de jeunes du pays.
ECCC a continué de renforcer sa capacité à fournir des conseils stratégiques solides sur le plan juridique et adaptés à la culture à ses fonctionnaires qui consultent et mobilisent des partenaires des Premières Nations, Inuits et Métis. Pour faciliter cette démarche, le Ministère a examiné, enrichi et mis à jour les outils et les possibilités d’apprentissage afin d’améliorer la façon dont il fournit du financement aux partenaires autochtones. Il a également continué d’offrir de la formation sur la sensibilisation aux cultures autochtones et la consultation des Autochtones. ECCC a appuyé l’établissement de mesures pour le Plan d’action sur la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, afin de promouvoir l’inclusion significative des peuples autochtones dans les travaux du Ministère. Pour faciliter l’inclusion des points de vue autochtones, ECCC a continué de tirer parti du Guide pratique de consultation et de mobilisation des Autochtones afin de fournir des conseils aux fonctionnaires qui participent aux consultations et de mobiliser les Peuples autochtones.
En 2022-2023, le Ministère a continué de contribuer aux efforts de stabilisation des RH à la paye à l’échelle du gouvernement. Cette initiative visait à fournir des rapports et des mises à jour périodiques à la haute direction dans des domaines comme la rapidité des statistiques et l’approbation des transactions en attente dans Phénix. ECCC a aussi continué d’investir d’importants fonds et ressources pour la prestation des services de paye (services transactionnels et à la clientèle) afin de mieux soutenir les employés, de régler l’arriéré de problèmes de rémunération et de compléter la capacité du Centre de paye de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dans le cadre d’initiatives et de projets spéciaux.
ECCC est un ministère axé sur la science qui s’appuie sur un personnel hautement qualifié et spécialisé. Étant donné le marché du travail très concurrentiel, l’évolution des besoins opérationnels d’ECCC nécessite de nouvelles aptitudes et compétences pour traiter des questions complexes de politiques, de programmes, de science et de réglementation. Pour garantir qu’ECCC a la capacité de répondre rapidement et efficacement aux nouvelles priorités en matière de ressources humaines, le Ministère a continué d’assurer la prestation des services de ressources humaines avec souplesse. Il s’agissait notamment de réorienter les ressources humaines vers les dossiers prioritaires et de soutenir les gestionnaires dans la gestion des ressources humaines et la planification de la relève afin d’attirer et de retenir efficacement et sans délai un personnel hautement qualifié et expérimenté.
Écologisation du gouvernement
ECCC poursuit avec détermination sa transition vers des activités carboneutres et résilientes face aux changements climatiques, tout en réduisant les autres effets de ses activités sur l’environnement. Il s’agit entre autres de mesures précises axées sur la gestion des déchets, les plastiques et l’utilisation de l’eau dans les activités ministérielles.
En 2022-2023, le Ministère a poursuivi la mise en œuvre de mesures et l’évaluation de son rendement pour appuyer l’objectif pangouvernemental de réduire de 40 % les émissions de GES liées à l’énergie provenant des activités du gouvernement du Canada par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2025. ECCC a également persisté dans ses efforts visant à détourner des sites d’enfouissement au moins 75 % des déchets opérationnels et plastiques non dangereux et 90 % des déchets de construction et de démolition d’ici 2030. Cette démarche appuie la Stratégie pour un gouvernement vert de 2020 du gouvernement du Canada et la Stratégie pancanadienne sur l’élimination des déchets de plastique.
ECCC a aussi continué d’élaborer et de donner une formation aux employés sur les pratiques d’approvisionnement respectueuses de l’environnement, et d’élaborer un plan d’action ministériel sur la gestion des déchets, dont les objectifs sont fixés dans le temps en vue de réduire la production de déchets et d’accroître le détournement des déchets opérationnels non dangereux.
Communications
En 2022-2023, ECCC a continué de fournir à la population canadienne, aux ministères fédéraux, aux gouvernements provinciaux et territoriaux et aux intervenants des renseignements et des communications sur l’environnement transparents, exacts et opportuns. Pour ce faire, le Ministère a utilisé divers moyens et stratégies de communication classiques, numériques et novateurs pour communiquer la façon dont le gouvernement du Canada prend des mesures pour favoriser la croissance propre, conserver la nature, prévenir et gérer la pollution et fournir des renseignements opportuns sur les répercussions des changements climatiques, y compris les phénomènes météorologiques violents. Voici les faits saillants :
- former des scientifiques afin qu’ils communiquent de l’information scientifique en langage clair aux enfants d’âge scolaire;
- informer la population canadienne des événements météorologiques violents en collaboration avec les organismes de gestion des urgences afin d’aider les gens à se préparer rapidement, entre autres par des renseignements sur les ouragans, dont Fiona;
- fournir de l’information à la population sur des solutions climatiques fondées sur la nature et les répercussions des changements climatiques par les médias sociaux et des campagnes publicitaires;
- faire connaître les réussites de la COP15 aux Canadiens et aux Canadiennes grâce à un programme de communications novateur, continu et intensif, par de nombreuses activités sur les médias sociaux, des rapports en direct, une trousse de faits saillants quotidiens pour les médias, une série de vlogues, des séances d’information et des conférences de presse quotidiennes, sans compter plus de 25 annonces importantes;
- assurer une vaste présence soutenue sur les médias sociaux pour informer la population canadienne du programme fédéral d’élimination des déchets de plastique et favoriser l’échange de renseignements et la sensibilisation. Les communiqués de presse et les campagnes ont contribué à sensibiliser les gens aux mesures stratégiques fédérales, à cerner les occasions de consultation et de mobilisation, à promouvoir les processus de réduction et de rétention de la valeur, comme la réutilisation et la réparation, en plus de reconnaître les efforts collectifs visant à réduire les déchets de plastique et la pollution.
Technologie de l’information et gestion de l’information
La pandémie de COVID-19 continue d’influencer la façon dont le Ministère mène ses activités. Au début de la pandémie, ECCC a mis en œuvre des stratégies visant à renforcer sa transformation numérique afin de soutenir le travail virtuel, y compris l’utilisation intensive de Microsoft 365 et d’outils de collaboration infonuagiques. En 2022-2023, les politiques sur le milieu de travail d’ECCC qui ont été touchées par la COVID-19 n’ont cessé de s’harmoniser avec les lignes directrices de santé publique. Le Ministère continue de colliger les expériences et les leçons tirées pour éclairer les activités à venir.
Toujours soucieux de faciliter le retour au modèle de travail hybride, en collaboration avec Services partagés Canada (SPC), ECCC a amélioré ses liens Internet et réseau ainsi que ses capacités de réseau privé virtuel. De plus, diverses solutions de conférence audio et de vidéoconférence ont été déployées pour favoriser et permettre des réunions virtuelles à l’échelle nationale et internationale, ce qui fait avancer par le fait même les objectifs du gouvernement en matière d’écologisation.
En 2022-2023, le Ministère a maintenu son engagement à appuyer les initiatives numériques qui permettent aux scientifiques d’ECCC d’éclairer et de concrétiser les divers programmes et priorités complexes d’ECCC. Cette démarche misait sur les priorités suivantes :
- mettre en œuvre une stratégie en matière de données;
- moderniser les services numériques destinés à la population canadienne et aux entreprises;
- veiller à ce que des observations opportunes soient disponibles pour éclairer la prise de décisions et les objectifs scientifiques.
Vu la publication récente de la Stratégie relative aux données de 2023-2026 pour la fonction publique fédérale, ECCC a continué de mettre en œuvre sa propre stratégie en matière de données et d’analyse. La stratégie s’appuie sur les investissements existants en services numériques pour améliorer l’accès aux données et à l’information faisant autorité, tant au pays qu’à l’étranger.
En collaboration avec Services partagés Canada et Services publics et Approvisionnement Canada, le bureau météorologique d’ECCC à Winnipeg a déménagé dans une nouvelle installation dotée d’un espace de travail moderne qui s’inscrit dans l’initiative de fermeture des centres de données de SPC en consolidant les charges de travail des TI et en ouvrant la voie au centre de données gouvernementales de Montréal prévu en décembre 2023.
La gestion efficace des données est un pilier essentiel des ministères à vocation scientifique comme ECCC. En 2022-2023, ECCC a réalisé la première phase de l’initiative des carrefours de données en nuage, ce qui lui permettra de mieux gérer ses fonds de données, de les exploiter pour éclairer la prise de décisions et de permettre une diffusion accrue des données ouvertes auprès de la population.
Comme chef de file du gouvernement ouvert, ECCC a mis en œuvre de nouveaux processus d’automatisation de la publication des données et des améliorations apportées au dépôt de données ouvertes en 2022-2023 et au catalogue de données d’ECCC, qui étend encore plus l’accès du public aux données importantes, par la diffusion de près de 1000 ensembles de données. ECCC est un acteur majeur de la Plateforme de science et de données ouvertes de RNCan, qui donne accès à la science, à des données, à des publications et à de l’information sur les activités de développement à l’échelle du pays, lesquelles peuvent être utilisées pour comprendre les effets cumulatifs des activités humaines afin d’éclairer la prise de meilleures décisions à l’avenir.
Contrats accordés à des entreprises autochtones
Environnement et changement climatique Canada est une organisation de la phase 3; il doit donc s’assurer que des entreprises autochtones détiennent au moins 5 % de la valeur totale des contrats attribués par le Ministère avant la date limite fixée à la fin de l’exercice 2024-2025.
En vue de la date limite de 2024-2025, ECCC présentera ses résultats pour l’exercice 2022-2023 en septembre 2023. Le rapport de l’exercice 2022-2023 servira de test de la qualité des rapports et des données d’ECCC et donnera au Ministère le temps de mettre en œuvre des mesures correctives pour fournir de meilleures données afin d’atteindre l’objectif minimal de 5 %.
ECCC vise à atteindre l’objectif de 5 % en concentrant ses efforts sur certains types de biens ou de services, en particulier l’achat d’équipement informatique, les vols nolisés et les contrats accordés dans une région géographique assujettie à un accord sur des revendications territoriales. Une stratégie de communication en matière d’approvisionnement a également été lancée pour cibler les employés et la communauté des achats d’ECCC; elle comprend des séances d’information, des rapports périodiques et des messages ciblés.
Afin d’accroître la capacité ministérielle et de promouvoir la mobilisation des entreprises autochtones, le Ministère a fait des considérations autochtones en matière d’approvisionnement une exigence obligatoire du plan de formation des agents d’approvisionnement, et 33 des 47 employés ciblés (70 %) ont terminé cette formation en 2022-2023. De plus, un comité d’examen de l’approvisionnement de la haute direction a été créé en octobre 2022 pour examiner les nouveaux achats évalués à plus de 40 000 $, y compris les achats auprès de fournisseurs autochtones qui sont susceptibles d’être annulés ou qui sont assujettis à des accords de revendications territoriales. Cette assurance de la qualité se poursuit après l’octroi des contrats pour garantir que les marchés conclus avec des fournisseurs autochtones sont correctement codés et identifiés dans les systèmes de gestion financière du Ministère.
Gestion financière
En 2022-2023, ECCC a poursuivi ses efforts visant à améliorer l’efficacité de sa gestion financière afin de mieux exécuter ses programmes et priorités au nom des Canadiens. Pour répondre au besoin croissant du Ministère de s’attaquer aux questions liées à l’environnement et aux changements climatiques, ECCC a procédé à un examen de sa gestion et de l’affectation de ses ressources financières. Les modifications qui en ont découlé ont permis d’accroître la souplesse et l’efficacité de la gouvernance des ressources financières internes du Ministère.
Ressources financières budgétaires (en dollars)
Le tableau suivant montre, pour les services internes, les dépenses budgétaires de 2022-2023, ainsi que les dépenses de l’exercice.
| Budget principal des dépenses 2022–2023 |
Dépenses prévues 2022–2023 |
Autorisations totales pouvant être utilisées 2022–2023 |
Dépenses réelles [autorisations utilisées] 2022–2023 |
Écart [dépenses réelles moins dépenses prévues*] 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|
| 219 667 177 | 219 667 177 | 298 793 250 | 298 661 385 | 78 994 208 |
* Les dépenses réelles en 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses prévues en 2022-2023, principalement en raison des augmentations économiques liées à la rémunération. Cet écart s’explique aussi par l’augmentation des dépenses liées à la technologie de l’information, au Centre environnemental du Pacifique (CEP) et à la publicité visant une économie saine et un environnement sain.
Ressources humaines (ETP)
Le tableau suivant présente, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère a besoin pour fournir ses services internes en 2022-2023.
| ETP prévus en 2022–2023 | ETP réels en 2022–2023 | Écart en 2022-2023 [ETP réels moins ETP prévus] |
|---|---|---|
| 1 726 | 1 797 | 71 |
Dépenses et ressources humaines
Dépenses
Dépenses de 2020-2021 à 2025-2026
Le graphique ci-dessous présente les dépenses du Ministère sur une période de six ans. Les dépenses indiquées pour les exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, sont les dépenses réelles telles qu’elles figurent dans les Comptes publics. Pour les exercices 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, les dépenses prévues représentent les dépenses budgétaires et législatives prévues, comme elles figurent dans le Plan ministériel 2023-2024.

Figure 1 – Tableau de données
| - | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes législatifs | 209 179 793 | 101 529 765 | 123 538 129 | 112 002 268 | 109 218 480 | 107 265 448 |
| Crédits votés | 1 537 606 795 | 1 611 358 900 | 1 806 143 889 | 2 334 075 406 | 2 237 591 743 | 2 105 001 087 |
| Total | 1 746 786 588 | 1 712 888 665 | 1 929 682 018 | 2 446 077 674 | 2 346 810 223 | 2 212 266 535 |
Les dépenses réelles d’ECCC étaient de 1929,7 millions de dollars en 2022-2023, ce qui représente une augmentation de 216,8 millions de dollars (13 %) par rapport aux dépenses réelles de 2021-2022. Cette augmentation est principalement attribuable au financement visant à conserver les terres et les ressources en eau douce du Canada, protéger les espèces, faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones et améliorer l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié), à l’augmentation des paiements liés aux dépenses salariales permanentes et aux paiements rétroactifs versés en 2022-2023 à la suite de l’augmentation économique accordée aux cadres et aux hauts dirigeants, et aux fonds consacrés à la promotion du plan Un environnement sain et une économie saine, à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, au Programme du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques et aux solutions climatiques naturelles au Canada. Cette augmentation est en partie contrebalancée par une diminution des dépenses associées au FEFC, à l’initiative Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (Patrimoine naturel) et à la Stratégie emploi et compétences jeunesse.
Consulter le Rapport sur les résultats ministériels 2021 à 2022 pour obtenir de plus amples détails sur la variation annuelle des dépenses réelles entre 2020-2021 et 2021-2022.
Pour la période de 2023-2024 à 2025-2026, les chiffres représentent les dépenses totales prévues à l’appui des principales responsabilités ministérielles au cours de l’exercice, ce qui correspond au financement approuvé par le Conseil du Trésor, au moment de la présentation du Plan ministériel 2023-2024. Dans l’ensemble, les dépenses prévues ont diminué au cours de l’horizon de planification de 2024-2025 à 2025-2026 présenté dans le tableau de sommaire. Cette baisse est attribuable à la clôture d’initiatives faisant l’objet d’un financement temporaire. Les demandes de financement pour ces initiatives sont tributaires des décisions du gouvernement, et elles seront prises en considération dans les futurs exercices budgétaires et budgets des dépenses.
Les principales initiatives dont le financement diminuera ou prendra fin en 2024-2025 comprennent :
- le Plan de gestion des produits chimiques (25,7 millions de dollars);
- des collectivités arctiques et nordiques dynamiques (18,9 millions de dollars);
- la revitalisation du réseau canadien de radars météorologiques (17,9 millions de dollars);
- le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (11,9 millions de dollars).
Les principales initiatives dont le financement diminuera ou prendra fin en 2025-2026 comprennent :
- le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (47,4 millions de dollars);
- le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (31 millions de dollars);
- le Fonds de la nature pour la protection des forêts anciennes de la Colombie-Britannique (26 millions de dollars);
- la Stratégie emploi et compétences jeunesse (15,4 millions de dollars).
Consulter le Plan ministériel 2023-2024 pour obtenir de plus amples détails sur la variation annuelle des dépenses prévues entre 2023-2024 et 2025-2026.
Ressources financières budgétaires (en dollars)
| Responsabilités essentielles et services internes | Budget principal des dépenses 2022-2023 |
Dépenses prévues 2022-2023 |
Autorisations totales pouvant être utilisées 2022-2023 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2022-2023 |
Écart (dépenses réelles moins dépenses prévues) 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 478 116 465 | 478 116 465 | 589 591 492 | 407 374 384 | -70 742 081 |
| Prévention et gestion de la pollution | 379 219 765 | 379 219 765 | 412 163 483 | 390 259 703 | 11 039 938 |
| Conservation de la nature | 609 338 156 | 609 338 156 | 643 983 141 | 576 201 081 | -33 137 075 |
| Prévision des conditions météorologiques et environnementales | 281 875 508 | 281 875 508 | 293 717 828 | 257 185 465 | -24 690 043 |
| Total partiel | 1 748 549 894 | 1 748 549 894 | 1 939 455 945 | 1 631 020 633 | -117 529 261 |
| Services internes | 219 667 177 | 219 667 177 | 298 793 250 | 298 661 385 | 78 994 208 |
| Total | 1 968 217 071 | 1 968 217 071 | 2 238 249 195 | 1 929 682 018 | -38 535 053 |
* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
La différence de 38,5 millions de dollars entre les dépenses prévues de 2022-2023, soit 1 968,2 millions de dollars, et les dépenses réelles de 2022-2023, soit 1 929,7 millions de dollars, est principalement attribuable aux écarts de financement ci-dessous.
- Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont inférieures aux dépenses prévues pour 2022-2023 et elles sont principalement liées au FEFC et à l’Observatoire de veille atmosphérique du globe du docteur Neil Trivett à Alert, au Nunavut. L’écart est compensé par les dépenses associées au Programme du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques, les augmentations économiques liées à la rémunération, les paiements aux Nations Unies, aux universités qui mènent des recherches subventionnées et aux organisations nationales à but non lucratif et les dépenses liées à la croissance propre et à l’atténuation des changements climatiques.
- Prévention et gestion de la pollution : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses prévues pour 2022-2023, principalement en raison d’une augmentation des dépenses liées aux initiatives portant sur l’écosystème des Grands Lacs, ce qui est contrebalancé par des dépenses moins élevées que prévu au titre du nouveau financement accordé au Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux et au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain.
- Conservation de la nature : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont inférieures à celles prévues pour 2022-2023 et elles sont principalement liées au financement de la conservation des terres et des ressources en eau douce du Canada, de la protection des espèces, de la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l’amélioration de l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié). Les dépenses liées à la Loi sur les espèces en péril, à l’initiative Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (Patrimoine naturel) et à la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles au Canada, ont également été inférieures aux prévisions. Ces baisses sont compensées par les dépenses associées à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, aux paiements versés aux organisations nationales à but non lucratif et aux Premières Nations et aux augmentations économiques liées à la rémunération.
- Prévision des conditions météorologiques et environnementales : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont inférieures aux dépenses prévues pour 2022-2023 et elles sont principalement liées à la revitalisation des services météorologiques du Canada et de l’adoption de mesures visant à contrôler la propagation de la COVID-19, y compris l’imposition de restrictions relatives aux déplacements qui ont entraîné des défis logistiques et limité l’avancement des travaux. L’écart est également attribuable au manque de matériaux de construction pour l’initiative Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques.
- Services internes : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses prévues pour 2022-2023, principalement en raison des augmentations économiques liées à la rémunération. Cette hausse est également attribuable à l’augmentation des dépenses liées à la technologie de l’information et à la promotion du plan Un environnement sain et une économie saine.
Ressources humaines (équivalents temps plein)
Le tableau ci-dessous indique, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le Ministère a eu besoin pour livrer les résultats ministériels pour 2022-2023.
| Nombre d’équivalents temps plein prévus 2022-2023 |
Nombre d’équivalents temps plein réels 2022-2023 |
Écart (nombre d’ETP réels moins nombre d’ETP prévus) 2022-2023 |
|---|---|---|
| 8 031 | 8 144 | 113 |
Sommaire du rendement budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau « Sommaire du rendement budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes » présente les ressources financières budgétaires allouées aux services internes et aux responsabilités essentielles d’ECCC.
| Responsabilités essentielles et services internes | Budget principal des dépenses 2022-2023 | Dépenses prévues 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
Dépenses prévues 2024-2025 |
Autorisations totales pouvant être utilisées 2022-2023 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2020-2021 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2021-2022 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 478 116 465 | 478 116 465 | 876 753 252 | 858 285 411 | 589 591 492 | 495 862 449 | 381 382 505 | 407 374 384 |
| Prévention et gestion de la pollution | 379 219 765 | 379 219 765 | 420 436 048 | 366 609 523 | 412 163 483 | 360 265 374 | 380 061 047 | 390 259 703 |
| Conservation de la nature | 609 338 156 | 609 338 156 | 677 409 744 | 705 019 220 | 643 983 141 | 366 851 749 | 413 663 898 | 576 201 081 |
| Prévision des conditions météorologiques et environnementales | 281 875 508 | 281 875 508 | 229 586 460 | 181 108 799 | 293 717 828 | 252 729 020 | 274 731 867 | 257 185 465 |
| Total partiel | 1 748 549 894 | 1 748 549 894 | 2 204 185 504 | 2 111 022 953 | 1 939 455 945 | 1 475 708 592 | 1 449 839 317 | 1 631 020 633 |
| Services internes | 219 667 177 | 219 667 177 | 241 892 170 | 235 787 270 | 298 793 250 | 271 077 996 | 263 049 348 | 298 661 385 |
| Total | 1 968 217 071 | 1 968 217 071 | 2 446 077 674 | 2 346 810 223 | 2 238 249 195 | 1 746 786 588 | 1 712 888 665 | 1 929 682 018 |
* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les dépenses prévues pour 2022-2023 dans le Rapport sur les résultats ministériels reflètent l’information publiée dans le Plan ministériel 2022-2023. Le Plan ministériel a été déposé au Parlement avant le budget de 2023 et, par conséquent, il ne reflète pas le nouveau financement annoncé dans le budget.
Les autorisations totales pouvant être utilisées en 2022-2023 comprennent tous les postes approuvés dans le cadre des processus budgétaires pour l’exercice 2022-2023. L’écart global de 270 millions de dollars entre les autorisations totales pouvant être utilisées en 2022-2023 (2238 millions de dollars) et les dépenses prévues pour 2022-2023 (1968 millions de dollars) est principalement attribuable à l’augmentation des reports des budgets de fonctionnement et d’immobilisations par rapport à l’année précédente ainsi qu’aux hausses des dépenses liées aux initiatives suivantes :
- Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFC);
- Système de tarification fondé sur le rendement;
- Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;
- promotion de l’économie circulaire du plastique au Canada;
- Programme du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques;
- Fonds de la nature pour la protection des forêts anciennes de la Colombie-Britannique;
- Initiatives portant sur l’écosystème des Grands Lacs;
- croissance propre et atténuation des changements climatiques;
- établissement du Bureau de transition de l’Agence de l'eau du Canada;
- mise en œuvre du programme de restitution des produits de la redevance sur les combustibles.
L’écart global de 308,5 millions de dollars entre les autorisations totales pouvant être utilisées en 2022-2023 (2 238,2 millions de dollars) et les dépenses réelles de 2022-2023 (1929,7 millions de dollars) est principalement attribuable au fait que les dépenses sont inférieures aux prévisions de dépenses pour les initiatives ci-dessous :
- Le FEFC dont les bénéficiaires ont dû faire face à des retards dans la mise en œuvre de projets en raison de divers facteurs qui échappaient en grande partie à leur contrôle et à celui d’ECCC.
- La conservation des terres et des ressources en eau douce du Canada, la protection des espèces, la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones et l’amélioration de l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié).
- Plusieurs autres initiatives, y compris des communautés arctiques et nordiques dynamiques, le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, l’initiative Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (Patrimoine naturel), la revitalisation des services météorologiques du Canada et le Plan de protection des océans. Les retards sont notamment attribuables aux retards des travaux de construction dans le Nord, aux catastrophes naturelles, aux problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement et aux nombreux retards dans les processus d’embauche.
La hausse globale des dépenses réelles de 216,8 millions de dollars entre 2021-2022 (1 712,9 millions de dollars) et 2022-2023 (1 929,7 millions de dollars) est principalement due aux écarts de financement ci-dessous.
- Prise de mesures visant la croissance propre et les changements climatiques : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses réelles de 2021-2022, principalement en raison des dépenses liées au Programme du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques, au nouveau système de tarification fondé sur le rendement, à la croissance propre et à l’atténuation des changements climatiques, aux paiements aux Nations Unies, aux universités qui mènent des recherches subventionnées et aux organisations nationales à but non lucratif, de même qu’aux augmentations économiques liées à la rémunération. Ces hausses des dépenses sont compensées par une diminution des dépenses liées au FEFC.
- Prévention et gestion de la pollution : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses réelles de 2021-2022, principalement en raison de l’augmentation des dépenses liées au Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux, au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, aux services de consultants en ingénierie et aux paiements à des associations inuites et des Premières Nations. Cela est compensé par la diminution des dépenses associées à la Stratégie emploi et compétences jeunesse qui vise à aider les étudiants et les jeunes.
- Conservation de la nature : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses réelles de 2021-2022, principalement en raison des dépenses liées aux initiatives comme la conservation des terres et des ressources en eau douce du Canada, la protection des espèces, la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones et l’amélioration de l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié), la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles au Canada, notamment pour atténuer les menaces imminentes posées aux troupeaux de bisons des bois, et le nouveau Fonds de la nature pour la protection des forêts anciennes de la Colombie-Britannique. Ces hausses sont compensées par une diminution des dépenses liées à l’initiative Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (Patrimoine naturel).
- Prévision des conditions météorologiques et environnementales : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses réelles de 2021-2022, principalement en raison de la hausse des dépenses liées à des initiatives comme Des collectivités arctiques et nordiques dynamiques, la revitalisation des services météorologiques du Canada, le Plan de protection des océans, auxquelles s’ajoutent d’autres dépenses comme la réparation et l’entretien et les fournitures météorologiques.
- Services internes : Les dépenses réelles de 2022-2023 sont plus élevées que les dépenses réelles de 2021-2022, principalement en raison de l’augmentation de diverses dépenses comme les services juridiques, l’administration des contrats avec SPAC, la location d’immeubles, le matériel informatique, les droits de licence, le matériel et les installations, le mobilier de bureau, ainsi que les augmentations économiques liées à la rémunération. Ces hausses sont compensées par une diminution des dépenses associées à la promotion de Patrimoine naturel.
Sommaire des dépenses budgétaires brutes réelles pour 2022-2023 (en dollars)
Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre les dépenses brutes prévues et les dépenses nettes pour 2022-2023.
| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses brutes réelles 2022-2023 |
Dépenses brutes réelles pour les comptes à fins déterminées 2022-2023 |
Recettes réelles affectées aux dépenses 2022-2023 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 407 374 384 | 0 | 0 | 407 374 384 |
| Prévention et gestion de la pollution | 404 919 118 | 0 | 14 659 415 | 390 259 703 |
| Conservation de la nature | 580 435 652 | 0 | 4 234 572 | 576 201 081 |
| Prévision des conditions météorologiques et environnementales | 305 833 720 | 0 | 48 648 256 | 257 185 465 |
| Total partiel | 1 698 562 875 | 0 | 67 542 243 | 1 631 020 633 |
| Services internes | 299 515 465 | 0 | 854 080 | 298 661 385 |
| Total | 1 998 078 340 | 0 | 68 396 323 | 1 929 682 018 |
* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les principales sources de recettes affectées aux dépenses d’ECCC sont les suivantes :
- les provinces qui reçoivent des services de surveillance de la quantité d’eau (services hydrométriques);
- NAV CANADA, à qui ECCC fournit des services météorologiques à l’aviation;
- les tiers auxquels ECCC loue des installations non liées à la recherche et pour lesquels le Ministère mène des projets scientifiques et analytiques;
- le ministère de la Défense nationale, qui reçoit des services météorologiques détaillés à l’appui de ses opérations militaires;
- l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui finance le Plan de mise en œuvre conjoint Canada-Alberta pour la surveillance visant les sables bitumineux;
- la Garde côtière canadienne, qui reçoit des prévisions et des services de surveillance maritime et des glaces;
- les tiers auxquels ECCC délivre des permis pour l’immersion en mer de substances non dangereuses.
Ressources humaines
Le tableau « Sommaire des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes (équivalents temps plein) » indique le nombre d’ETP affectés à chacune des responsabilités essentielles et aux services internes d’ECCC.
| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein réels 2020-2021 | Équivalents temps plein réels 2021-2022 | Équivalents temps plein prévus 2022-2023 | Équivalents temps plein réels 2022-2023 | Équivalents temps plein prévus 2023-2024 | Équivalents temps plein prévus 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 611 | 744 | 897 | 883 | 906 | 896 |
| Prévention et gestion de la pollution | 2 232 | 2 229 | 2 220 | 2 255 | 2 197 | 2 052 |
| Conservation de la nature | 1 197 | 1 302 | 1 477 | 1 487 | 1 243 | 1 233 |
| Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | 1 700 | 1 714 | 1 711 | 1 722 | 1 566 | 1 544 |
| Total partiel | 5 740 | 5 989 | 6 305 | 6 347 | 5 912 | 5 725 |
| Services internes | 1 604 | 1 698 | 1 726 | 1 797 | 1 787 | 1 767 |
| Total | 7 344 | 7 687 | 8 031 | 8 144 | 7 699 | 7 492 |
* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
L’écart entre les ETP réels et prévus pour 2022-2023 est attribuable à une augmentation du nombre d’ETP affectés aux nouvelles initiatives approuvées au cours de l’exercice, principalement la promotion d’une économie circulaire du plastique au Canada, le Plan de protection des océans et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15).
Les dépenses prévues présentées dans le Plan ministériel 2022-2023 ne comprennent pas les ETP prévus pour ces initiatives.
Dépenses par crédits votés
Pour obtenir des renseignements sur les dépenses votées et les dépenses législatives d’ECCC, consulter les Comptes publics du Canada 2022.
Dépenses et activités du gouvernement du Canada
Des renseignements sur l’harmonisation des dépenses d’ECCC avec les dépenses et les activités du gouvernement du Canada figurent dans l’InfoBase du GC.
États financiers et faits saillants des états financiers
États financiers
Les états financiers (non audités) d’ECCC pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 sont accessibles sur la page Transparence d’ECCC.
Faits saillants des états financiers
État des résultats condensé (non audité) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (en dollars)
| Renseignements financiers | Résultats prévus 2022-2023 | Résultats réels 2022-2023 | Résultats réels 2021-2022 (revus) | Écart (résultats réels de 2022-2023 moins résultats prévus de 2022-2023) | Écart (résultats réels de 2022-2023 moins résultats réels de 2021-2022) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des charges | 2 092 588 983 | 2 106 684 988 | 1 802 383 263 | 14 096 005 | 304 301 725 |
| Total des recettes | 101 446 259 | 206 533 022 | 89 206 854 | 105 086 763 | 117 326 168 |
| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 1 991 142 724 | 1 900 151 966 | 1 713 176 409 | -90 990 758 | 186 975 557 |
L’état des résultats prospectif d’ECCC pour 2022-2023 est accessible sur la page Transparence d’ECCC.
Dépenses par responsabilité essentielle
Le total des dépenses ministérielles liées aux responsabilités essentielles s’est élevé à 2106,7 millions de dollars en 2022-2023 (1802,4 millions de dollars en 2021-2022). La hausse de 304,3 millions de dollars, ou 16,9 %, des dépenses d’ECCC est principalement attribuable à :
- une augmentation des dépenses liées à des initiatives temporaires comme la conservation des terres et des ressources en eau douce du Canada, la protection des espèces, la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones et l’amélioration de l’accès à la nature, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le Programme du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques et la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles au Canada;
- une augmentation de la rémunération et la bonification des régimes d’avantages sociaux des employés.
Cette hausse a été contrebalancée par :
- une diminution des dépenses liées à des initiatives temporaires comme le FEFC, la Stratégie emploi et compétences jeunesse et l’initiative Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada.

Figure 2 - Longue description
Dépenses par responsabilité essentielle
- Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques 417,7 millions $ our 19,8 %
- Prévention et gestion de la pollution 469,6 millions $ ou 22,3 %
- Préservation de la nature 598,1 millions $ ou 23,4 %
- Prévisions des conditions météorologiques et environnementals 301,5 millions $ ou 14,3 %
- Services internes 319,8 millions $ ou 15,2 %
- Total : 2 106,7 million $
Voir la note 17 des États financiers du Ministère pour une ventilation plus détaillée des dépenses – information sectorielle par poste de dépenses et responsabilité essentielle.
Recettes par type
Les recettes totales se sont élevées à 206,5 millions de dollars en 2022-2023 (89,2 millions de dollars en 2021-2022). Ce total exclut des recettes de 311,9 millions de dollars touchées pour le compte du gouvernement. Les recettes d’ECCC sont tirées de la vente de biens et de produits d’information de nature non réglementaire. Les principaux postes de recettes comprennent : les activités de surveillance des sables bitumineux, les demandes de permis d’immersion en mer, les services hydrométriques, les frais de surveillance des activités d’immersion en mer, les services météorologiques et environnementaux, les montants des amendes, des ordonnances de la cour versés au Fonds pour dommages à l’environnement, etc.
L’augmentation des recettes d’ECCC est principalement attribuable à :
- la conclusion d’un règlement pour l’assainissement d’un site contaminé en Colombie-Britannique;
- les montants de nouvelles amendes versés au Fonds pour dommages à l’environnement.
État condensé de la situation financière (non audité) au 31 mars 2023 (en dollars)
| Renseignements financiers | 2022-2023 | 2021-2022 (revu) |
Écart (2022-2023 moins 2021-2022) |
|---|---|---|---|
| Total du passif net | 1 095 472 223 | 998 764 308 | 96 707 915 |
| Total des actifs financiers nets | 731 259 344 | 643 854 222 | 87 405 122 |
| Dette nette du Ministère | 364 212 879 | 354 910 086 | 9 302 793 |
| Total des actifs non financiers | 653 579 061 | 614 409 855 | 39 169 206 |
| Situation financière nette du Ministère | 289 366 182 | 259 499 769 | 29 866 413 |
Passifs par type
Le passif total était de 1095,5 millions de dollars à la fin de 2022-2023. Cela représente une augmentation de 96,7 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport au passif total de 998,8 millions de dollars enregistré lors de l’exercice précédent. Les créditeurs et charges à payer (733,3 millions de dollars) ainsi que le passif environnemental et les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (197,6 millions de dollars) sont les principaux éléments de passif en 2022-2023, et ils représentent 85 % du passif total.
La hausse de la valeur du passif net total d’ECCC est compensée par :
- une diminution des indemnités de vacances versées en raison de l’encaissement obligatoire des congés.

Figure 3 - Longue description
Passifs
- Créditeurs et charges à payer 733,2 millions $ ou 67,0 %
- Indemnités de vacances et congés compensatoires 57,4 millions $ ou 5,2 %
- Revenus reportés 46,6 millions $ ou 4,3 %
- Obligation au titre d’immobilisations corporelles louées 4,5 millions $ ou 0,4 %
- Avantages sociaux futurs 18,7 millions $ ou 1,7 %
- Passif environnemental et obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 197,6 millions ou 18,0 %
- Passifs éventuels 22,3 millions $ ou 2,0 %
- Autres éléments de passif 15,2 millions $ ou 1,4 %
- Total : 1 095,5 millions $
Voir les notes 4 à 8, 13 et 14 des États financiers ministériels pour plus de détails – créditeurs et charges à payer; passif environnemental; revenus reportés; obligation au titre d’immobilisations corporelles louées; avantages sociaux futurs des employés; obligations contractuelles et droits contractuels; passifs éventuels et actifs éventuels.
Actifs par type
Le total des actifs financiers nets (731,2 millions de dollars) et des actifs non financiers (653,6 millions de dollars) de 1 384,8 millions de dollars, ont augmenté de 126,6 millions de dollars, ou 10,1 %, en 2022-2023. Le montant à recevoir du Trésor, l’élément d’actif le plus important, s’élève à 715,4 millions de dollars (soit 51,7 % de l’actif total) en 2022-2023.
La hausse de la valeur de l’actif net total d’ECCC est principalement attribuable à une :
- augmentation des actifs financiers principalement due à une hausse des charges à payer;
- hausse des actifs non financiers principalement due à une augmentation des immobilisations corporelles.

Figure 4 - Longue description
Actifs
- Montant à recevoir du Trésor 715,4 millions $ ou 51,6 %
- Débiteurs et avances 15,9 millions $ ou 1,2 %
- Actifs non-financiers 653,5 millions $ ou 47,2 %
- Total : 1 384,8 millions $
Voir les notes 9 à 11 des États financiers ministériels pour plus de détails – débiteurs et avances; inventaire; immobilisations corporelles.
Renseignements ministériels
Profil organisationnel
Ministre de tutelle : L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Administrateur général : Christopher Forbes
Portefeuille ministériel : Environnement et Changement climatique Canada;
Instruments habilitants :
- Loi sur le ministère de l’Environnement
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Loi sur les pêches (administration et application des dispositions sur la prévention de la pollution)
- Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (responsabilité conjointe avec Finances Canada)
- Loi sur les espèces en péril
- Loi sur les additifs à base de manganèse
- Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
- Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane
- Loi sur les espèces sauvages au Canada
- Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
- Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
- Loi sur la semaine de la protection de la faune
- Loi sur les ressources en eau du Canada
- Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
- Loi de 1921 pour le contrôle du lac des Bois
- Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
- Loi sur les renseignements en matière de modification du temps
- Loi sur la semaine canadienne de l’environnement
- Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales
- Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
- Loi fédérale sur le développement durable
- Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure
- Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
- Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
- Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
- Loi sur les opérations pétrolières au Canada
- Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
- Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
- Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
- Loi de l’impôt sur le revenu
- Loi sur la responsabilité en matière maritime
- Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
- Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles
- Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Année d’incorporation ou de création : 1971
Raison d’être, mandat et rôle : qui nous sommes et ce que nous faisons
La section « Raison d’être, mandat et rôle : qui nous sommes et ce que nous faisons » est accessible sur le site Web d’ECCC.
Pour plus de renseignements sur les engagements organisationnels formulés dans la lettre de mandat du ministère, consultez la lettre de mandat du ministre.
Contexte opérationnel
Des renseignements sur le contexte opérationnel sont accessibles sur le site Web d’ECCC
Cadre de présentation de rapports
Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes officiels d’ECCC pour 2022-2023 sont illustrés ci-dessous.

Longue description
En vigueur le 1 avril 2022
Cadre ministériel des résultats conforme à la « Politique sur les résultats du Conseil du Trésor »
Priorités d’ECCC relatives aux responsabilités essentielle / mandat du Ministère
Les responsabilités et les fonctions principales relatives au mandat ministériel continu. Ces points sont énumérés sous chaque responsabilité essentielle et constituent les engagements précis du mandat ministériel tirés de la lettre de mandat de la ministre, du discours du Trône et du Budget de 2016.
Responsabilités essentielles
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
Par une collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les parties prenantes et des experts externes, le ministère soutiendra et coordonnera la mise en œuvre du cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques; s’employer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES); mener la croissance propre; élaborer des instruments réglementaires; soutenir les entreprises et les Canadiens pour s’adapter et devenir plus résilients aux changements climatiques; et contribuer aux mesures prises sur le plan international pour les changements climatiques pour augmenter les avantages globaux.
Prévention et gestion de la pollution
Collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres entités afin de développer et de gérer des normes, lignes directrices et règlements liés à l’environnement, et d’autres mesures de gestion du risque, en vue de réduire les rejets et de surveiller les niveaux de contaminants dans l’air, l’eau et le sol; promouvoir les lois et les règlements environnementaux et veiller à leur application.
Conservation de la nature
Protéger et rétablir des espèces en péril et leurs habitats, assurer la conservation et la protection de populations saines d’oiseaux migrateurs; mobiliser les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les parties prenantes et le public afin d’augmenter les aires protégées et contribuer aux activités de conservation et d’intendance; étendre et gérer les aires protégées du ministère; et collaborer avec des partenaires du Canada et à l’international pour faire progresser la conservation de la biodiversité et du développement durable.
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
Surveiller les conditions météorologiques, l’eau, la qualité de l’air et les conditions climatiques, fournir à la population canadienne et aux secteurs ciblés des prévisions, de l’information et des avertissements au moyen d’un vaste éventail de modes de prestation de services, de réaliser des recherches, de concevoir et tenir à jour des modèles informatiques pour la prévision météorologique et d’autres conditions environnementales et de recueillir des données et en permettre l’échange avec d’autres services météorologiques nationaux et des organisations internationales.
Résultats pour chaque responsabilité essentielle/priorités du mandat du Ministère
En définissant les résultats/extrants, les progrès en fonction des responsabilités essentielles seront surveillés et mis à jour par le biais de rapports publics et de la gestion ministérielle
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de courte durée
- Émissions de GES pour les véhicules légers
- Émissions de GES pour les véhicules lourds
- Émissions de carbone noir, comme déclarées dans l’inventaire canadien des émissions de carbone noir
- Émissions de hydrofluorocarbures (HFC)
- Réduction des émissions de méthane produites par le secteur du pétrole et du gaz
- Des réductions des émissions ont été réalisées grâce à la norme sur les combustibles propres basée sur le règlement sur le carburant renouvelable
- Pourcentage d’unités de production d’électricité alimentées au charbon qui satisfont leur niveau d’intensité d’émissions de GES
- Des systèmes de tarification de la pollution par le carbone sont en place au Canada
- Les émissions de GES résultant des activités d’ECCC sont réduites
- Peuples autochtones sont impliqués à la croissance propre et aux changements climatiques
- Codéveloppement d’indicateurs avec les peuples autochtones afin de s’assurer qu’ils participent à la mise en œuvre du cadre pancanadien par l’entremise de trois tables conjointes de haut niveau distinctes avec les Premières Nations, Inuits et Métis
- Le Canada contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la résilience mondiale aux changements climatiques
- Montant cumulé des financements privés mobilisés par les investissements du secteur public canadien
- Réduction des GES résultant de programmes internationaux financés par le Canada
- Le nombre de personnes dans les pays en voie de développement qui ont profité des fonds d’adaptation du Canada
- Les communautés, économies et écosystèmes canadiens sont mieux adaptés
- Nombre de particuliers, d’entreprises et de gouvernements qui utilisent les services climatiques et qui utilisent ces renseignements dans la prise de décision
Prévention et gestion de la pollution
- Les Canadiens ont un air pur
- Pourcentage des Canadiens qui vivent dans des aires où les normes de qualité de l’air sont atteintes
- Les Canadiens ont une eau propre
- Pourcentage des systèmes de traitement d’eaux usées où les normes de qualité des effluents sont atteintes
- L’environnement canadien est protégé des substances nocives
- Pourcentage de mesures prises en temps opportun afin de protéger l’environnement du Canada contre les substances chimiques jugées comme posant un risque pour l’environnement
Conservation de la nature
- La faune et les habitats du Canada sont préservés et protégés
- Pourcentage des espèces d’oiseaux migrateurs qui se trouvent dans l’éventail des populations ciblées
- Pourcentage des aires canadiennes conservées comme aires protégées et autres mesures de conservation efficaces axées sur les aires
- Les espèces en péril canadiennes sont rétablies
- Pourcentage des espèces en péril pour lesquelles les modifications dans les populations correspondent aux objectifs de rétablissement
- Les peuples autochtones sont impliqués dans la conservation
- Pourcentage de peuples autochtones engagés auprès d’ECCC qui indiquent que leur participation était significative
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
- Les Canadiens utilisent des renseignements météorologiques et des informations connexes faisant autorités pour prendre des décisions éclairées pour leur santé et leur sécurité
- Indice de rapidité et de précision des avertissements de veilles de temps violent sur une échelle de 0 à 10
- Pourcentage des partenaires du programme qui donne une note de satisfaction des services hydrologiques d’ECCC de 8 sur 10 ou plus
Répertoire des programmes
Donne un aperçu de la façon dont les programmes du Ministère sont organisés pour qu’il s’acquitte de son mandat
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
- Croissance propre et atténuation des changements climatiques
- Action internationale sur les changements climatiques
- Adaptation aux changements climatiques
Prévention et gestion de la pollution
- Qualité de l’air
- Qualité de l’eau et partenariats pour les écosystèmes
- ÉcoAction communautaire
- Gestion des substances et des déchets
- Promotion de la conformité et Application de la loi - Pollution
Préservation de la nature
- Espèces en péril
- Politiques et partenariats sur la biodiversité
- Oiseaux migrateurs et autres espèces sauvages
- Évaluation environnementale
- Conservation et protection des habitats
- Promotion de la conformité et Application de la loi - Faune
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
- Observations, prévisions et avertissements météorologiques et environnementaux
- Services hydrologiques
Services internes
- Gestion du matériel
- Biens immobiliers
- Services juridiques
- Communications
- Ressources humaines
- Gestion des finances
- Technologie de l’information
- Gestion de l’information
- Acquisitions
- Gestion et de surveillance
Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes
Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement du Répertoire des programmes d’ECCC sont accessibles dans l’InfoBase du GC.
Tableaux de renseignements supplémentaires
Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web d’ECCC :
- Rapport sur les achats écologiques
- Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
- Analyse comparative entre les sexes Plus
- Initiatives horizontales
- Financement pluriannuel initial
- Programme à l’horizon 2030 et objectifs de développement durable des Nations Unies
- Réponse aux commissions parlementaires
Dépenses fiscales fédérales
Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en appliquant des mesures spéciales comme de faibles taux d’imposition, des exemptions, des déductions, des reports et des crédits d’impôt. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Ce rapport fournit aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois aux programmes de dépenses fédéraux connexes, ainsi que sur les évaluations des dépenses fiscales et les analyses comparatives entre les sexes Plus connexes.
Coordonnées de l’organisation
Environnement et Changement climatique Canada
Centre de renseignements à la population
Édifice Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Ligne sans frais : 1-800-668-6767
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca
Le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada
Annexe – Définitions
- analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA Plus])
- Outil analytique utilisé pour élaborer des politiques, des programmes et d’autres initiatives adaptés et inclusifs, et mieux comprendre comment des facteurs comme le sexe, la race, l’origine nationale et ethnique, l’origine ou l’identité autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, la géographie, la culture et le handicap influent sur les expériences et les résultats et peuvent avoir une incidence sur l’accès aux programmes gouvernementaux et l’expérience vécue dans le cadre de ceux-ci.
- cadre ministériel des résultats (departmental results framework)
- Cadre qui établit un lien entre les responsabilités essentielles et les résultats ministériels et les indicateurs de résultat ministériel d’un ministère.
- cible (target)
- Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une initiative prévoit d’atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.
- crédit (appropriation)
- Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.
- dépenses budgétaires (budgetary expenditures)
- Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; paiements à des sociétés d’État.
- dépenses législatives (statutory expenditures)
- Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
- dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures)
- Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.
- dépenses prévues (planned spending)
- Selon le Plan ministériel et au Rapport sur les résultats ministériels, montants présentés dans le Budget principal des dépenses. Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur les résultats ministériels.
- dépenses votées (voted expenditures)
- Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.
- entreprise autochtone (Indigenous business)
- Organisation qui, aux fins de l’Annexe E : Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement ainsi que de l’engagement du gouvernement du Canada d’attribuer obligatoirement chaque année au moins 5 % de la valeur totale des marchés à des entreprises autochtones, correspond à la définition et aux exigences définies dans le Répertoire des entreprises autochtones.
- équivalent temps plein (full-time equivalent)
- Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget ministériel. Pour un poste donné, le nombre d’équivalents temps plein représente le rapport entre le nombre d’heures travaillées par une personne, divisé par le nombre d’heures normales prévues dans sa convention collective.
- expérimentation (experimentation)
- Conduite d’activités visant à étudier, à mettre à l’essai et à comparer les effets et les répercussions de politiques et d’interventions afin d’étayer la prise de décisions fondée sur des éléments probants, et à améliorer les résultats pour les Canadiens en apprenant ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances. L’expérimentation est liée à l’innovation, mais est distincte de celle-ci. L’innovation représente l’essai de quelque chose de nouveau, alors que l’expérimentation suppose une comparaison rigoureuse de résultats. Par exemple, le lancement d’un nouveau site Web pour communiquer avec les Canadiens peut être une innovation, mais l’essai systématique du nouveau site et la comparaison de celui-ci par rapport à un ancien site Web pour voir lequel permet de joindre le plus de personnes est une expérimentation.
- indicateur de rendement (performance indicator)
- Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un résultat ou un extrant en vue de déterminer le rendement d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus.
- indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)
- Mesure quantitative des progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.
- initiative horizontale (horizontal initiative)
- Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.
- plan (plan)
- Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.
- Plan ministériel (Departmental Plan)
- Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires. Les plans ministériels couvrent une période de trois ans et sont habituellement présentés au Parlement au printemps.
- priorité ministérielle (departmental priority)
- Plan ou projet sur lequel un ministère a choisi de concentrer ses efforts et dont il rendra compte au cours de la période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être réalisé en premier pour obtenir les résultats ministériels attendus.
- priorités pangouvernementales (government-wide priorities)
- Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2022-2023, thèmes généraux qui donnent un aperçu du programme du gouvernement dans le discours du Trône du 23 novembre 2021 : bâtir un présent et un avenir plus sains, faire croître la croissance d’une économie plus résiliente, mener une action climatique audacieuse, travailler plus fort pour rendre les collectivités sécuritaires, défendre la diversité et l’inclusion, avancer plus rapidement sur la voie de la réconciliation et lutter pour un monde plus sûr, plus juste et plus équitable.
- production de rapports sur le rendement (performance reporting)
- Processus de communication d’information sur le rendement fondée sur des éléments probants. La production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et la transparence.
- programme (program)
- Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de service.
- Rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)
- Rapport qui présente les réalisations réelles d’un ministère par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant.
- rendement (performance)
- Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées.
- répertoire des programmes (program Inventory)
- Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère et description de la manière dont les ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et aux résultats du ministère.
- responsabilité essentielle (core responsibility)
- Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.
- résultat (result)
- Conséquence attribuable en partie à une organisation, une politique, un programme ou une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation.
- résultat ministériel (departmental result)
- Conséquence ou résultat qu’un ministère cherche à atteindre. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats des programmes.
- Note de bas de page 1
-
La description de la responsabilité principale de « Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques » a été mise à jour dans le plan ministériel 2023-2024 afin de refléter l’évolution du paysage de la politique environnementale du Canada et l’octroi d’autorisations récentes. La description présentée ici reflète celle qui a été publiée dans le plan ministériel 2022-2023, avant cette mise à jour.
- Note de bas de page 2
-
Le nombre de tonnes métriques d’émissions de CO2 avec le même potentiel de réchauffement planétaire qu’une tonne métrique d’un autre GES.
- Note de bas de page 3
-
Les absorptions font référence à l’extraction de l’atmosphère et au stockage à long terme des GES.
- Note de bas de page 4
-
Il s’agit d’un outil pour calculer l’intensité en carbone du cycle de vie des combustibles et des sources d’énergie utilisés et produits au Canada.
- Note de bas de page 5
-
En 2015, tous les États membres des Nations Unies se sont réunis et ont adopté la résolution intitulée Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Celle-ci s’articule autour de 17 objectifs de développement durable qui englobent les principaux défis sociaux, économiques et environnementaux.
- Note de bas de page 6
-
Augmentation du rendement de 29 % par rapport à la norme de 2011 (mesurée en g de CO2e/mile) pour l’année modèle 2020 d’après la déclaration du constructeur soumise au plus tard en décembre 2021.
- Note de bas de page 7
-
L’objectif de 13 % pour les véhicules articulés n’a pas été atteint cette année-là, mais il devrait l’être à plus long terme grâce à la souplesse offerte aux entreprises réglementées en matière d’options de mise en conformité. Cette souplesse implique un système de crédit garantissant que les objectifs environnementaux sont atteints. Le rendement pour une année donnée n’implique pas un manque de conformité, car il faut s’attendre à des variations d’une année à l’autre. Par exemple, les entreprises peuvent mettre en réserve des crédits d’émission pendant cinq ans pour compenser les émissions excédentaires et disposent de trois ans pour compenser un déficit. ECCC est en train de mettre au point un indicateur qui rendra mieux compte de la nature de ces règlements; il sera inclus dans le plan ministériel dès que possible.
- Note de bas de page 8
-
30 kt (réduction de 19 % par rapport au niveau de référence) Remarque : Ce résultat a été modifié pour s’aligner sur les estimations d’émissions figurant dans le Rapport d’inventaire de carbone noir de 2023, lesquelles sont recalculées chaque année au fur et à mesure que de nouvelles données et méthodologies sont disponibles.
- Note de bas de page 9
-
26 kt (réduction de 30 % par rapport au niveau de référence) Remarque : Ce résultat a été modifié pour s’aligner sur les estimations d’émissions figurant dans le Rapport d’inventaire de carbone noir de 2023, lesquelles sont recalculées chaque année au fur et à mesure que de nouvelles données et méthodologies sont disponibles.
- Note de bas de page 10
-
CO2e = équivalent CO2
- Note de bas de page 11
-
À noter que 2020 a été une année exceptionnelle marquée par une pandémie et des perturbations du système énergétique mondial ; la variation des émissions peut ne pas être entièrement imputable à l’activité de mise en conformité avec la réglementation. Les résultats de 2020-21 correspondent à la première année pour laquelle les données étaient disponibles.
- Note de bas de page 12
-
Cet indicateur ne peut être mesuré et a été supprimé.
- Note de bas de page 13
-
En juillet 2021, sur les six centrales tenues de respecter la norme de rendement au plus tard le 1er janvier 2021, une a été fermée, une a démontré qu’elle respectait la réglementation et quatre font l’objet d’accords d’équivalence avec certaines provinces.
- Note de bas de page 14
-
Ce résultat est présenté sous la forme d’un ratio entre les financements privé et public (soit le financement privé divisé par celui public). Le résultat pour 2022-2023 montre que pour chaque dollar de financement public investi, 0,85 dollar de financement privé a été mobilisé. Cela représente une augmentation du financement privé par rapport à 2021-2022.
- Note de bas de page 15
-
La date à laquelle l’objectif sera atteint n’est pas applicable. La nature de l’indicateur est telle que l’on s’attend à ce qu’il produise des résultats pendant une période indéterminée.
- Note de bas de page 16
-
Les résultats cumulés du programme canadien de financement de la lutte contre les changements climatiques sont susceptibles de fluctuer en fonction du stade de mise en œuvre des différents projets. La diminution des réductions cumulées des émissions de GES entre 2021-2022 et 2022-2023 est imputable à des changements de méthodologie au niveau des projets, changements qui ont une incidence sur les résultats attendus.
- Note de bas de page 17
-
Le niveau de référence pour l’enquête quinquennale sera défini lorsque le Centre canadien des services climatiques aura été opérationnel pendant 5 à 6 années entières.
- Note de bas de page 18
-
La description de la responsabilité essentielle de Prévention et gestion de la pollution a été mise à jour dans le Plan ministériel 2023-2024 afin de refléter l’évolution du paysage de la politique environnementale du Canada et l’octroi récent d’autorisations. La description présentée ici reflète celle qui a été publiée dans le Plan ministériel 2022-2023, avant cette mise à jour.
- Note de bas de page 19
-
Quelques projets portaient sur la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse, par exemple pour caractériser les chloroalcanes et les mélanges chimiques dans l’air. L’une des principales conclusions de ces activités de recherche est qu’une fois rejetées dans l’environnement, certaines substances chimiques peuvent se transformer en d’autres substances chimiques encore plus dangereuses que celles d’origine. Il est donc nécessaire de mieux caractériser et comprendre ces mélanges chimiques afin d’évaluer et de gérer, le cas échéant, les risques qu’ils présentent pour l’environnement.
- Note de bas de page 20
-
Les particules fines désignent une gamme de particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns (µm). C’est pourquoi on les appelle souvent « PM2,5 ».
- Note de bas de page 21
-
En 2015, tous les États membres des Nations Unies se sont réunis et ont adopté la résolution intitulée Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Celle-ci s’articule autour de 17 objectifs de développement durable qui englobent les principaux défis sociaux, économiques et environnementaux.
- Note de bas de page 22
-
Le retard dans la communication des résultats correspond au temps nécessaire à la compilation des données, au contrôle de la qualité et à l’analyse des données.
- Note de bas de page 23
-
Les données concernent la période 2016-2018.
- Note de bas de page 24
-
Les données concernent la période 2017-2019.
- Note de bas de page 25
-
Les données concernent la période 2018-2020.
- Note de bas de page 26
-
La baisse des résultats entre 2021-2022 et 2022-2023 peut être attribuée aux grands incendies de forêt qui ont détérioré la qualité de l’air; cet indicateur est donc « à risque ».
- Note de bas de page 27
-
Les données de 2022 n’ont pas encore été compilées et analysées puisque les résultats définitifs de 2022 ne seront soumis à ECCC qu’au cours du premier semestre 2023. L’analyse de l’ensemble des données de 2022 sera terminée en octobre 2023.
- Note de bas de page 28
-
Il s’agit d’un nouvel indicateur introduit en 2022-23.
- Note de bas de page 29
-
La publication d’un instrument de gestion des risques (Liste critique des ingrédients de cosmétiques) a été retardée d’un mois et l’objectif n’a donc pas été atteint. La date de publication de cet instrument est déterminée en dehors du programme et concerne les substances relevant du Plan de gestion des produits chimiques et d’autres programmes. Dans ce cas, la publication a été publiée légèrement après le délai imparti en raison de circonstances imprévues. Les responsables du programme continueront à surveiller les processus de publication afin de déterminer si la méthodologie employée doit être mise à jour à l’avenir.
- Note de bas de page 30
-
La description de la responsabilité de conservation de la nature a été mise à jour dans le Plan ministériel de 2023-2024 pour tenir compte de l’évolution du paysage canadien en matière de politique environnementale et des récents pouvoirs accordés. La description présentée ici correspond à celle qui a été publiée dans le Plan ministériel 2022-2023, avant cette mise à jour.
- Note de bas de page 31
-
En décembre 2022, les parties à la Convention sur la diversité biologique, dont le Canada, ont établi l’objectif ambitieux de conserver au moins 30 % des aires terrestres et des eaux intérieures, et 30 % des aires marines d’ici 2030. C’est là une des 23 cibles qui, ensemble, composent le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.
- Note de bas de page 32
-
Les autres mesures de conservation efficaces (AMCE) sont un moyen de reconnaître les efforts de conservation d’autrui.
- Note de bas de page 33
-
En 2015, l’ensemble des États membres des Nations Unies se sont réunis et ont adopté le programme Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Celui-ci est centré sur 17 objectifs de développement durable qui englobent des enjeux fondamentaux sur les plans social, économique et environnemental.
- Note de bas de page 34
-
Les résultats pour 2020-2021 et 2021-2022 seront connus en décembre 2023.
- Note de bas de page 35
-
La base de données sur laquelle s’appuie cet indicateur est en train d’être reconstruite; elle sera prête bientôt. Les résultats seront fonctionnels et remplis d’ici décembre 2023.
- Note de bas de page 36
-
La création d’aires protégées prend du temps et exige des négociations avec de nombreux partenaires. Les travaux sont en cours pour atteindre la cible canadienne de 25 % d’ici 2025.
- Note de bas de page 37
-
Même si le Canada continue d’investir beaucoup de temps et de ressources pour favoriser l’établissement de relations profondes avec un vaste éventail de partenaires, il y a encore beaucoup d’obstacles qui peuvent rendre le processus long et complexe. Le financement durable et continu est encore un frein à la création de nouvelles aires protégées. ECCC continue à travailler pour atteindre cette cible en mettant à profit les relations établies avec les partenaires afin de transformer les projets de renforcement des capacités en projets de création, en négociant des accords sur la nature avec les provinces et les territoires qui le souhaitent, et en se concentrant sur des initiatives de conservation à grande échelle, comme les quatre initiatives de financement de projets à perpétuité annoncés à la COP15.
- Note de bas de page 38
-
La formulation de l’indicateur a été mise à jour pour être cohérente avec les Résultats prévus pour 2022-2023 sur l’Infobase du GC.
- Note de bas de page 39
-
En général, le rétablissement réussi des espèces devrait améliorer ou stabiliser les chances de survie de l’espèce à l’état sauvage. Le rétablissement prend du temps; une fois les mesures de rétablissement mises en place, il peut s’écouler de nombreuses années avant que les changements dans les populations ne soient mesurables.
- Note de bas de page 40
-
Avec le nombre croissant d’espèces inscrites sur la liste des espèces en péril, les progrès vers cet objectif sont lents. Le rétablissement des espèces en péril se fait sur plusieurs décennies, mais des progrès sont réalisés. Des activités sont en cours pour poursuivre la progression et la modernisation des approches de rétablissement des espèces en péril.
- Note de bas de page 41
-
Le type, la fréquence et la portée de la participation varie d’une année à l’autre en fonction des activités des programmes. La cible a été établie en se servant des résultats de la première année de l’enquête (2018-2019) comme référence. Les résultats pour cet indicateur ont fluctué d’année en année, se situant entre 61 % et 70 % depuis 2018-2019.
- Note de bas de page 42
-
La description de la responsabilité essentielle « Prévision des conditions météorologiques et environnementales » a été mise à jour dans le Plan ministériel 2023-2024 afin de tenir compte de l’évolution du paysage en matière de politique environnementale au Canada et des autorisations récentes. La description présentée ici reflète celle qui a été publiée dans le Plan ministériel 2022-2023, avant cette mise à jour.
- Note de bas de page 43
-
En 2015, tous les États membres des Nations Unies se sont réunis et ont adopté Transformer notre monde : Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Au cœur de ce programme se trouvent 17 objectifs de développement durable qui englobent les principaux défis sociaux, économiques et environnementaux.
- Note de bas de page 44
-
Bien que la valeur de l’indicateur soit légèrement inférieure à celle de la période de déclaration précédente (8,8), elle se situe dans le niveau de variabilité d’une année à l’autre prévu et dépasse la valeur cible de 8,4.
- Note de bas de page 45
-
Remplacement de l’ancien l’indicateur : Pourcentage des Canadiens qui utilisent les renseignements d’ECCC pour aborder les répercussions liées à l’eau sur la santé, la sécurité, l’économie et l’environnement. Le nouvel indicateur est un indicateur de rendement annuel plus significatif, car il représente les groupes d’utilisateurs réels du programme.
- Note de bas de page 46
-
Les partenaires provinciaux et territoriaux ont indiqué que les Services hydrologiques nationaux (SHN) continuent de connaître des arriérés dans les données historiques approuvées, ce qui limite la satisfaction malgré d’autres points forts. Comme il s’agissait du principal problème contribuant à l’insatisfaction des partenaires, les SHN concentreront leurs efforts sur l’optimisation des processus d’approbation et de téléversement des données et l’élimination des arriérés d’approbation des données. De plus, les SHN mettront de nouveau l’accent sur les relations avec les clients, en particulier ceux qui ont exprimé leur insatisfaction à l’égard des services fournis. Cette année, le nombre de réponses au sondage était faible. Au cours des prochaines années de déclaration, les SHN mettront l’accent sur l’envoi des sondages plus tôt afin de donner plus de temps pour répondre.
