Rapport sur les résultats ministériels 2023-2024 d’Environnement et Changement climatique Canada
Message du ministre
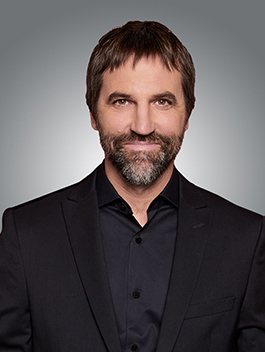
L’honorable Steven Guilbeault, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Je suis fier de présenter le Rapport sur les résultats ministériels 2023-2024 d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui décrit certaines des réalisations importantes du Ministère et ses contributions à la lutte contre la triple crise planétaire des changements climatiques, de l’appauvrissement de la biodiversité et de l’augmentation de la pollution.
Au cours du dernier exercice financier, nous avons pris des mesures pour préserver la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience des Canadiens aux effets des changements climatiques, alors que le Canada se forge un avenir au sein d’une économie forte fondée sur la croissance propre. Les résultats présentés dans le Rapport d’étape 2023 sur le Plan de réduction des émissions pour 2030, publié par ECCC en décembre 2023, montrent que nous sommes parvenus à réduire la pollution et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif actuel pour 2030. Nous avons continué de promouvoir la croissance propre au Canada en élaborant des mesures réglementaires et des normes dans les domaines de l’électricité propre, des véhicules électriques, de la réduction des émissions de méthane et du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier.
Pour accélérer les progrès vers l’atteinte des objectifs en matière de qualité de l’air et de lutte contre les changements climatiques, les employés d’ECCC ont fait progresser les travaux sur des réglementations clés visant à garantir aux Canadiens un accès à de l’électricité propre, une plus grande disponibilité des véhicules électriques et un air plus pur.
En 2023, Environnement et Changement climatique Canada a apporté un soutien et une expertise sans précédent pendant l’une des pires saisons des feux de forêt au Canada, et nous avons publié la première Stratégie nationale d’adaptation du Canada – qui établit un plan d’action que tous les Canadiens d’un océan à l’autre peuvent mettre en œuvre pour se protéger et protéger nos terres et nos rivages contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les autres effets des changements climatiques.
S’appuyant sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de 2022, ECCC a publié sa première stratégie nationale pour protéger la nature au Canada en juin 2024. La stratégie est le fruit du travail et de la collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les entreprises et d’autres intervenants tout au long de l’exercice 2023-2024. ECCC a renforcé les partenariats en signant des accords avec des partenaires pour établir un projet de financement pour la permanence dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que plusieurs autres accords sur la nature visant à promouvoir la collaboration bilatérale et trilatérale avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.
Suite aux modifications apportées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) par le Parlement en 2023, la Loi comprend, dans son préambule, la reconnaissance que chaque individu au Canada a droit à un environnement sain. ECCC a initié la mobilisation dans l'élaboration d'un cadre pour la mise en œuvre de l'obligation du gouvernement de protéger ce droit dans le cadre de l'application de la LCPE, ce qui représente un progrès pour la protection de l'environnement, de la santé humaine et de la justice environnementale.
Les employés d’ECCC continuent de travailler fort pour la santé de la planète et des générations futures. Leur expertise sert les Canadiens et l’intérêt public mondial au plus haut niveau et est en demande à l’échelle internationale. En tant que ministre, je suis fier du travail qu’ils ont accompli, et je vous présente ce rapport afin que vous puissiez en apprendre davantage sur nos réalisations.
Résultats : Nos réalisations
Responsabilités essentielles et services internes
- Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
- Prévention et gestion de la pollution
- Conservation de la nature
- Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
- Services internes
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
Description
Soutenir et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des programmes et des plans du Canada en matière d’environnement et de changements climatiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir la transition vers une économie résiliente, inclusive et à faibles émissions de carbone. Pour y parvenir, il faudra élaborer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation des changements climatiques, soutenir l’adaptation aux changements climatiques, contribuer aux mesures et initiatives internationales liées à l’environnement et au climat, et mobiliser les autres ministères fédéraux, les partenaires autochtones, les provinces et territoires, les partenaires et intervenants nationaux et internationaux, les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées.
Progrès à l’égard des résultats
Tableau 1 : Cibles et résultats relativement à Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
Émissions de GES annuelles du Canada (Mt d’éq. CO2) |
Réduction de 40 à 45 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 |
2032 (les données pour 2030 seront disponibles en 2032) |
2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 :
|
Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les véhicules légersNote de bas de page 1 Note de bas de page 2 |
En cours d’examen2 |
En cours d’examen2 |
2021-2022 : Réduction de 23 %Note de bas de page 3 2022-2023 : Réduction de 26 %Note de bas de page 4 2023-2024 : Réduction de 28 %Note de bas de page 5 |
Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les véhicules lourdsNote de bas de page 6 |
[Rapport de l’année modèle 2023Note de bas de page 7] :
|
Avril 2024 |
2021-2022 : [année modèle 2020]
2022-2023 : [année modèle 2021]
2023-2024: [année modèle 2022]
|
Émissions de carbone noirNote de bas de page 8 |
Réduction de 25 % par rapport aux émissions nationales de référence en 2013 |
Décembre 2025 |
2021-2022 : 22 % de réduction par rapport au niveau de référenceNote de bas de page 9 2022-2023 : 30 % de réduction par rapport au niveau de référence 2023-2024 : 30 % de réduction par rapport au niveau de référence |
Émissions d’hydrofluorocarbures (HFC)Note de bas de page 10 |
Réduction de 10 % de la consommation par rapport à la valeur de référence canadienne calculée pour les HFC qui est de 18 008 795 tonnes d’éq. CO2 |
Décembre 2023 |
2021-2022 : 38,5 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2021 2022-2023 : 24,1 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2022 2023-2024 : 33,6 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2023 |
Émissions de méthane du secteur pétrolier et gazierNote de bas de page 11 |
Diminution annuelle vers une réduction de 40–45 % par rapport aux niveaux de 2012Note de bas de page 12 |
Décembre 2025 |
2021-2022 : Réduction de 45 % (32 Mt d’éq. CO2 )Note de bas de page 13 2022-2023 : Réduction de 35 % (37 Mt d’éq. CO2 )Note de bas de page 14 2023-2024 : Réduction de 31,9 % (26,9 Mt d’éq. CO2)Note de bas de page 15 |
Pourcentage d’unités de production d’électricité alimentées au charbon qui satisfont leur niveau d’intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) |
Décembre 2023 |
2021-2022 : 100 % 2022-2023 : 100 % 2023-2024 : 100 % |
|
Des systèmes de tarification de la pollution par le carbone sont en place au CanadaNote de bas de page 17 |
Toutes les provinces et tous les territoires ont en place une tarification de la pollution par le carbone qui respecte la norme fédérale ou le système fédéral s’applique. |
Mars 2023 |
2021-2022 : 13 Provinces et territoires 2022-2023 : 13 Provinces et territoires 2023-2024 : 13 Provinces et territoires |
Émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités d’ECCCNote de bas de page 18 |
Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport aux 21 549 tonnes d’éq. CO2 émis en 2005-2006. |
Décembre 2025 |
2021-2022 : 40,4 % 2022-2023 : 39,6 % 2023-2024 : 39,6 %Note de bas de page 19 |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage de politiques ou de stratégies nationales sur les changements climatiques élaborées par le Ministère qui intègrent les connaissances et les perspectives des Premières Nations, des Inuits et des Métis. | 100 % | Mars 2024 | 2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : 100 % |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
Montant cumulé des financements privés mobilisés par les investissements du secteur public canadienNote de bas de page 20 |
2,65 milliards de dollars : Montants cumulatifs plus élevés des financements privés pour la lutte contre les changements climatiques, d’année en année (atteignant globalement un rapport d’au moins 1 à 0,5 de financement du secteur privé optimisé par les investissements du secteur public canadien). |
Décembre 2050 |
2021-2022 : Entre 2017 et 2020, le Canada a mobilisé 205,7 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 270,88 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,759). 2022-2023 : Entre 2017 et 2021, le Canada a mobilisé 312,4 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 367,5 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,85) 2023-2024 : Entre 2017 et 2022, le Canada a mobilisé 347 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 394 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,88)Note de bas de page 21 |
5,3 milliards de dollars : Montants cumulatifs plus élevés des financements privés pour la lutte contre les changements climatiques, d’année en année (atteignant globalement un rapport de 1 à 0,75 de financement du secteur privé optimisé par les investissements du secteur public canadien) |
Décembre 2050 |
2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : À partir de l’année civile 2022, le Canada a mobilisé 156 000 $ CA du secteur privé provenant d’un financement public de 17 millions de dollars canadiens provenant de l’engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada en matière de financement climatique, ce qui équivaut à un ratio de 0,009Note de bas de page 22 |
|
Réduction des GES résultant de programmes internationaux financés par le CanadaNote de bas de page 23 |
2,65 milliards de dollars : Réductions cumulatives plus élevées d’année en année, par rapport à la référence, atteignant une réduction minimale de 200 Mt de GES |
Décembre 2050 |
2021-2022 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 228,6 Mt. 2022-2023 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 223,7 Mt 2023-2024 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 205,3 Mt.Note de bas de page 24 |
5,3 milliards de dollars : Des réductions cumulatives plus élevées d’année en année, pour atteindre une réduction de 300 Mt de GES |
Décembre 2050 |
2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : On estime qu’à ce jour, que l’engagement du Canada en matière de financement climatique permettra de réduire les émissions de GES de 28,7 mégatonnesNote de bas de page 25 |
|
Le nombre cumulatif de personnes dans les pays en voie de développement ayant profité des fonds d’adaptation du CanadaNote de bas de page 26 |
2,65 milliards de dollars : Au moins 10 millions de personnes |
Décembre 2030 |
2021-2022 : On estime que 6,6 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour. 2022-2023 : On estime que 8,04 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour. 2023-2024 : On estime que 6,7 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour.Note de bas de page 27 |
5,3 milliards de dollars : Au moins 10 millions de personnes |
Décembre 2050 |
2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : On estime que 3,8 millions de personnes devraient développer une résilience accrue face aux changements climatiques grâce aux fonds délivrés jusqu'à présentNote de bas de page 28 |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Nombre de particuliers, d’entreprises et de gouvernements qui utilisent les services climatiques et qui utilisent ces renseignements dans la prise de décisionNote de bas de page 29 | Augmentation par rapport à l’année référence | Accès aux services : annuellement, en mars Utilisation des renseignements : (tous les 5 ans) Mars 2028 |
2021-2022 : 167 496 visitesNote de bas de page 30 2022-2023 : 197 038 visitesNote de bas de page 31 2023-2024 : 252 340 visites |
Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC.
Renseignements sur les résultats
La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques en 2023‑2024 en les comparant aux résultats prévus dans le Plan ministériel d’ECCC pour l’exercice.
Lutter contre les changements climatiques
Les effets dévastateurs des changements climatiques sont évidents. En 2023 seulement, le Canada a connu l’été le plus chaud de l’histoire, les plus grands feux de forêt de l’histoire, une sécheresse dans les Prairies et des inondations en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Des maisons ont été détruites, des vies ont été perdues, des milliers de personnes ont dû évacuer leurs résidences, des communautés et des entreprises ont été touchées, la fumée des feux de forêt a recouvert le pays et la biodiversité a été mise en danger. En plus de répercussions personnelles et émotionnelles, ces effets des changements climatiques ont des conséquences économiques qui touchent les familles et les collectivités et qui ont des répercussions sur l’économie canadienne. La lutte contre les changements climatiques est un engagement clé d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
En juin 2023, le Ministère a publié la Stratégie nationale d’adaptation du Canada et continué d’offrir des services climatiques. La stratégie complète énonce une vision pour un Canada plus résilient et établit un plan directeur pansociétal favorisant des mesures mieux coordonnées et plus ambitieuses en matière d’adaptation. Elle comprend des buts, des objectifs et des cibles pour réduire les effets des catastrophes liées au climat, améliorer la santé et le bien-être, protéger et restaurer la nature et la biodiversité, construire et maintenir des infrastructures résilientes et soutenir l’économie et les travailleurs.
En 2023-2024, le Ministère a travaillé avec d’autres ministères fédéraux et des partenaires de l’ensemble de la société pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’adaptation. Il convient de noter que le Plan d’action pour l’adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), publié en novembre 2022 et mis à jour au printemps 2023, représente la contribution fédérale à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’adaptation du Canada. Ce plan renouvelle les politiques fédérales d’adaptation aux changements climatiques et contient le premier inventaire complet des programmes fédéraux liés à l’adaptation. Il comprend plus de 70 mesures d’adaptation nouvelles et en cours dans 22 ministères et organismes fédéraux, et prévoit jusqu’à deux milliards de dollars en nouveaux investissements pour améliorer les efforts d’adaptation partout au Canada.
De plus, le Centre canadien des services climatiques a continué d’offrir des services climatiques aux Canadiens et a travaillé avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer les services climatiques dans les régions, élargissant ainsi son réseau national de fournisseurs de services climatiques dans l’ensemble du pays.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de courte durée
Transition vers un avenir à consommation énergétique carboneutre
ECCC a continué d’aider à faire en sorte que les objectifs de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité deviennent une réalité. Cette loi, qui a reçu la sanction royale en juin 2021, donne force de loi à l’engagement du Canada en matière de carboneutralité, qui consiste à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et exige que le gouvernement établisse des cibles nationales au moins 10 ans à l’avance pour la réduction des émissions de GES à des intervalles de 5 ans. En 2023-2024, ECCC a lancé des consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, le Groupe consultatif pour la carboneutralité et les Canadiens intéressés afin d’établir une cible nationale de réduction des émissions pour 2035, conformément aux exigences.
Défi carboneutre
ECCC a lancé le programme Défi carboneutre en août 2022 afin d’encourager et d’aider les entreprises qui exercent des activités au Canada à élaborer et à mettre en œuvre des plans de carboneutralité d’ici 2050 pour leurs installations et leurs activités. Grâce à cette initiative canadienne, les entreprises participantes peuvent renforcer la confiance du public et des investisseurs dans leurs plans de carboneutralité en s’appuyant sur des directives techniques crédibles, l’accès à une communauté de pratique et la reconnaissance fédérale de leurs engagements, tout en bénéficiant d’exigences de déclaration simples. Elles peuvent également tirer parti de leur participation au programme pour répondre à des exigences fédérales en matière d’approvisionnement et de financement, notamment la Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de gaz à effet de serre et l’établissement des cibles de réduction du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, qui concerne les achats fédéraux de plus de 25 millions de dollars, ainsi que l’Initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l’innovation géré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
En 2023-2024, la réponse du secteur privé a été impressionnante; les entreprises participantes sont de toutes tailles et œuvrent dans de nombreux secteurs de l’économie canadienne : énergie, transports, construction, industrie lourde, TI, commerce de détail, et plus encore. En s’engageant à atteindre la carboneutralité, les entreprises s’efforcent dès maintenant de contribuer à protéger l’environnement du Canada pour les générations futures, tout en stimulant l’innovation, en faisant preuve de responsabilité et en assurant leur compétitivité à long terme dans une économie mondiale décarbonée.
Faire des progrès dans la réduction des émissions
En 2023-2024, ECCC a poursuivi ses travaux avec ses partenaires, y compris ceux visant à appliquer les mesures de réduction des émissions décrites dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, afin d’honorer ses engagements et d’accroître collectivement l’action climatique pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. Grâce aux efforts collectifs, le Canada est sur une bonne voie pour atteindre sa cible de réduction des GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Le rôle du Ministère dans la mise en œuvre du Plan de réduction des émissions pour 2030 comprend la coordination et la surveillance, ainsi que la responsabilité de plusieurs mesures et stratégies importantes annoncées dans le plan, comme les mesures réglementaires visant à réduire les émissions des véhicules légers. Le Ministère a également finalisé la norme sur la disponibilité des véhicules électriques, le Règlement sur l’électricité propre et le Règlement sur le méthane dans le secteur du pétrole et du gaz renforcé. ECCC a aussi travaillé à concevoir un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. La mobilisation continue des partenaires et des intervenants pour mettre en œuvre le plan était une priorité en 2023-2024.
En 2023, le premier rapport d’étape sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 a été publié, comme l’exige la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Ce rapport conclut qu’en supposant la mise en œuvre complète de ce plan, il est à présent prévu que le Canada dépassera son objectif provisoire de réduire les émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2026. Le pays est sur une bonne voie pour atteindre sa cible de 2030; il planifie des mesures supplémentaires et travaille avec des partenaires pour atteindre ses cibles ambitieuses de réduction des émissions de GES. Il est attendu que le Canada atteindra un niveau d’émissions 40 % inférieur aux niveaux de 2005 si des mesures supplémentaires (prises en compte dans le rapport d’étape) et de nouvelles mesures (non prises en compte dans le rapport d’étape) sont mises en œuvre.
ECCC a travaillé avec Ressources naturelles Canada pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement à plafonner et à réduire les émissions de GES du secteur pétrolier et gazier, garantissant ainsi que ce secteur apporte une contribution ambitieuse et réalisable à l’atteinte des objectifs climatiques du pays pour 2030. Lors de la CdP26 en 2021, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures ambitieuses pour soutenir l’atteinte de la cible nationale relative aux GES pour 2030. Ces mesures comprenaient le plafonnement et la réduction des émissions de GES du secteur pétrolier et gazier au rythme et à l’échelle nécessaires pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, ainsi que la réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030. En 2023-2024, ECCC a pris des mesures énergiques pour faire progresser ces objectifs. En décembre 2023, le Ministère a publié le projet de cadre réglementaire pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, qui propose un système national de plafonnement et d’échange pour le secteur, encadré par un règlement qui sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le Ministère a avancé la mise en œuvre de Plus vite et plus loin : la stratégie canadienne sur le méthane, un plan visant à réduire les émissions de méthane dans l’ensemble de l’économie canadienne qui est conforme à l’Engagement mondial sur le méthane [disponible seulement en Anglais], lequel appelle à une réduction de 30 % des émissions mondiales de méthane. ECCC a collaboré avec succès avec les provinces, les territoires et d’autres ministères clés pour mettre en œuvre de nouvelles méthodes importantes permettant de quantifier les émissions fugitives du secteur pétrolier et gazier dans le Rapport d’inventaire national. Pour la première fois, ces méthodes de quantification font appel à des mesures atmosphériques.
En 2023-2024, le Ministère a publié des modifications proposées de la réglementation sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier qui permettront d’atteindre l’objectif du Canada de réduire de 75 % les émissions de méthane de ce secteur par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030, ce qui correspond à une réduction de plus de 200 mégatonnes (d’équivalents en dioxyde de carbone) entre 2027 et 2040. De plus, le Ministère a continué d’élaborer un nouveau règlement visant à réduire les émissions de méthane des sites d’enfouissement de 50 % d’ici 2030. Un projet de règlement est prévu à la fin de 2024-2025.
ECCC a continué de travailler avec les provinces, les territoires, les groupes autochtones, l’industrie, les organisations non gouvernementales et le milieu universitaire à l’élaboration du Règlement sur l’électricité propre, qui devrait permettre au secteur de l’électricité de devenir carboneutre, tout en soutenant une électricité fiable et abordable. Un réseau électrique propre est essentiel pour parvenir à une économie carboneutre, car il permet de décarboner d’autres secteurs. Le Ministère appuie également les efforts visant à faire progresser la première phase d’une boucle de l’Atlantique modifiée reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ce projet facilitera le transport d’énergie propre entre les provinces, aidera à éliminer progressivement la production d’électricité à partir de charbon et favorisera un réseau carboneutre.
Le Ministère a continué de travailler avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Transports Canada et Ressources naturelles Canada pour atteindre les objectifs concernant les véhicules zéro émission (VZE), qui doivent représenter au moins 60 % des ventes de véhicules légers d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035, ainsi que 100 % des ventes de véhicules moyens et lourds d’ici 2040.Note de bas de page 32 Les travaux d’ECCC devant accélérer la transition vers un avenir carboneutre comprennent la publication d’un règlement exigeant l’approvisionnement en véhicules légers zéro émission à compter de 2026. Ce règlement est entré en vigueur en décembre 2023 et exige que le Canada atteigne la cible de 100 % de VZE dans les ventes de véhicules légers d’ici 2035. En 2023-2024, ECCC a également continué d’appuyer le travail d’autres partenaires fédéraux dans le déploiement d’un programme de 547,5 millions de dollars sur quatre ans d’incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission afin d’aider les entreprises à moderniser leurs parcs de véhicules. Ces incitatifs, annoncés en 2022, s’ajoutent à d’autres programmes soutenant le passage aux VZE, notamment les suivants :
- 1,7 milliard de dollars pour prolonger le Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) jusqu’en mars 2025 afin d’aider un plus grand nombre de Canadiens à adopter les VZE, auxquels s’ajoute un montant complémentaire de 607,9 millions de dollars annoncé dans le budget de 2024;
- un investissement de 500 millions de dollars de la Banque de l’infrastructure du Canada dans l’infrastructure urbaine et commerciale à grande échelle de recharge et de ravitaillement des VZE;
- 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour financer le déploiement de l’infrastructure de recharge des VZE dans les collectivités suburbaines et éloignées au moyen du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).
ECCC a également collaboré avec la Californie, dans le cadre du récent protocole d’entente avec le California Air Resources Board, sur des mesures visant à faire progresser le transport propre et à réduire les émissions de GES.
Faire progresser le leadership climatique autochtone
ECCC a maintenu son partenariat et poursuivi son dialogue constructif avec les gouvernements et les organisations représentantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de faire progresser le leadership autochtone en matière de climat et de permettre la conception de politiques et de programmes fédéraux qui répondent à leurs priorités climatiques. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont à l’avant-plan des efforts de sensibilisation aux répercussions des changements climatiques. Ils ont appelé à des mesures ambitieuses pour réduire la pollution, s’adapter aux conséquences des changements climatiques et améliorer la manière dont l’environnement naturel est respecté et protégé. Ce faisant, ils continuent de renforcer l’importance cruciale du leadership des peuples autochtones dans la réalisation des changements fondamentaux nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et faire progresser la réconciliation au Canada. C’est pourquoi, comme il est indiqué dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, le Ministère a continué de collaborer avec les partenaires autochtones à l’élaboration de politiques et de programmes visant à répondre aux priorités climatiques d’une manière qui respecte la science et le savoir autochtones, reconnaît les droits inhérents et issus de traités des peuples autochtones et fait progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il est très important de souligner la nécessité de tisser la science autochtone avec la science occidentale pour orienter et améliorer la prise de décisions tout en faisant progresser le leadership autochtone en matière de climat afin d’assurer que la conception des politiques et des programmes fédéraux tient compte des priorités climatiques des Autochtones. Les principales initiatives en 2023-2024 ont été : la collaboration avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour élaborer un programme de leadership autochtone en matière de climat fondé sur les distinctions; la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’adaptation; et l’avancement des projets d’énergie propre et d’efficacité énergétique dans le cadre du Fonds de leadership autochtone.
Le Ministère a également travaillé à l’instauration de divulgations financières obligatoires liées au climat. Ces divulgations appuient la ministre des Finances dans le travail qu’elle réalise avec les provinces et les territoires pour passer à des divulgations financières obligatoires liées au climat reposant sur le cadre du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat [disponible seulement en Anglais], et pour exiger que les institutions sous réglementation fédérale, y compris les institutions financières, les caisses de retraite et les organismes gouvernementaux, publient des informations financières liées au climat et des plans de carboneutralité. Le Ministère a continué de collaborer avec le ministère des Finances Canada pour appuyer les travaux du Conseil d’action en matière de finance durable, qui a fourni une contribution du secteur financier à la conception de l’infrastructure fondamentale du marché, y compris une meilleure divulgation des données climatiques, la définition des investissements verts et de transition, ainsi que les données et les analyses climatiques.
ECCC a également poursuivi l’élaboration d’une stratégie sur les données climatiques et de plans d’action connexes, qui devraient être achevés en 2024-2025. Cette stratégie s’appuiera sur les travaux du Conseil d’action en matière de finance durable et sur de nombreuses stratégies fédérales relatives au climat et aux données. Elle servira de feuille de route pour mettre à la disposition du public des données fédérales pertinentes pour l’évaluation des risques physiques et de transition liés aux changements climatiques. Les travaux soutenant l’élaboration de cette stratégie, y compris l’analyse et la mobilisation d’autres ministères fédéraux et du secteur privé, vont bon train.
Tarification de la pollution par le carbone
ECCC a continué de mettre en œuvre l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Un prix de la pollution par le carbone au Canada incite les particuliers, les ménages et les entreprises à choisir des options plus propres, notamment les technologies vertes. En vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux éléments : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance fédérale sur les combustibles) et un mécanisme de tarification fondé sur le rendement s’appliquant aux installations industrielles, connu sous le nom de Système de tarification fondé sur le rendement (STFR). Le système s’applique dans les provinces et les territoires qui en ont fait la demande et dans ceux qui n’avaient pas mis en place de système répondant aux critères de rigueur du modèle fédéral. Le STFR est conçu pour fixer un prix de la pollution par le carbone et réduire les risques de fuite de carbone de l’industrie, aidant ainsi les industries à maintenir leur compétitivité par rapport à leurs homologues internationaux et leur offrant la souplesse nécessaire pour respecter les limites d’émissions grâce à l’échange de droits d’émission et à l’utilisation de crédits compensatoires pour les GES.
En plus de s’assurer que les systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone sont harmonisés aux normes de rigueur nationales minimales (le modèle fédéral), ECCC a appuyé la tarification de la pollution par le carbone en 2023-2024 :
- en continuant d’administrer le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) fédéral pour les émetteurs industriels;
- en modifiant le Règlement sur le STFR pour assurer la réduction continue des émissions de GES, réduire le fardeau administratif et améliorer la mise en œuvre;
- en mettant en œuvre le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les GES et en continuant d’élaborer et de publier des protocoles fédéraux de crédits compensatoires pour les GES applicables à divers types de projets dans d’autres secteurs. Le système encourage les projets novateurs qui vont au-delà des exigences légales et des pratiques courantes pour réduire les émissions de GES, et qui ne sont pas couverts par la tarification de la pollution par le carbone, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des déchets et des technologies de pointe. Par exemple, en 2023-2024, ECCC a publié un nouveau projet de protocole sur la réduction des émissions de méthane entérique des bovins de boucherie qui incitera les agriculteurs à réduire les émissions de méthane en leur donnant la possibilité de générer et de vendre des crédits compensatoires fédéraux aux installations assujetties au STFR ou à d’autres qui cherchent à atteindre des cibles climatiques volontaires.
Le gouvernement du Canada a continué de retourner les recettes du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone aux administrations d’origine. Dans les provinces où ce système s’applique, il a retourné la majorité des recettes de la redevance fédérale sur les combustibles directement aux familles chaque trimestre par la Remise canadienne sur le carbone (RCC) pour les particuliers. La partie restante des recettes de la redevance est retournée aux agriculteurs, aux petites et moyennes entreprises, et aux gouvernements autochtones par des mécanismes élaborés conjointement. Les recettes issues du STFR fédéral ont été retournées à l’administration dans laquelle elles ont été perçues, notamment pour appuyer la réduction des émissions dans les installations industrielles.
Comment fonctionne la tarification fédérale du carbone?
Le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux éléments : la redevance fédérale sur les combustibles et le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR). Toutes les recettes provenant de ces deux éléments sont retournées aux Canadiens.
- La plupart des recettes de la redevance fédérale sur les combustibles vont directement aux ménages par les paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone (anciennement l’Incitatif à agir pour le climat). Le reste des recettes est retourné par des programmes fédéraux à des groupes qui pourraient être touchés de façon disproportionnée par les changements climatiques, soit les agriculteurs, les peuples autochtones et les petites et moyennes entreprises.
- Les recettes perçues dans le cadre du STFR fédéral sont retournées au moyen du Fonds issu des produits du STFR. Ce dernier soutient des projets de décarbonation et d’énergie propre dans les provinces et les territoires où le STFR fédéral s’applique. Il compte deux volets, soit le Programme d’incitation à la décarbonisation, qui appuie les projets de technologies propres réduisant les émissions de GES dans les installations assujetties au STFR, et le Fonds pour l’électricité de l’avenir, qui appuie les initiatives d’énergie propre à grande échelle. Par ces deux volets, ECCC a engagé environ 581 millions de dollars en recettes du STFR.
En 2023-2024, ECCC a continué d’élaborer conjointement des approches pour remettre 1 % des produits de la redevance sur les combustibles à des bénéficiaires autochtones dans les provinces et territoires où le programme fédéral est en vigueur. Un programme a été conçu en fonction des commentaires des partenaires et des organismes centraux, et la proposition est actuellement en attente de décision. Les commentaires des partenaires ont contribué à la décision de la ministre des Finances d’augmenter le pourcentage des recettes à retourner aux gouvernements autochtones à compter de 2024-2025.
Le Ministère a continué de faire progresser les travaux nationaux et internationaux visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte durée de vie (PCDV), conformément à la Stratégie de lutte contre les polluants climatiques de courte durée de vie (PDF) du Canada. Les PCDV tels que le carbone noir, le méthane, les hydrofluorocarbones et l’ozone troposphérique sont de puissants GES et polluants atmosphériques qui contribuent au réchauffement climatique et peuvent compromettre la qualité de l’air. En 2023-2024, le Canada a contribué aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de PCDV en participant à des forums internationaux, comme la Coalition pour le climat et l’air pur, le Conseil de l’Arctique [disponible seulement en Anglais], l’Engagement mondial sur le méthane [disponible seulement en Anglais] (dont il était un pays champion) et l’Initiative mondiale sur le méthane [disponible seulement en Anglais]. ECCC fournit également deux millions de dollars en fonds de lutte contre les changements climatiques entre 2023 et 2026 pour atténuer le méthane dans les pays en développement grâce à des projets sélectionnés à la lumière des conseils de l’Initiative mondiale sur le méthane.
ECCC a poursuivi la mise en œuvre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement afin de réduire progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbones (HFC), de puissants PCDV qui contribuent aux changements climatiques. Les mesures de contrôle devraient entraîner des réductions cumulatives des émissions de GES de 37 mégatonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (Mt éq. CO2) entre 2018 et 2030.
Engagement à réduire les HFC
Le Canada s’est engagé, dans l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, à réduire les HFC de 85 % d’ici 2036. Il continue de travailler avec tous les intervenants de l’industrie pour s’assurer de respecter ses obligations internationales d’élimination progressive des HFC et de protection de notre environnement.
Fournir des informations pour soutenir la prise de décision et la responsabilité
ECCC a maintenu son engagement à moderniser ses services numériques pour améliorer l’accès à des données et à des renseignements scientifiques fondamentaux sur le climat qui font autorité. Grâce à cette modernisation, les travaux de ses scientifiques pourront mieux orienter et soutenir les priorités des programmes sur la croissance propre et les changements climatiques.
Le Ministère a également continué de travailler avec des partenaires et des experts pour élaborer et publier les meilleurs renseignements et données scientifiques disponibles afin de mettre à la disposition du public l’information la plus récente sur les émissions de GES et les polluants atmosphériques. ECCC a publié cette information dans les inventaires et les rapports annuels suivants :
- Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada
- Aperçu des émissions déclarées : Programme de déclaration des gaz à effet de serre par les installations
- Inventaire des émissions de polluants atmosphériques du Canada
- Inventaire des émissions de carbone noir du Canada
En 2023-2024, ECCC a maintenu, mis à jour et élargi le modèle d’analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles du gouvernement du Canada, qui est accessible au public, afin d’appuyer de multiples initiatives gouvernementales. Le modèle d’ACV des combustibles est un outil qui permet de calculer l’intensité en carbone du cycle de vie des sources d’énergie et des combustibles utilisés et produits au Canada. Le Règlement sur les combustibles propres est le premier règlement à l’employer pour déterminer l’intensité en carbone de combustibles et de sources d’énergie aux fins de la création de crédits, et d’autres programmes gouvernementaux envisagent d’y recourir. Le modèle d’ACV des combustibles est conçu pour :
- fournir des calculs transparents et traçables de l’intensité en carbone;
- représenter les voies de production de combustibles au Canada en s’appuyant sur des données canadiennes et mondiales, selon le cas;
- être robuste par le respect des lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation, en particulier les normes 14040 et 14044;
- être utilisé pour orienter et appuyer l’élaboration de plusieurs politiques et programmes visant les GES du gouvernement du Canada.
ECCC a continué d’appliquer l’Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) dans les évaluations d’impact fédérales. L’ESCC fournit des conseils sur la façon dont les changements climatiques devraient être pris en compte dans les évaluations d’impact afin d’assurer une plus grande transparence, une plus grande clarté, une plus grande cohérence et une meilleure certitude des processus. Elle décrit les processus que les promoteurs de projets peuvent suivre pour atténuer les émissions de GES grâce à l’utilisation des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales, et pour élaborer des plans crédibles de carboneutralité d’ici 2050. Conformément aux principes de l’ESCC, ECCC a fourni des conseils sur la caractérisation des effets des projets évalués en 2023-2024 et l’efficacité des mesures d’atténuation envisagées aux promoteurs de projets et à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.
Le Ministère a continué de mettre en œuvre le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) pour appuyer l’action climatique partout au Canada. ECCC a mis en œuvre le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone en 2023-2024 en travaillant avec les provinces et les territoires et en leur offrant des fonds pour les aider à respecter leurs engagements à réduire la pollution par le carbone et à contribuer à l’atteinte ou au dépassement de la cible climatique du Canada pour 2030. Le Ministère a également continué d’administrer le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, qui appuie des projets devant entraîner une croissance propre, réduire les émissions de GES et aider à respecter les engagements pris par le Canada dans l’Accord de Paris.
Le Plan de réduction des émissions pour 2030 prévoit une recapitalisation du FEFEC, à compter de 2023-2024, qui comprend un nouveau Fonds de leadership autochtone de 180 millions de dollars et un Fonds de préparation à la mise en œuvre. Étant donné cette recapitalisation, le Ministère a collaboré avec les provinces et les territoires dans le cadre du Fonds de leadership pour lancer une nouvelle période d’acceptation de demandes de financement fondée sur le mérite en 2023-2024. Celle-ci appuie des projets contribuant à la réalisation des objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050.
ECCC a continué d’utiliser l’enveloppe du Fonds pour dommages à l’environnement, approvisionnée par des amendes, des pénalités, des ordonnances de tribunaux et des paiements volontaires pour les infractions environnementales, afin d’administrer le Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat (FASC). Établi en 2020, le FASC est une initiative de financement qui investira jusqu’à 206 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets canadiens aidant à réduire les émissions de GES du Canada et à bâtir une économie carboneutre durable d’ici 2050. En 2023-2024, le FASC a appuyé trois priorités : 1) accroître la sensibilisation des jeunes aux questions climatiques et l’action communautaire pour le climat; 2) faire progresser les sciences et les technologies climatiques; et 3) soutenir la recherche sur le climat dans les groupes de réflexion et les établissements d’enseignement canadiens.
Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat
Pour appuyer ses priorités, le FASC a lancé de nombreux appels de propositions, qui visaient notamment :
- la sensibilisation des jeunes aux questions climatiques (été 2020);
- l’action communautaire pour le climat (automne 2020 et hiver 2022);
- la recherche sur le climat dans les groupes de réflexion et les établissements d’enseignement canadiens (été 2022);
- les sciences et les technologies liées aux changements climatiques (printemps 2021).
En 2023-2024, ECCC a continué de mobiliser les Canadiens pour mieux communiquer les répercussions des changements climatiques. Le Ministère s’est fondé sur les dernières recherches sur le comportement pour orienter une approche à plusieurs volets permettant de mieux sensibiliser les Canadiens. ECCC a notamment mené des campagnes de publicité ciblée et de marketing dans les médias sociaux, ainsi qu’élaboré un document de travail en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations non gouvernementales de l’environnement afin d’orienter la conception d’un cadre national axé sur l’apprentissage environnemental. Le Ministère s’est engagé à verser 12,5 millions de dollars en financement dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec des organismes philanthropiques pour appuyer l’élaboration de projets de conscience de l’environnement partout au Canada. Ces projets aideront à donner aux jeunes Canadiens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour comprendre les changements climatiques et composer avec cette réalité.
En s’appuyant sur une phase pilote et en collaborant avec les organismes centraux et les ministères clés, ECCC a continué d’élaborer et de mettre en œuvre une optique climatique pour faciliter l’intégration des considérations liées à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci dans le processus décisionnel du gouvernement. Le Ministère a élaboré la nouvelle Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique et en a demandé l’approbation. Cette directive exige l’application d’un nouvel outil d’évaluation, l’Optique de climat, de nature et d’économie, dans l’élaboration de politiques, de programmes et de règlements. Cette approche met l’accent sur la réduction des GES, l’adaptation aux changements climatiques, la protection de la biodiversité et l’appui à la croissance économique.
La conservation pour faire face aux changements climatiques
Pour lutter contre les changements climatiques, le Ministère a continué d’utiliser des solutions axées sur la nature, notamment la conservation des terres, qui réduiront les émissions de GES de cinq à sept mégatonnes par année en 2030. Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont souvent considérés comme une double crise contre laquelle des solutions intégrées et complémentaires sont à la fois cruciales et urgentes. Le Canada a un rôle à jouer dans l’élaboration et la mise en œuvre de telles solutions, en partie parce que ses vastes paysages de forêts, de terres humides, de tourbières et d’autres écosystèmes riches en carbone constituent l’un des plus grands réservoirs de carbone au monde. Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver 25 % des terres et des océans du pays d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030.
En assurant la conservation et le rétablissement de ses écosystèmes riches en carbone, tels que les terres humides, ainsi qu’en améliorant les pratiques de gestion qui y sont appliquées, le Canada luttera contre les changements climatiques en réduisant les émissions nettes de GES tout en procurant des avantages pour la biodiversité, comme un habitat, ainsi que pour la santé et le bien-être de la population dans tout le pays. ECCC a continué de travailler avec les partenaires fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les organismes de conservation, le secteur privé et la société civile pour mettre en œuvre de nouveaux investissements dans le cadre du Fonds pour des solutions climatiques naturelles, notamment :
- 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour planter deux milliards d’arbres (sous la direction de Ressources naturelles Canada);
- 1,41 milliard de dollars sur 10 ans pour réduire les émissions de GES grâce à la protection, à l’amélioration de la gestion et au rétablissement des terres humides, des tourbières, des prairies et des forêts par l’intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature;
- 885 millions de dollars sur 10 ans pour établir un nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada).
Le Plan de réduction des émissions intègre des solutions climatiques axées sur la nature et complète les efforts internationaux du Canada, notamment dans les pays en développement où le Canada s’est engagé à octroyer au moins 20 % de son financement international pour le climat à des solutions climatiques axées sur la nature offrant des avantages pour la biodiversité.
Les communautés, les économies et les écosystèmes canadiens sont plus résilients
Améliorer les services climatiques pour renforcer la résilience aux changements climatiques
En 2023-2024, ECCC a fourni aux Canadiens des données et des renseignements climatiques faisant autorité par l’intermédiaire du Centre canadien des services climatiques (CCSC). Le CCSC a continué de travailler avec des partenaires et des intervenants pour aider les Canadiens à accroître leur résilience aux changements climatiques grâce à de l’information, à des formations, à des lignes directrices et à des ressources qui appuient les décisions éclairées en matière de climat. Le Ministère a continué d’élargir le réseau national d’organismes régionaux de services climatiques pour accroître la capacité locale, notamment par un nouveau projet pilote d’offre de services climatiques régionaux en Ontario. ECCC a également élaboré un modèle de prestation de services dans le Nord et commencé à travailler avec le Climate Risk Institute afin de dresser des profils de données climatiques pour les collectivités nordiques.
Le CCSC, en collaboration avec ses partenaires, a publié de nouveaux renseignements et activé de nouvelles fonctions sur DonneesClimatiques.ca. Parmi les nouveaux ajouts, mentionnons les projections de l’humidex, les projections des zones climatiques des bâtiments, l’outil des analogues spatiaux canadiens et une série pilote de balados visant à faciliter l’acquisition de connaissances sur les données climatiques. Le taux de consultation de DonneesClimatiques.ca a augmenté de 20 % par rapport à l’exercice précédent, et neuf nouveaux exemples ont été ajoutés à la carte des actions en adaptation. De plus, le CCSC a offert des séances de formation sur mesure, comme un cours d’introduction à l’utilisation des données climatiques pour les fonctionnaires fédéraux, ainsi qu’une formation ciblée pour les professionnels de l’architecture et les professionnels du secteur de la santé.
Les produits et services du CCSC ont connu leur plus haut taux d’utilisation par les publics cibles depuis la création du CCSC en 2018. Le Centre d’aide des services climatiques a répondu à 793 cas en 2023-2024, une augmentation de 10,9 % par rapport à l’exercice précédent, tout en maintenant un taux élevé de satisfaction de la clientèle.
Le Canada se réchauffe rapidement
Le Canada se réchauffe à un taux correspondant au double du taux mondial moyen, et le Nord, au triple de ce taux. Cette situation augmente la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur, des sécheresses et des feux de forêt, et contribue au dégel du pergélisol et à l’élévation du niveau de la mer. Afin de relever ce défi croissant, ECCC travaille avec des partenaires pour améliorer les mesures d’adaptation aux changements climatiques.
La Stratégie nationale d’adaptation du Canada, publiée par ECCC en juin 2023, reflète deux années de collaboration avec : les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales; les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis; les experts et intervenants clés; et les Canadiens. Une telle ampleur de mobilisation a permis au Canada de rassembler, pour la première fois, les objectifs et les priorités d’adaptation en un seul cadre, unissant ainsi de nombreuses autres administrations nationales et infranationales. La Stratégie aide à orienter les efforts de tous les secteurs de la société en matière d’adaptation et s’appuie sur un ensemble de principes directeurs visant à garantir que les investissements et les solutions sont justes, inclusifs et équitables. Des plans d’action bilatéraux décrits dans la SNA ont été lancés avec les provinces et les territoires, et les occasions d’inclure les groupes autochtones dès le départ ont été saisies. Toutes les provinces et tous les territoires ont été contactés pour amorcer la coordination de l’adaptation, et les gouvernements du Québec, de la Colombie-Britannique et des trois territoires se sont tous engagés à commencer la planification conjointe de l’adaptation en 2023-2024.
Adaptation aux risques et aux défis liés aux changements climatiques
La préparation aux changements climatiques comprend des mesures comme l’interdiction de la construction d’habitations dans les plaines inondables, l’augmentation du couvert forestier dans les forêts urbaines pour réduire les effets des vagues de chaleur, et l’utilisation de données pour cartographier et gérer les risques de feux de forêt et d’inondations.
Le PAAGC complète les efforts d’adaptation des provinces, des territoires et des partenaires autochtones et comprend plus de 70 mesures nouvelles et en cours pour faire progresser les domaines prioritaires de la SNA. Résultant d’une collaboration entre ECCC et la Fédération canadienne des municipalités en 2023-2024, un total de 530 millions de dollars sera disponible en 2024-2025 afin que le Fonds municipal vert étendre ses services pour soutenir les initiatives d’adaptation communautaires. Le Ministère a également continué d’élaborer une nouvelle évaluation pancanadienne de la science du climat afin de fournir aux Canadiens des connaissances et des données faisant autorité à l’appui des efforts d’adaptation.
Le Ministère a soutenu la coopération nationale sur l’adaptation aux changements climatiques. ECCC s’est associé à Ouranos, un consortium sur le climat, pour planifier la septième série de conférences internationales Adaptation Futures sur l’adaptation mondiale, qui a eu lieu à Montréal en 2023. Le Ministère a continué de collaborer avec les provinces et les territoires par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, ainsi qu’avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse au moyen de trois tables bilatérales de haut niveau fondées sur les distinctions, afin de mettre en commun les connaissances et les pratiques exemplaires pour faire progresser les efforts d’adaptation dans l’ensemble des provinces et des territoires.
Le Canada contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la résilience mondiale aux changements climatiques
Le Canada sur la scène climatique mondiale
En 2023-2024, ECCC a continué de diriger l’engagement du Canada relatif aux changements climatiques et à l’environnement dans divers forums multilatéraux, tels que le G7, le G20, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA), entre autres, contribuant ainsi à faire progresser la réalisation des objectifs ambitieux de l’Accord de Paris. Le Canada a participé à la 28e Conférence des Parties (CdP28) à la CCNUCC en novembre et décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Lors de cet événement, ECCC a pris part au premier bilan mondial de l’Accord de Paris, qui a donné lieu à des appels inédits à tripler les énergies renouvelables et à doubler l’efficacité énergétique, et témoigné d’un consensus historique de près de 200 pays à remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. En collaboration avec d’autres ministères, ECCC a veillé à ce que toutes les Parties prennent des mesures ambitieuses régies par un cadre commun qui reflète les normes les plus élevées de transparence et d’intégrité scientifique. Le Canada a également fait preuve de leadership pour garder le rythme en ce qui a trait à l’élimination progressive des subventions inefficaces aux combustibles fossiles et l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de charbon sans mesures de dépollution afin d’aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques, et pour reconnaître que les mesures prises pour le climat et la biodiversité se renforcent mutuellement.
Lors de la réunion des ministres responsables du climat, de l’énergie et de l’environnement du G7 en avril 2024, le Canada a travaillé avec des partenaires pour concrétiser les engagements de la CdP28 et susciter une action climatique mondiale ambitieuse, notamment en convenant d’un calendrier du G7 pour l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de charbon sans mesures de dépollution dans la première moitié des années 2030. Le Canada s’est également engagé à contribuer aux efforts mondiaux visant à accélérer la réduction des émissions mondiales de méthane et à accroître la capacité mondiale de stockage d’énergie. Les ministres du G7 ont également envoyé un signal fort de soutien à l’établissement d’un nouvel objectif mondial de financement climatique pendant la CdP29 en novembre 2024. De plus, lors de la quatrième réunion des dirigeants du Forum des grandes puissances économiques sur l’énergie et le climat en avril 2023, le Canada a soutenu les efforts collectifs visant à garder atteignable l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, et annoncé qu’il participerait au sprint pour le financement de la lutte contre le méthane avant la CdP28 afin d’aider les pays en développement à lutter contre ce puissant GES.
Les travaux internationaux d’ECCC consistent également à mobiliser les provinces et les territoires, les peuples autochtones et les intervenants clés, notamment les jeunes, la société civile, l’industrie et les syndicats, au sujet de l’élaboration de politiques climatiques internationales et de la promotion de l’égalité des genres et du rôle des femmes et des personnes de diverses identités de genre dans l’action climatique à travers le monde.
Le Ministère a continué d’appuyer les efforts d’adaptation et d’atténuation des pays en développement, y compris les petits États insulaires et les pays les moins avancés, qui sont particulièrement vulnérables et exposés aux urgences liées au climat. ECCC gère l’engagement du Canada à verser 5,3 milliards de dollars en financement climatique en collaboration avec Affaires mondiales Canada. Cet engagement, qui s’étend de 2021 à 2026, soutient les pays en développement dans leur transition vers un développement durable inclusif, à faibles émissions de carbone, résilient aux changements climatiques et respectueux de la nature. ECCC et Affaires mondiales Canada coprésident des comités de gouvernance interministériels afin d’assurer une approche pangouvernementale efficace pour la mise en œuvre de l’engagement du Canada en matière de financement climatique. En 2023-2024, ECCC a continué de diriger la mise en œuvre, par des voies bilatérales et multilatérales, d’un financement climatique d’environ 160 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l’action climatique dans les pays en développement. Il a annoncé un financement supplémentaire de 250 000 dollars pour le Climate Finance Access Network [disponible seulement en Anglais], qui s’ajoute à son engagement précédent de 5 millions de dollars en 2022 et à l’engagement initial de 9,5 millions de dollars d’Affaires mondiales Canada en 2020. Le Climate Finance Access Network soutient la capacité des pays en développement à obtenir des fonds publics et privés pour faire des investissements prioritaires dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques sur leurs territoires.
ECCC a continué de faire progresser l’action climatique internationale, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation, grâce à sa participation à des initiatives multilatérales ciblées. Le Ministère a notamment pris part au Groupe des champions du financement de l’adaptation, un groupe international auquel le Canada s’est joint en 2022. Le Canada travaille de concert avec d’autres membres pour accélérer le financement de l’adaptation et améliorer sa qualité et son accessibilité, en particulier pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. En 2023-2024, le Canada a annoncé qu’il verserait cinq millions de dollars sur trois ans en financement climatique international à l’Initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficaces. Cette mesure fait suite à l’annonce qu’il avait faite en 2022 concernant son adhésion au Pacte de partenariat pour la vision 2050 des pays les moins avancés, à l’appui de l’Initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficaces.
Le Ministère a également poursuivi les partenariats internationaux, les initiatives et la coopération bilatérale pour faire progresser la croissance propre et l’action climatique. ECCC a continué de représenter le Canada en tant que coprésident de l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon avec le Royaume-Uni, la première et la seule initiative au monde à être dirigée par des gouvernements et à avoir comme objectif d’accélérer l’élimination progressive mondiale des émissions provenant de l’énergie produite à partir de charbon. Le Ministère a appuyé les initiatives gouvernementales visant à accélérer la réalisation de l’engagement pris par le Canada au G20 d’éliminer les subventions aux combustibles fossiles d’ici 2023. Le pays est ainsi le premier du G20 à supprimer progressivement ces subventions avant l’échéance de 2025. En 2023, ECCC a publié les documents Subventions inefficaces aux combustibles fossiles – Cadre d’évaluation pour auto-examen par le gouvernement du Canada et Subventions inefficaces pour les combustibles fossiles – Lignes directrices du gouvernement du Canada, qui ont été élaborés en collaboration avec le ministère des Finances Canada.
Dans le cadre du Défi mondial sur la tarification du carbone, ECCC a travaillé avec des partenaires internationaux pour accroître la part des émissions mondiales de GES qui sont assujetties à la tarification du carbone. En 2023-2024, Le Ministère a facilité l’établissement du Secrétariat du Défi et préparé des ateliers techniques et des échanges de pays à pays pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de tarification du carbone. ECCC a dirigé l’organisation d’un événement de haut niveau en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, réunissant des partenaires internationaux pour affirmer leur engagement envers la tarification du carbone, et a accueilli trois nouveaux membres : la Norvège, le Danemark et la Côte d’Ivoire. La Suède et l’Union européenne se sont également jointes au Défi avant la CdP28, durant laquelle le Canada a dirigé une discussion ministérielle et une table ronde technique.
En 2023-2024, ECCC a pris des mesures pour promouvoir les objectifs portant sur la croissance propre et les changements climatiques au moyen de dispositions environnementales ambitieuses, exhaustives et exécutoires dans ses accords de libre-échange (ALE). Ses travaux dans ce domaine comprennent la négociation d’obligations visant à maintenir une gouvernance environnementale solide alors que le commerce et l’investissement se libéralisent, et des engagements à coopérer à propos d’un éventail de questions environnementales mondiales, notamment la conservation de la biodiversité, la réduction de la pollution, les changements climatiques et les technologies propres. En avril 2023, le Canada a conclu les négociations de l’ALE modernisé avec l’Ukraine, qui comprend un chapitre complet sur l’environnement et des dispositions reconnaissant l’importance des politiques sur les changements climatiques. Le Canada a continué de chercher à inclure des dispositions environnementales dans ses négociations d’ALE avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et l’Indonésie, ainsi que dans les discussions exploratoires avec l’Équateur.
Le Ministère a également fait progresser l’action climatique grâce à des discussions et à des accords internationaux hors du contexte des ALE. Par exemple, le Canada et les États-Unis ont publié l’engagement renouvelé du Canada et des États-Unis en matière d’ambition pour le climat et la nature, qui porte sur l’accélération des efforts communs de lutte contre la crise climatique et l’accroissement des bénéfices économiques grâce à la collaboration bilatérale. Le Canada a également négocié et signé un protocole d’entente avec la République de Corée concernant la coopération en matière de changements climatiques, pris des mesures pour approfondir la collaboration avec l’Union européenne par l’Alliance verte Canada-Union européenne, et été l’hôte de la session annuelle du Conseil de la Commission de coopération environnementale, laquelle a réuni les États-Unis et le Mexique pour faire progresser les initiatives sur l’adaptation aux changements climatiques, les polluants climatiques de courte durée de vie et la justice environnementale.
Les peuples autochtones participent à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques
Mobilisation des Autochtones
La mobilisation des peuples autochtones fait partie intégrante de l’approche d’ECCC pour s’acquitter de toutes ses responsabilités essentielles, y compris la croissance propre et les changements climatiques. Des exemples des efforts déployés par le Ministère pour faire participer de façon significative les peuples autochtones à la résolution des défis liés aux changements climatiques sont imbriqués dans la majeure partie du texte plus haut. En voici quelques-uns :
- Appuyer l’élaboration de programmes de leadership autochtone en matière de climat fondés sur les distinctions pour transformer les partenariats sur les changements climatiques du gouvernement fédéral avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
- Convoquer des réunions régulières de tables bilatérales de haut niveau sur la croissance propre et les changements climatiques fondées sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
- Soutenir les projets d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone détenus et dirigés par des Autochtones au moyen du Fonds de leadership autochtone, un volet du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.
- Appuyer la représentation des Autochtones dans les délégations et les forums internationaux, comme la 28eConférence des Parties (CdP28) à la CCNUCC, la 15e Conférence des Parties (CdP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
- Intégrer les connaissances et les renseignements des Autochtones à la science occidentale afin d’améliorer le Programme de surveillance de l’environnement visant des sables bitumineux.
- Renforcer les capacités et mener des activités sur le terrain au sujet de la restauration écologique, de la gestion des terres et de la conservation grâce à des investissements dans le volet Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones.
- Collaborer avec les peuples autochtones à l’élaboration de protocoles fédéraux de crédits compensatoires dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada et renforcer la capacité des peuples autochtones à participer aux projets de crédits compensatoires pour les GES.
Il est important de noter que les efforts déployés par le Ministère pour mobiliser de façon significative les peuples autochtones sont également intégrés à l’exécution de tous ses programmes. À ce titre, d’autres efforts notables sont mentionnés tout au long du présent rapport.
Principaux risques
La capacité du Ministère d’obtenir, pour les Canadiens, des résultats en matière de croissance propre et de changements climatiques exige une vaste collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones et internationaux, ainsi qu’avec les secteurs privés et sans but lucratif et la société civile. Cette collaboration vise à assurer l’harmonisation et une coopération efficace. Elle peut être compliquée par des divergences de politiques ou d’orientation, des priorités concurrentes et des contraintes en matière de ressources.
Le Ministère a continué d’améliorer ses relations stratégiques en travaillant à soutenir la mobilisation axée sur les questions régionales ainsi que la centralisation des politiques, de l’orientation et des conseils intraministériels, notamment en participant à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation coordonnée à l’échelle du gouvernement. ECCC a eu recours à un mélange d’approches virtuelles et en personne pour faciliter la coopération bilatérale et multilatérale, et continué d’encourager le leadership international et de faire progresser les engagements.
Comme les répercussions des changements climatiques ont continué de menacer les collectivités au cours de l’exercice, il était de plus en plus essentiel de travailler avec les peuples autochtones et de les soutenir pour renforcer la résilience dans le Nord grâce à des activités de surveillance et d’atténuation des changements climatiques ainsi que d’adaptation à ceux-ci. Afin de réduire les risques possibles liés à l’établissement et au maintien de relations de qualité avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le Ministère a continué de mettre en œuvre un cadre ministériel de mobilisation des Autochtones, a examiné et renforcé sa gouvernance interne des relations avec les Autochtones, et a mis en œuvre des outils et des processus pour appuyer l’inclusion des perspectives autochtones dans l’élaboration de ses politiques, de ses programmes et de ses lois.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 2 : Aperçu des ressources requises pour Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques
Le tableau 2 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.
| Ressources | Prévues | Réelles |
|---|---|---|
| Dépenses | 876 753 252 $ | 570 748 742 $ |
| Équivalents temps plein | 906 | 1 056 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Priorités pangouvernementales connexes
Analyse comparative entre les sexes Plus
C’est un fait bien reconnu que les changements climatiques au Canada exacerbent les défis posés aux peuples autochtones du pays ainsi que les facteurs de stress pour la santé exercés sur eux. Les changements climatiques ont également des répercussions disproportionnées sur les collectivités nordiques, rurales, éloignées et côtières, les communautés racisées, les générations plus jeunes et plus âgées, les personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap, les groupes à faible revenu, les femmes et les personnes se trouvant à l’intersection de ces identités. ECCC a continué d’examiner les répercussions de ses politiques et programmes de lutte contre les changements climatiques afin d’éviter, autant que possible, que ces populations subissent d’autres répercussions négatives. Le Ministère a continué d’analyser plus en profondeur chaque politique et programme à l’aide de l’Analyse comparative entre les sexes (ACS) Plus afin de maximiser les avantages positifs pour les personnes les plus touchées par les effets négatifs des changements climatiques.
Reconnaissant les effets étendus et souvent disproportionnés des changements climatiques qui exacerbent les inégalités existantes et aggravent les risques au sein des populations déjà touchées, ECCC a collaboré avec un large éventail de partenaires, y compris le Conseil des jeunes sur l’environnement et les changements climatiques, pour orienter l’élaboration de la Stratégie nationale d’adaptation. La Stratégie établit le respect des droits des Autochtones et la promotion de l’équité et de la justice environnementale comme deux de ses principes directeurs afin de favoriser des mesures et des processus d’adaptation qui incluent tous les Canadiens. ECCC a poursuivi sa mobilisation continue des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis par l’intermédiaire de tables bilatérales de haut niveau afin d’appuyer l’autodétermination et de permettre la réalisation de solutions climatiques dirigées par les Autochtones. Sur la scène internationale, les considérations relatives à l’ACS Plus ont été prises en compte dans les activités bilatérales et régionales de coopération environnementale menées avec les partenaires internationaux. De plus, des membres du Conseil des jeunes sur l’environnement et les changements climatiques ont participé à des conférences des Nations Unies au sein de la délégation canadienne afin de promouvoir les voix des jeunes. Le Canada a également continué de contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des sexes, qui a été adopté dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Plan vise à accroître la participation et le leadership des femmes dans l’action climatique et à améliorer l’intégration des considérations de genre dans les politiques et les plans nationaux sur le climat. Conformément à la Politique d’aide internationale féministe du Canada, 80 % des projets réalisés dans le cadre de l’engagement du Canada à verser 5,3 milliards de dollars en financement climatique visent à intégrer les considérations d’égalité des genres, une cible que le Canada est en voie d’atteindre.
De plus, afin d’appuyer les engagements du gouvernement du Canada à faire progresser le leadership autochtone en matière de climat et à harmoniser les politiques et les programmes fédéraux aux priorités climatiques des peuples autochtones, ECCC fournit des outils et des ressources pour aider les collectivités et les organisations à s’y retrouver dans les exigences du Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada. Le Ministère a publié une boîte à outils sur son site Web, offerte en ojibwé, en mi’kmaq et en cri des bois. De plus, tout au long de 2023-2024, ECCC a tenu des séances d’information et des ateliers virtuels et en personne sur les marchés du carbone et les projets de crédits compensatoires pour les GES à l’intention des publics autochtones.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et Objectifs de développement durable des Nations Unies
Plus de renseignements sur l’apport d’ECCC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable.
Innovation
Transition dans le chauffage domestique
Une étude a été réalisée en partenariat avec un grand service public urbain pour tester l’efficacité relative de messages sur les avantages des thermopompes à encourager l’adoption de ces appareils. En envoyant aux consommateurs des courriels décrivant les avantages des thermopompes de différentes manières pour stimuler divers facteurs de motivation de l’adoption, les chercheurs ont constaté que les messages sur la double fonction (chauffage et refroidissement) des thermopompes et les normes sociales (« les thermopompes sont de plus en plus populaires ») avaient le plus incité les destinataires à faire un suivi pour obtenir de l’information supplémentaire. L’étude se poursuit jusqu’en novembre 2024, et les constats ont déjà été communiqués à plus de 50 représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, du gouvernement du Royaume-Uni et d’autres intervenants au moyen d’une série de webinaires virtuels.
Planifier pour atteindre la carboneutralité
Une étude sur le programme du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d’ECCC a montré que la simplification du processus de demande et l’augmentation de la transparence des exigences du programme pourraient permettre aux demandeurs de mieux déterminer leur admissibilité et de soumettre des demandes plus concurrentielles. Les constatations et les recommandations fondées sur des données probantes ont permis d’améliorer les communications avec les demandeurs éventuels et ont été appliquées de façon plus générale à d’autres programmes ministériels, comme le Programme d’incitation à la décarbonisation.
Répertoire des programmes
La responsabilité essentielle Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques est appuyée des programmes suivants :
- Croissance propre et atténuation des changements climatiques
- Adaptation aux changements climatiques
- Action internationale sur l’environnement et le climat
Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.
Prévention et gestion de la pollution
Description
Élaborer des mesures visant à réduire les rejets de substances nocives dans l’environnement; surveiller les niveaux de polluants et de précurseurs de la pollution dans l’air, l’eau et le sol; promouvoir les lois et les règlements environnementaux et veiller à leur application; et mettre en œuvre des mesures et des programmes de réduction de la pollution et de restauration. Pour y parvenir, il faudra coordonner, collaborer et consulter les autres ministères du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les organisations non gouvernementales, les partenaires internationaux et les autres intervenants.
Progrès à l’égard des résultats
Cette section présente les mesures prises par le ministère pour atteindre les résultats et les cibles relativement à Prévention et gestion de la pollution. Les renseignements sont présentés par résultat ministériel.
Tableau 3 : Cibles et résultats relativement à Prévention et gestion de la pollution
Le tableau 3 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé aux résultats liés à Prévention et gestion de la pollution.
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage de la population vivant dans des zones où les concentrations de polluants atmosphériques sont inférieures ou égales aux Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant. | 85 % | Décembre 2030 | 2021-2022 : 71 %Note de bas de page 33 2022-2023 : 64 %Note de bas de page 34 2023-2024 : 85 %Note de bas de page 35 |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage des systèmes de traitement d’eaux usées où les normes de qualité des effluents sont atteintes | 100 % | Décembre 2040 | 2021-2022 : 77 % 2022-2023 : 77 % 2023-2024 : Résultat non disponibleNote de bas de page 36 |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage de mesures prises en temps opportun afin de protéger l’environnement du Canada contre les substances chimiques présentant un risque pour l’environnement | 100 % | Mars 2024 | 2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2022-2023. La première année de déclaration sera pour 2022-2023. 2022-2023 : 93 % 2023-2024 : 86 % |
Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC.
Renseignements sur les résultats
La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à Prévention et gestion de la pollution en 2023‑2024 en les comparant aux résultats prévus dans le Plan ministériel d’ECCC pour l’exercice.
L’environnement canadien est protégé des substances nocives
Élimination des déchets plastiques
ECCC a continué de diriger le programme global du gouvernement du Canada visant à atteindre l’objectif de zéro déchet de plastique et à passer à une économie circulaire des plastiques. Ses travaux vont de la réalisation et du soutien d’activités de recherche et de surveillance sur les sources et les effets de la pollution par le plastique à la collecte de données sur les plastiques qui circulent dans l’économie canadienne, et à l’appui des mesures à prendre en amont pour prévenir les déchets de plastique par la réutilisation. ECCC continue d’assurer l’accès du public aux résultats, aux données et aux connaissances sur les plastiques dans l’environnement et l’économie, comme en témoignent les progrès importants réalisés dans l’élaboration d’un registre fédéral sur les plastiques. En 2023-2024, le Ministère a tenu des consultations publiques pour orienter la formulation d’un avis de collecte de renseignements en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cet avis obligera les producteurs de plastique et d’autres entreprises de la chaîne de valeur des plastiques à aider à surveiller et à suivre le plastique du moment de sa production jusqu’à la fin de sa vie.
En juin 2023, des interdictions relatives à la fabrication et à l’importation pour la vente au Canada des anneaux pour emballage de boissons en plastique à usage unique sont entrées en vigueur en vertu du Règlement interdisant les plastiques à usage unique. Elles ont été suivies par des interdictions de la fabrication et de la vente de sacs d’emplettes, d’ustensiles, de récipients alimentaires, de bâtonnets à mélanger et de pailles, qui sont entrées en vigueur en décembre 2023.
Les consultations sur les obstacles à une économie circulaire des plastiques ont mis en évidence la nécessité d’une gamme de solutions stratégiques. Il faudra notamment améliorer la précision de l’étiquetage de la recyclabilité et de la compostabilité sur les emballages en plastique, accroître l’utilisation de plastique recyclé dans les nouveaux produits et emballages, et encourager des pratiques commerciales plus circulaires pour les emballages alimentaires. Par ailleurs, le Ministère a continué de travailler avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre le Plan d’action pancanadien visant l’atteinte de zéro déchet de plastique, qui comprend des projets d’examen des options permettant de mieux gérer les engins de pêche et d’aquaculture en fin de vie, et pour élaborer des lignes directrices menant à une réduction du plastique dans la transformation des aliments, le traitement des déchets organiques et les biosolides d’égouts.
ECCC a continué de travailler avec des partenaires et d’investir dans des organisations pour soutenir l’innovation et la transformation du marché dans des secteurs clés, y compris ceux des textiles et des aliments et boissons. Ces efforts visent à réduire les plastiques inutiles ou problématiques, à faciliter l’adoption de solutions de réutilisation et à améliorer les taux nationaux de collecte et de recyclage des déchets plastiques provenant de l’industrie et des opérations fédérales.
En 2023-2024, dans le cadre des Défis canadiens d’innovation sur les plastiques, ECCC a appuyé l’achèvement de trois subventions de phase 1 (validations de principe) pour des projets visant à atténuer les rejets de microplastiques liés à l’usure des pneus. Le Ministère a également lancé deux nouveaux défis en septembre 2023 et accordé neuf subventions de phase 1 pour des projets visant à remplacer les plastiques à usage unique et à améliorer la collecte ou le tri des pellicules de plastique et des emballages souples. Les projets financés comprennent le développement d’un système hyperspectral à intelligence artificielle pour trier les pellicules de plastique et les emballages souples, une solution automatisée réutilisable pour remplacer la pellicule de plastique industrielle à usage unique utilisée pour l’expédition de palettes, et une récupératrice modulaire pour la collecte de produits réutilisables.
Le Canada demeure un membre actif de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique et est déterminé à travailler avec les pays et les intervenants pour élaborer un instrument international ambitieux, efficace et juridiquement contraignant sur la pollution par le plastique.
Mise en œuvre de la LCPE
ECCC a poursuivi la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) renforcée. Déposé en février 2022, le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, a reçu la sanction royale le 13 juin 2023. Le projet de loi modernise la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), constitue le premier ensemble de modifications exhaustives apportées à cette loi depuis son adoption il y a plus de 20 ans, et reconnaît pour la première fois dans une loi fédérale que chaque personne au Canada a droit à un environnement sain. Les modifications de la LCPE ont également renforcé le régime de gestion des produits chimiques du Canada tout en augmentant la transparence de son administration.
La consultation publique sur l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain en vertu de la LCPE a commencé le 8 février 2024. Ce travail se déroule parallèlement aux efforts supplémentaires déployés par le gouvernement fédéral pour mobiliser les Canadiens sur les questions de justice environnementale et de racisme environnemental, lesquels se rapportent au fait que certaines collectivités font face à des risques environnementaux et sanitaires disproportionnés.
Les commentaires reçus orienteront l’élaboration et la mise en œuvre du cadre et fourniront un contexte pour l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer, à prévenir et à combattre le racisme environnemental et à faire progresser la justice environnementale. Les résultats de la consultation sur le cadre de mise en œuvre seront publiés d’ici juin 2025. Le public est invité à consulter la plateforme en ligne Promouvoir l’équité environnementale pour en apprendre davantage et participer à ces initiatives.
S’attaquer aux produits chimiques qui nuisent aux Canadiens et à l’environnement
Pour protéger l’environnement et les Canadiens contre les substances nocives, ECCC a continué de mettre en œuvre le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada en collaboration avec Santé Canada. En date du 31 mars 2024, les deux ministères avaient traité 4 326 (99 %) des 4 363 produits chimiques jugés prioritaires en 2006. Le reste de ces produits devrait être traité d’ici le 31 mars 2025. Le rythme et le volume de ce travail d’évaluation des risques ont été considérés comme une réalisation remarquable dans une évaluation récente du PGPC, en particulier par rapport à d’autres organismes œuvrant à réglementer les produits chimiques partout dans le monde. Depuis le lancement du PGPC en 2006, les mesures de gestion des risques pour les substances toxiques ont plus que doublé, passant d’environ 200 en 2006 à plus de 400 en 2024.
Dans le cadre du PGPC, ECCC a également entrepris de nombreuses autres activités et initiatives, notamment :
- des activités de suivi et de surveillance de l’air, des oiseaux, des poissons, de l’eau, des sédiments, des eaux usées et des biosolides à l’appui des activités d’évaluation et de gestion des risques;
- plusieurs projets de recherche visant à aborder les questions du devenir chimique, de la bioaccumulation et des effets des substances d’intérêt prioritaire du PGPC, comme les produits ignifuges, les substances perfluoroalkyliques, les éléments des terres rares et les nanomatériaux;
- la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie d’évaluation de la mesure du rendement de 2020, afin de fournir aux Canadiens de l’information sur l’efficacité des mesures de gestion des risques en place pour les substances toxiques;
- des investissements dans des changements du système de soumission en ligne du Guichet unique d’ECCC pour appuyer le PGPC ainsi que simplifier et améliorer la collecte de données, la production de rapports et la diffusion d’information. Certaines populations au Canada, comme les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les communautés autochtones, sont plus vulnérables aux substances nocives, et leurs besoins continueront d’être soigneusement pris en compte dans le choix des mesures de gestion des risques.
Le Ministère a continué d’appuyer les efforts internationaux de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets en fournissant une expertise à diverses tribunes internationales telles que :
- la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
- la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international;
- la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;
- la Convention de Minamata sur le mercure.
Dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines du Canada, ECCC a continué de surveiller l’habitat de certaines baleines en voie de disparition à la recherche de contaminants qui leur sont particulièrement nocifs. Le Ministère a notamment élaboré et utilisé l’Outil d’inventaire des polluants affectant les baleines et leurs proies pour surveiller où et comment ces contaminants sont rejetés.
Le Ministère a continué de travailler avec les partenaires, les intervenants, les utilisateurs des terres et les communautés autochtones, et mené des recherches et des activités de surveillance pour éclairer la prise de décisions concernant les contaminants dans les écosystèmes canadiens et les aliments récoltés traditionnellement. ECCC a continué de surveiller les tendances des contaminants prioritaires dans les écosystèmes, y compris les environnements nordiques et arctiques, à l’appui des initiatives nationales et internationales de gestion des produits chimiques, de la salubrité et de la sécurité des aliments et du maintien des modes de vie traditionnels. Au besoin, le Ministère a pris les mesures d’application de la loi appropriées.
De plus, ECCC a collaboré avec Santé Canada pour mettre en œuvre un plan d’action exhaustif visant à protéger les Canadiens, y compris les pompiers, contre l’exposition aux produits ignifuges toxiques présents dans les produits ménagers.
ECCC a appuyé la prévention de la pollution en vertu de la Loi sur les pêches
ECCC est le ministère fédéral responsable de l’administration des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution. Ces dispositions interdisent le rejet de pollution dans les eaux où vivent des poissons, à moins qu’il soit autorisé par un règlement. En 2023-2024, le Ministère a continué d’accroître la sensibilisation à l’importance d’empêcher la pollution de pénétrer dans les cours d’eau et aux conséquences de la non-conformité aux règlements pour le secteur des pâtes et papiers, le secteur des mines de métaux et de diamants et les systèmes de traitement des eaux usées exploités par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les communautés autochtones. ECCC a également renforcé la compréhension de ces enjeux.
Le Ministère a continué ses travaux sur la modernisation du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers et l’élaboration du Règlement sur les effluents des mines de charbon, et publié des modifications proposées du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023. ECCC a poursuivi son travail avec le Groupe de travail Couronne-Autochtones (établi en 2021) afin d’explorer des options de gestion des risques liés à l’eau utilisée pour l’extraction des sables bitumineux.
Nettoyage des sites contaminés fédéraux
ECCC a continué de diriger l’approche du gouvernement à l’égard des sites contaminés fédéraux, notamment par l’administration de l’initiative horizontale du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) et la prestation d’un soutien d’expert à d’autres organisations fédérales responsables de la gestion des sites contaminés. Le Ministère, dans le cadre de son rôle de Secrétariat du PASCF, a demandé et obtenu un financement renouvelé pour le PASCF de 2025 à 2030. Ce nouveau financement contribuera à l’engagement du ministre de l’Environnement de repérer les sites contaminés dans les régions où vivent des peuples autochtones et des Canadiens racisés et à faible revenu, et d’en établir l’ordre de priorité. ECCC a également continué de collaborer avec d’autres ministères dans son rôle de Secrétariat. En 2023-2024, le Ministère a effectué 37 examens de la classification des sites pour évaluer l’admissibilité au financement, examiné 63 documents techniques d’organisations fédérales, participé à l’élaboration ou à la mise à jour de 5 documents d’orientation et tenu 4 séances de formation et 18 séances de mobilisation pour aider les organisations fédérales à gérer leurs sites contaminés. Les efforts liés à l’évaluation et à l’assainissement des sites dont le Ministère est responsable sont présentés dans la section Services internes du présent rapport.
Promouvoir l’innovation
Le Ministère a fourni un soutien financier pour promouvoir les efforts novateurs déployés par les industries, les consommateurs et les gouvernements canadiens afin de réduire la production de déchets et d’optimiser le réacheminement, la réutilisation, la récupération et l’élimination responsable des déchets domestiques et industriels.
En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, ECCC a fourni jusqu’à 1,4 million de dollars à la Redcliff Cypress Regional Waste Management Authority (Alberta) pour qu’elle poursuive ses efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone et de méthane en détournant les déchets organiques d’un site d’enfouissement avec l’aide d’une installation de traitement du compost. Dans le même ordre d’idée, PurEnergy Inc., située dans le canton de Havelock, en Ontario, a utilisé l’investissement de 10 millions de dollars pour construire une installation de réacheminement des déchets qui détourne les déchets organiques d’un site d’enfouissement et les traite par digestion anaérobie pour produire du biogaz et des engrais.
Les Canadiens ont une eau propre
Création de l’Agence de l’eau du Canada
Reconnaissant la menace que représentent les changements climatiques et la pollution pour l’eau douce, ECCC a continué de travailler à l’établissement d’une nouvelle agence de l’eau du Canada qui collaborera avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d’autres intervenants afin de trouver les meilleures façons de garder notre eau salubre, propre et bien gérée. Le Ministère a également travaillé à des investissements majeurs dans le Plan d’action sur l’eau douce renforcé, qui comprendra un engagement de 85,1 millions de dollars sur cinq ans et de 21 millions de dollars par année par la suite.
Protéger l’eau douce du Canada
ECCC a continué d’axer ses efforts sur l’amélioration, la restauration et la protection des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent, du lac Winnipeg et d’autres lacs et rivières de grande taille qui comptent parmi les ressources en eau douce les plus importantes du Canada. Ces travaux comprennent la surveillance de la qualité de l’eau et des recherches scientifiques pour déterminer l’efficacité des mesures visant à protéger ou à améliorer les écosystèmes aquatiques et pour éclairer les décisions liées à la gestion de l’eau douce dans ces plans d’eau vitaux. Le Ministère a continué de faire participer les partenaires autochtones à la conservation et à la restauration des ressources en eau douce, notamment en mettant en œuvre des ententes clés sur l’eau et en appuyant les projets dirigés par des Autochtones. ECCC a également continué d’accroître la participation du public à la conservation et à la restauration par la science citoyenne, et de financer des activités de conservation et de protection de l’eau par diverses initiatives axées sur les écosystèmes, notamment les suivantes :
- Investissement de 810 000 dollars dans sept projets dans le bassin du lac Winnipeg qui appuyaient les partenariats stratégiques et les priorités du programme que sont la réduction des nutriments, la collaboration et l’amélioration de la mobilisation des Autochtones.
- Financement totalisant 4,1 millions de dollars sur trois ans, dans le cadre de l’Initiative relative à l’écosystème d’eau douce des Grands Lacs, accordé à 25 nouveaux projets visant à faire progresser le nettoyage des zones à risque dégradées connues sous le nom de secteurs préoccupants des Grands Lacs, la prévention des algues toxiques et nuisibles et la mobilisation des peuples autochtones.
- Versement de 435 366 dollars à 12 projets dans le cadre du Programme Interactions communautaires du Plan d’action Saint-Laurent.
- Financement de 25 nouveaux projets, dans le cadre d’ÉcoAction, pour un investissement total de plus de deux millions de dollars sur trois ans.
Protéger les Grands Lacs
ECCC a continué de diriger la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) de 2012. Les mesures prises en collaboration avec d’autres ministères fédéraux, la province de l’Ontario, les organismes fédéraux et étatiques des États-Unis, les collectivités et organisations autochtones et d’autres partenaires étaient axées sur les principaux défis. Selon le Rapport sur l’état des Grands Lacs 2022, l’état général des Grands Lacs est actuellement évalué comme « passable » et la tendance est « inchangée ». Les défis actuels comprennent les effets de la pollution par les nutriments qui produit des algues toxiques et nuisibles, et les effets des espèces aquatiques envahissantes. Certaines menaces sont déjà exacerbées par les changements climatiques.
En partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, le Ministère a continué de diriger la mise en œuvre de l’Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs de 2021 (2021-2026). Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario coordonnent leurs efforts pour honorer les obligations du Canada en vertu de l’AQEGL. L’AQEGL s’attaque aux principaux défis, notamment la pollution par les nutriments et les produits chimiques (en particulier les nouveaux produits chimiques préoccupants) et la restauration des secteurs préoccupants des Grands Lacs au Canada. ECCC, en partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, a élaboré un plan de mise en œuvre interorganismes détaillé pour atteindre les cibles de réduction de la charge de phosphore établies par le Plan d’action Canada-Ontario pour le lac Érié.
Restauration du port de Hamilton
Le récif Randle, dans le port de Hamilton, sur le lac Ontario, était autrefois le plus grand site de sédiments contaminés du côté canadien des Grands Lacs. ECCC a continué de collaborer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario, Stelco, l’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, la Ville de Hamilton, la Ville de Burlington et la région de Halton pour nettoyer ce secteur préoccupant des Grands Lacs. Les travaux de dragage et de confinement des sédiments contaminés dans une installation de confinement technique à double paroi de six hectares sont à présent terminés.
L’effort de nettoyage de plus de 150 millions de dollars est financé par une approche public-privé. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario contribuent chacun au tiers du financement, le tiers restant étant financé collectivement par des partenaires locaux. La dernière étape du projet devrait être achevée en 2025. Par la suite, la responsabilité de l’installation de confinement technique sera transférée à l’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, et la collectivité bénéficiera de terrains portuaires précieux. Les travaux comprendront un plan de participation des Autochtones, une mesure visant à favoriser l’inclusion des communautés autochtones dans les contrats fédéraux par la sous-traitance, l’emploi, la formation et le perfectionnement des compétences.
Conserver nos lacs et nos rivières
ECCC a continué de collaborer avec les gouvernements provinciaux pour conserver et protéger le fleuve Saint-Laurent. Ce fleuve est reconnu dans le monde entier, comme en témoigne la désignation par la Convention de Ramsar de quatre de ses milieux humides comme des zones humides d’importance internationale. Le programme de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a renouvelé la désignation de réserve mondiale de biosphère du lac Saint-Pierre pour une période de 10 ans, et désigné le parc national de Miguasha comme site du patrimoine mondial. En 2021, les gouvernements du Canada et du Québec se sont engagés à investir respectivement 39 millions de dollars et 25 millions de dollars sur cinq ans pour la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 2021-2026. L’exécution des projets conjoints élaborés conformément à ce plan s’est poursuivie en 2023-2024.
Le Ministère a également continué d’accroître la participation du public à la conservation et à la restauration par la science citoyenne, et de financer des activités de conservation et de protection de l’eau par diverses initiatives axées sur les écosystèmes. Ces initiatives comprennent des investissements de 41,2 millions de dollars et de 23,1 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021, par les gouvernements du Canada et du Québec, respectivement, dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026.
Dans le bassin du lac Winnipeg, ECCC a poursuivi sa collaboration avec le Manitoba pour mettre en œuvre le Protocole d’entente Canada-Manitoba portant sur le lac Winnipeg et le bassin du lac Winnipeg. Ce protocole d’entente quinquennal, signé en 2021, a facilité la coopération sur la protection de la qualité de l’eau dans le bassin du lac Winnipeg et fait progresser les efforts visant à réduire la pollution par les nutriments dans le bassin. Le Ministère soutient également la mobilisation des peuples autochtones à l’appui de la réconciliation et des priorités mutuelles liées à la qualité de l’eau et à la santé écologique du lac Winnipeg et de son bassin. En 2023-2024, le Comité directeur du protocole d’entente a engagé des partenaires autochtones dans un dialogue afin d’établir des relations, de combler les lacunes dans les connaissances et d’explorer les possibilités d’inclure les peuples et les connaissances autochtones dans les travaux du Comité. Une entente auxiliaire pour les sciences est également proposée pour le protocole d’entente afin de mieux coordonner les mesures visant les priorités communes en matière de science et de surveillance dans le bassin du lac Winnipeg.
ECCC a continué d’appuyer les mesures locales axées sur l’eau douce par le Programme de financement communautaire ÉcoAction, notamment le projet de restauration et de protection de l’eau douce du ruisseau Grimesthorpe sur l’île Manitoulin, en Ontario, le projet de restauration du peuplier à Big Ranch dans la vallée de l’Elk, en Colombie-Britannique, et le projet de restauration du ruisseau Albemarle dans la péninsule Bruce, en Ontario. Ces projets étaient axés sur la restauration des zones riveraines et des plaines inondables et la restauration des écosystèmes d’eau douce, comme les cours d’eau et les milieux humides, afin d’améliorer la qualité de l’eau douce.
Le Ministère a continué de participer à la gestion coopérative de l’eau par l’intermédiaire des offices des eaux, qui rassemblent les intervenants pour se concentrer sur des questions précises liées à l’eau ayant des répercussions sur plus d’une province ou d’un territoire. Par exemple, ECCC est resté membre du Conseil du bassin du Mackenzie, et a notamment exploré les options d’amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème dans le bassin. Le Ministère a également continué d’appuyer les travaux de la Régie des eaux des provinces des Prairies et de ses nombreux comités. En 2023-2024, la Régie a conclu ses travaux visant à modifier l’Accord-cadre sur la répartition des eaux (1969) pour y ajouter une annexe axée sur la surveillance des eaux souterraines et des aquifères transfrontaliers. Il s’agit de l’annexe F de l’Accord-cadre.
De plus, ECCC a continué d’améliorer la qualité de l’eau douce et les écosystèmes des milieux humides partout au Canada en 2023-2024. Le Ministère a préparé un cadre pour l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de données sur l’eau douce, qui fournit les bases de l’élaboration collaborative future d’une stratégie nationale en matière de données sur l’eau douce complète et consensuelle. Cette stratégie établira des principes et des engagements communs pour la collecte, l’utilisation, le stockage et l’accessibilité des données sur l’eau douce au Canada.
Faire progresser le Plan de protection des océans du Canada
Le Ministère a continué de fournir des conseils scientifiques ainsi qu’un soutien en matière de réglementation et de programmes pour faire avancer la prochaine phase du Plan de protection des océans (PPO) du Canada. À compter de 2022-2023, le gouvernement fédéral a fourni deux milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler et élargir les initiatives existantes du PPO conçues pour renforcer le système de sécurité maritime du Canada et protéger les écosystèmes côtiers. En 2023-2024, ECCC a reçu 239 millions de dollars pour soutenir les travaux en cours sur neuf initiatives du PPO, notamment l’augmentation du soutien scientifique pour répondre aux urgences environnementales, l’élaboration de la stratégie du Canada pour le rétablissement de l’environnement après un déversement d’hydrocarbures, l’établissement de partenariats communautaires pour la surveillance de la faune, l’établissement d’un programme national intégré de planification des interventions maritimes, l’élargissement du régime d’intervention en cas de substances dangereuses et nocives, la prévention et l’élimination des navires posant problème, et l’exploration d’autres mesures d’intervention.
En 2023-2024, ECCC s’est concentré sur l’enrichissement des connaissances scientifiques et l’amélioration de sa capacité à fournir des conseils techniques et scientifiques complets et à jour lors des interventions en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin. Plusieurs activités notables appuient ces objectifs, comme le fait d’accroître les connaissances sur les zones et les espèces sauvages écosensibles dans les écosystèmes marins du Canada, de faire avancer la science à l’appui de l’intervention en cas d’incidents mettant en cause des substances dangereuses non liées aux hydrocarbures, et de continuer à améliorer la capacité de modélisation et de détection de la pollution du Ministère. De plus, ECCC a réalisé des progrès dans l’élaboration d’un cadre national de rétablissement à la suite de déversements d’hydrocarbures d’origine marine et a fourni un soutien pour gérer les épaves de navires qui pourraient constituer une menace de rejet de pollution dans l’environnement.
ECCC a continué de faire progresser la réconciliation en s’associant et en collaborant avec les peuples autochtones dans le cadre d’initiatives du PPO. Le Ministère a notamment déterminé les espèces sauvages et les écosystèmes sensibles du milieu marin et établi des partenariats communautaires pour la surveillance de la faune. ECCC a également réalisé des progrès dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de collecte de données de l’Analyse comparative entre les sexes plus et de production de rapports connexes pour les activités qu’il réalise en vertu du PPO, en mettant l’accent sur les activités qui nécessitent la mobilisation des nations et communautés autochtones, la collaboration avec elles et leur participation à la conception.
Protection des mollusques et des crustacés canadiens
ECCC a continué de fournir des recommandations à Pêches et Océans Canada concernant la santé et la sécurité des eaux coquillières. Le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM) est un programme fédéral de salubrité des aliments qui vise à réduire au minimum les risques pour la santé associés à la consommation de mollusques bivalves contaminés tout en permettant le commerce international.
Il est exécuté conjointement dans le cadre d’un protocole d’entente par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Pêches et Océans Canada et ECCC. Les activités d’ECCC visent à permettre la récolte d’aliments sains et salubres par les intervenants commerciaux et récréatifs, et à honorer les droits des Autochtones à la récolte. En 2023-2024, en tant que partenaire clé du PCCSM, ECCC a fourni des conseils scientifiques grâce à des activités continues telles que la surveillance de la qualité bactériologique de l’eau ainsi que la détermination et l’évaluation des sources de pollution sanitaire. En plus de ces conseils, le Ministère a continué de faire des évaluations de la qualité de l’eau après les événements environnementaux importants (comme les phénomènes météorologiques extrêmes, les rejets accidentels d’eaux usées et le ruissellement agricole).
Les Canadiens ont un air pur
Travailler à l’amélioration de la qualité de l’air
ECCC a continué de travailler avec ses principaux partenaires fédéraux, y compris Santé Canada et le Conseil national de recherches du Canada, pour améliorer la qualité de l’air et réduire les effets négatifs de la qualité de l’air sur la santé humaine et l’environnement. Le Ministère a collaboré avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA), une approche globale visant à réduire la pollution de l’air extérieur au Canada. En collaboration avec Santé Canada, ECCC a terminé un examen des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour les particules fines (PM2,5) de 2020, poursuivi l’élaboration de nouvelles normes plus rigoureuses sous la direction du Conseil canadien des ministres de l’environnement, et continué de surveiller les concentrations de polluants atmosphériques clés, avec l’aide des provinces et des territoires, par le Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique.
ECCC a également continué d’exécuter d’autres programmes de surveillance de la qualité de l’air ainsi que des activités scientifiques et de recherche pour appuyer les politiques sur la pollution atmosphérique, l’élaboration de règlements et la conformité au Canada. Le Ministère a notamment entamé l’étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto pour examiner les effets des conditions météorologiques, des appareils de chauffage, des foyers au bois, du sel de voirie et d’autres facteurs hivernaux sur la qualité de l’air urbain.
Le Ministère a tiré parti de son infrastructure de calcul de haute performance pour mener des recherches afin de mieux comprendre les répercussions des dépôts de polluants atmosphériques (p. ex. pluies acides) sur les écosystèmes et la santé humaine, d’améliorer les modèles permettant de prévoir les effets des contaminants atmosphériques sur la qualité de l’air, et de fournir des scénarios à l’appui de l’élaboration de politiques. Ses modèles de qualité de l’air étayent également la recherche menée par Santé Canada afin d’étudier les effets de la qualité de l’air sur la santé humaine, comme les avantages pour la santé de la réduction des émissions de polluants atmosphériques et les évaluations de l’exposition à long terme à la fumée des feux de forêt. De plus, le Ministère a publié et amélioré sa Cote air santé quotidienne et ses prévisions de la qualité de l’air afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions pour protéger leur santé. En collaboration avec Santé Canada, ECCC a continué de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre des améliorations stratégiques et ciblées à la Cote air santé.
ECCC a continué d’élaborer, d’administrer et de modifier, au besoin, des règlements visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques provenant de sources industrielles, des véhicules, des moteurs et des carburants, ainsi que des produits commerciaux et de consommation. Ces travaux ont compris l’administration du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et de divers instruments non réglementaires qui encadrent les émissions de polluants atmosphériques provenant des secteurs industriels, l’évaluation et l’élaboration d’options pour combler les lacunes dans la gestion des polluants atmosphériques du secteur pétrolier et gazier, et l’évaluation des options de modification du Règlement sur l’essence du Canada afin d’éliminer progressivement les sources restantes de carburant au plomb utilisées au Canada.
Réduction des émissions de composés organiques volatils
Le Ministère a pris diverses mesures pour continuer de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), qui contribuent à la formation de PM2,5 et d’ozone troposphérique, les principaux composants du smog. Le 24 février 2024, ECCC a publié le projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) aux fins d’une période de consultation de 60 jours. Ce règlement vise à réduire les émissions de benzène et d’autres COV provenant des réservoirs de stockage de pétrole et des opérations de chargement. Le Ministère continue également d’administrer le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier).
De plus, en février 2024, ECCC et Santé Canada ont publié un avis d’intention d’entreprendre l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques, qui pourrait comprendre le recours à des règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour limiter les émissions de benzène des stations-service.
ECCC a continué d’administrer la série d’instruments portant sur les COV dans les produits commerciaux et de consommation, notamment le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, alors que de nouvelles limites sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Ces dispositions réduiront les émissions de COV d’environ 130 catégories et sous-catégories de produits. Il s’agit notamment des produits de soins personnels, des produits d’entretien automobile et ménager, des adhésifs, des dissolvants d’adhésifs, et des produits d’étanchéité et de calfeutrage. De plus, le Ministère a poursuivi ses travaux visant à modifier les limites de concentration de COV dans le règlement sur les revêtements architecturaux.
Lutte contre la pollution atmosphérique transfrontalière
ECCC a poursuivi ses efforts internationaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontalière dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air (AQA) et de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, y compris son Protocole de Göteborg. Le Ministère a notamment réalisé une évaluation et un examen conjoints de l’AQA et pris part à un processus d’examen du Protocole de Göteborg. En 2023-2024, ECCC a entrepris des préparatifs en vue d’entamer des négociations pour modifier les accords.
Autres résultats ministériels
ECCC a continué de mettre en œuvre une approche d’application de la loi fondée sur les risques en se servant d’évaluations de la menace et des risques pour déterminer les priorités. Lorsqu’un projet est considéré comme présentant un risque élevé par rapport à d’autres substances, secteurs, lois ou règlements, cela signifie que le potentiel de dommages à l’environnement dus à la non-conformité est plus élevé. Les inspections aident à déterminer si l’évaluation était exacte, à vérifier le degré et la nature de la non-conformité et à atténuer le risque. Les agents d’application de la loi ont effectué des inspections dans le but de cibler les cas de non-conformité et de recueillir de l’information utile aux évaluations de la menace et des risques en cours.
Les agents d’application de la loi en environnement du Ministère ont continué de vérifier la conformité aux lois environnementales et aux règlements connexes qui interdisent ou contrôlent la pollution de l’air et de l’eau. Ils ont mené 3 606 inspections en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de la Loi sur les pêches, y compris 137 inspections liées à des priorités déterminées selon les risques, comme les moteurs, la fabrication de produits chimiques et l’industrie métallurgique.
Les inspections ont donné lieu à 33 nouvelles enquêtes en vertu des règlements sur la pollution et à la prise de 717 mesures d’application de la loi, y compris des sanctions administratives pécuniaires (SAP), des ordres d’exécution, des contraventions, des avertissements, des ordres, des poursuites et d’autres mesures. Les enquêtes ont abouti à 10 condamnations et à 6 nouvelles poursuites. En 2023-2024, un total de 7 155 000 dollars en pénalités a résulté de poursuites. De plus, les sanctions pécuniaires découlant des SAP ont totalisé 430 000 dollars.
En 2023-2024, les mesures d’application de la loi ciblant la pollution de l’eau et de l’air ont compris la délivrance d’ordres relatifs aux cas suivants :
- Peace River Hydro Partners versera 1,1 million de dollars pour le rejet d’eaux de drainage contaminées dans la rivière de la Paix après avoir plaidé coupable devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique à Fort St. John à un chef d’accusation d’avoir rejeté une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, en contravention de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral. Il s’agit de l’amende la plus élevée infligée en 2023-2024 en vertu de la Loi sur les pêches.
- Plastique Royal Inc. est condamnée à payer une amende de 600 000 dollars par la Cour du Québec, au palais de justice de Laval, ce qui représente l’amende la plus élevée infligée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en 2023-2024. L’entreprise a plaidé coupable à un chef d’accusation d’infraction à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et à un chef d’accusation d’infraction au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils des produits de finition automobile.
La plupart des amendes payées par les contrevenants sont versées au Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement du Canada afin d’être utilisées dans le cadre d’initiatives bénéfiques de protection et de conservation de l’environnement.
Par ailleurs, le Ministère a continué de renforcer les capacités en intégrant et en formant les agents d’application de la loi nouvellement recrutés, et en offrant une formation de renouvellement de l’accréditation aux agents d’application de la loi désignés existants.
Principaux risques
Les programmes de prévention de la pollution et les autres questions environnementales sont intrinsèquement complexes, en particulier ceux qui sont intergouvernementaux ou internationaux et qui nécessitent une vaste collaboration avec divers partenaires, tels que des entreprises, des organisations non gouvernementales, des communautés autochtones, des municipalités, des provinces, des territoires et d’autres pays. Le maintien de relations efficaces avec les partenaires peut parfois être difficile en raison de priorités concurrentes, de paysages politiques changeants, de contraintes en matière de ressources, de l’absence de financement permanent pour certains programmes et d’un mandat en expansion pour le Ministère. Afin d’atténuer les risques associés à ses partenariats stratégiques, le Ministère a continué d’appuyer des approches proactives et stratégiques pour l’élaboration de politiques et la prestation de conseils au cours de l’exercice 2023-2024, notamment en accroissant l’ampleur et en améliorant la qualité des documents mis en commun (notes d’information, information sur les questions clés, etc.). ECCC a collaboré avec ses partenaires par l’intermédiaire d’organes de gouvernance existants et nouveaux, en continuant d’adapter et d’intégrer des pratiques modernisées de travail à distance et d’explorer des solutions technologiques pour promouvoir la collaboration entre les partenaires, notamment en modernisant les technologies de conférence dans ses salles de conférence.
Le risque de graves effets saisonniers tels que les feux de forêt est en croissance. Afin d’éviter que ces événements n’entravent sa capacité à maintenir ses activités, comme celles menées sur le terrain, ECCC a conçu de nouvelles approches de surveillance, tant pour ce qui est de la logistique que de la science et de la conception.
De plus, le Ministère a continué d’examiner les leçons apprises associées au travail sur le terrain pendant la pandémie, et de veiller à ce que les plans de gestion de la continuité des activités et les pratiques d’analyse des répercussions sur les activités demeurent évolutifs et complets.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 4 : Aperçu des ressources requises pour Prévention et gestion de la pollution
Le tableau 4 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.
| Ressources | Prévues | Réelles |
|---|---|---|
| Dépenses | 420 436 048 $ | 471 476 416 $ |
| Équivalents temps plein | 2 197 | 2 334 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Priorités pangouvernementales connexes
Analyse comparative entre les sexes Plus
ECCC a continué d’appliquer une optique d’Analyse comparative entre les sexes Plus à l’élaboration des recommandations stratégiques, des programmes et des mesures visant à lutter contre la pollution et à améliorer la qualité de l’air. L’exposition à la pollution atmosphérique peut avoir des effets néfastes sur la santé de toutes les personnes. Ces effets peuvent être aggravés chez les personnes qui présentent de multiples facteurs de risque, comme le fait d’être âgées ou d’avoir des problèmes de santé chroniques. En outre, certaines populations sont touchées de manière disproportionnée par la pollution atmosphérique si elles vivent dans des zones où les concentrations de pollution atmosphérique sont élevées. En réponse à ces réalités, le Ministère a continué de faire participer aux travaux sur la qualité de l’air les populations touchées, y compris les communautés autochtones vivant à proximité de grands complexes industriels et celles touchées par la fumée des feux de forêt. Par exemple, ECCC a participé à une réunion au sommet avec la Première Nation d’Aamjiwnaang et le gouvernement de l’Ontario et a commencé à travailler à l’établissement d’une table de partenariat pour trouver des solutions aux préoccupations de la communauté en matière de qualité de l’air. Dans le même ordre d’idée, le Ministère a continué de collaborer avec les communautés autochtones sur des initiatives de qualité de l’eau dans les écosystèmes d’eau douce clés, notamment les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le bassin versant du fleuve Saint-Laurent et le bassin versant du fleuve Wolastoq/Saint-Jean. Les projets visaient à répondre aux préoccupations des communautés, à accroître la participation des Autochtones à la prise de décisions et à la gouvernance des ententes sur l’eau, et à élargir l’utilisation des connaissances traditionnelles autochtones dans les initiatives sur la qualité de l’eau. Les travaux menés par ECCC pour identifier et gérer les substances nocives ont continué de reposer sur des renseignements scientifiques et ont tenu compte de l’importance d’une saine gestion des risques pour réduire les risques de l’exposition à des produits chimiques toxiques qui se posent aux groupes touchés. La mobilisation a aidé à adapter le matériel de promotion de la conformité pour mieux tenir compte des profils culturels et linguistiques des publics cibles. Le Ministère a également continué d’améliorer ses pratiques d’embauche pour accroître la représentation de la population canadienne au sein de son effectif d’application de la loi.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et Objectifs de développement durable des Nations Unies
Plus de renseignements sur l’apport d’ECCC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable.
Innovation
Des produits plus sûrs et plus respectueux de l’environnement
La Région des lacs expérimentaux de l’Institut international du développement durable (RLE de l’IIDD), un engagement de 25 millions de dollars sur cinq ans pris dans le budget de 2022 pour soutenir la capacité scientifique ainsi que les collaborations nationales et internationales, a poursuivi la réalisation de recherches scientifiques sur l’eau douce et en a entamé de nouvelles, en mettant l’accent sur l’examen des répercussions des microplastiques, des proliférations d’algues nuisibles et des contaminants émergents, qui sont des domaines de priorité partagés avec le gouvernement fédéral. D’importantes mises à niveau de l’infrastructure de la plateforme de recherche ont également progressé. La priorité qu’est l’échange de connaissances s’est poursuivie grâce à des collaborations scientifiques nationales et internationales ainsi qu’à des activités de mobilisation des jeunes et des peuples autochtones. En particulier, la RLE de l’IIDD a terminé sa 55e année de collecte de données climatiques et biologiques à long terme, contribuant ainsi aux réseaux de données nationaux et internationaux.
Répertoire des programmes
La responsabilité essentielle Prévention et gestion de la pollution est appuyée des programmes suivants :
- Qualité de l’air
- ÉcoAction communautaire
- Promotion de la conformité et Application de la loi – Pollution
- Qualité de l’eau et partenariat sur les écosystèmes
- Gestion des substances et des déchets
Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour Prévention et gestion de la pollution se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.
Conservation de la nature
Description
Protéger et rétablir les espèces en péril et leur habitat essentiel, maintenir et rétablir des populations saines d’oiseaux migrateurs et d’autres espèces sauvages, et gérer et étendre le réseau canadien d’aires protégées afin de conserver la biodiversité, de contribuer à l’atténuation des changements climatiques et à l l’adaptation à ces derniers, et de favoriser la santé et le bien être des humains. Pour y parvenir, il faudra prendre des décisions fondées sur des données probantes qui tiennent compte des effets cumulatifs, promouvoir les lois et les règlements et veiller à leur application, mobiliser de façon significative les peuples autochtones et collaborer avec les provinces et les territoires, les autres intervenants nationaux et internationaux et le public.
Progrès à l’égard des résultats
Tableau 5 : Cibles et résultats relativement à Conservation de la nature
Le tableau 5 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé aux résultats liés à Conservation de la nature.
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage des espèces d’oiseaux migrateurs qui se trouvent dans les intervalles de populations ciblées | 70 % | Décembre 2030 | 2021-2022 : Résultat non disponible. 2022-2023 : Résultat non disponible.Note de bas de page 37 2023-2024 : 54 % |
| Pourcentage des aires canadiennesNote de bas de page 38 conservées comme aires protégées et autres mesures de conservation efficaces axées sur les aires | 25 % | Décembre 2025 | 2021-2022 : 13,5 % 2022-2023 : 13,6 % 2023-2024 : 13,7 % |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage des espèces en péril pour lesquelles les modifications dans les populations correspondent aux objectifs de rétablissement et de gestion. | 60 % | Mai 2025 | 2021-2022 : 41 % 2022-2023 : 43 % 2023-2024 : 44 % |
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Pourcentage de peuples autochtones engagés auprès d’ECCC qui indiquent que leur participation était significative | 61 % | Avril 2024 | 2021-22 : 70 % 2022-23 : 66 % 2023-24 : 71 % |
Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC.
Renseignements sur les résultats
La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à Conservation de la nature en 2023‑2024 en les comparant aux résultats prévus dans le Plan ministériel d’ECCC pour l’exercice.
La faune et les habitats du Canada sont préservés et protégés
Assurer un leadership en matière de conservation
Le Ministère a continué de jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en s’appuyant sur les résultats de la deuxième partie de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CdP15), tenue à Montréal en décembre 2022. En réponse au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui établit une voie ambitieuse pour arrêter et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030, ECCC a dirigé la mobilisation nécessaire à l’élaboration de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada en collaboration avec d’autres ministères et des partenaires externes. Ces travaux ont compris la publication d’une ébauche de stratégie en décembre 2023 pour obtenir les commentaires du public. ECCC a mobilisé la table sur la nature des Premières Nations, la table sur la nature Strawberry Moon des Métis, les partenaires inuits prenant part à l’établissement conjoint de la table sur la nature des Inuits fondée sur les distinctions, et d’autres organisations, gouvernements, communautés et groupes de l’industrie autochtones.
En 2023-2024, ECCC a également réuni des experts de la communauté universitaire, d’organisations autochtones, d’organismes gouvernementaux, d’organisations non gouvernementales et de l’industrie pour orienter la préparation d’un rapport sur les connaissances et les données scientifiques nécessaires pour soutenir la mise en œuvre par le Canada du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Le Canada a également lancé le Réseau des champions de la nature afin de soutenir le dynamisme international dans la mise en œuvre du Cadre mondial. Sur la scène internationale, le Canada a travaillé avec ses partenaires par l’intermédiaire de forums multilatéraux complémentaires, comme le G7 et le G20, en vue de stimuler une mise en œuvre ambitieuse et efficace du Cadre mondial à l’échelle planétaire.
ECCC a mobilisé le Comité consultatif sur la nature au sujet de la Stratégie pour la nature et d’autres questions afin de faire progresser les engagements à conserver la biodiversité. Ce comité se compose d’experts ayant divers points de vue qui fournissent des conseils stratégiques et des recommandations au Ministère et au ministre de l’Environnement et du Changement climatique sur la conservation de la biodiversité, les espèces en péril et l’utilisation durable des terres et des ressources.
ECCC a également continué de représenter le Canada aux réunions tenues dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Le Ministère a continué de surveiller les menaces qui pèsent sur les espèces partout dans le monde, pris des mesures pour contribuer efficacement à leur conservation et à leur utilisation durable, et continué de sensibiliser le public au rôle du commerce des espèces sauvages dans la propagation des zoonoses.
ECCC a continué de travailler avec ses partenaires fédéraux, les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les organismes de conservation, le secteur privé et la société civile sur un plan ambitieux visant à conserver 25 % des terres, des eaux intérieures et des océans du Canada d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030, conformément à l’engagement pris dans le discours du Trône de 2020 et adopté dans le Cadre mondial de la biodiversité. Le Ministère a continué de travailler avec d’autres partenaires fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les organismes de conservation, le secteur privé, les propriétaires fonciers et la société civile sur un plan ambitieux visant à atteindre ces cibles, qui sont fondées sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales. Pour avancer dans la réalisation de ces cibles, ECCC a fait progresser les travaux sur de nombreux projets de conservation dans l’ensemble du pays avec une grande variété de partenaires. Par ailleurs, reconnaissant que la perte de nature est un problème mondial nécessitant une action mondiale, le Canada a continué de plaider, en tant que membre de la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, pour que les pays du monde entier mettent en œuvre la cible de conservation convenue de 30 % pour 2030.
Le Canada a fait d’importants investissements dans la conservation de la nature par l’intermédiaire des initiatives Patrimoine naturel (budget de 2018) et Patrimoine naturel bonifié (budget de 2021). L’initiative Patrimoine naturel bonifié appuie le travail de conservation par zone avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les administrations locales, les organisations non gouvernementales de l’environnement, les secteurs clés de l’industrie, les fiducies foncières et les propriétaires fonciers privés afin de continuer à bâtir un réseau connecté d’aires protégées et de conservation au Canada. En 2023-2024, les mesures ont compris ce qui suit :
- Financement pour les demandeurs autochtones et non autochtones afin d’appuyer l’établissement d’aires protégées supplémentaires et d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) dans une plus grande variété de paysages au pays.
- Engagements ambitieux de la part des provinces et des territoires, obtenus par la négociation d’accords sur la nature, pour faire progresser la conservation et la protection de l’habitat faunique, le rétablissement des espèces en péril, la conservation des oiseaux migrateurs, la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles et la restauration de l’habitat, tout en reconnaissant et en appuyant les initiatives d’intendance dirigées par les Autochtones grâce à la collaboration et au partenariat. Le premier accord sur la nature, signé avec le gouvernement du Yukon, a été annoncé à la CdP15. Depuis, un accord sur la nature a été signé avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, et un accord-cadre tripartite sur la conservation de la nature a été signé avec la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations.
- Investissement dans le Programme de conservation par zone menée par les Autochtones pour les aires protégées et les AMCEZ dirigées par des Autochtones, disponible exclusivement aux demandeurs autochtones, afin d’appuyer la planification des futurs objectifs de conservation et l’établissement d’aires protégées et de conservation. Les aires protégées et de conservation autochtones, également connues sous d’autres termes tels qu’aires protégées et de conservation inuites ou aires protégées et de conservation métisses, sont des terres et des eaux pour lesquelles les gouvernements autochtones sont les principaux responsables de la protection et de la conservation des écosystèmes par le biais des lois, de la gouvernance et de la science autochtones.
- Investissement continu d’ECCC, au moyen du Programme de conservation du patrimoine naturel, dans des partenariats public-privé grâce à un investissement de 215 millions de dollars sur sept ans du Fonds de la nature du Canada pour appuyer l’acquisition et la protection de terres privées ayant une valeur importante pour la biodiversité.
- Poursuite de la mise en œuvre du Programme de dons écologiques, qui s’appuie sur ses 29 années d’existence à encourager les dons de terres privées à des fins de conservation grâce à des incitatifs fiscaux.
Lors de la CdP15, le Canada a annoncé un montant pouvant atteindre 800 millions de dollars, complété par les contributions d’organisations caritatives, pour quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones dans le cadre du financement de projets pour la permanence :
- dans les Territoires du Nord-Ouest, auquel participent des gouvernements et des organisations autochtones de l’ensemble du territoire;
- dans la zone marine Great Bear de la biorégion du plateau nord, en Colombie-Britannique;
- dans la région de Qikiqtani, au Nunavut;
- dans les basses-terres de la baie d’Hudson, en Ontario, le littoral de l’ouest de la baie d’Hudson et le sud-ouest de la baie James.
Ces initiatives visent à contribuer grandement au respect des engagements du Canada en matière de conservation par zone grâce à l’application d’un modèle de financement novateur, le financement de projets pour la permanence, qui repose sur le partenariat.
Ce modèle réunit les organisations autochtones, les gouvernements et la communauté philanthropique afin de fixer et d’atteindre des objectifs communs pour protéger la nature et réaliser d’autres avantages liés à la conservation. L’approche mobilise des investissements de tiers pour accélérer la conservation à grande échelle dirigée par des Autochtones dans l’ensemble du pays.
Des progrès importants ont été réalisés pour faire avancer les initiatives du financement de projets pour la permanence en 2023-2024, notamment la signature de l’accord-cadre sur le financement de projets pour la permanence avec les Territoires du Nord-Ouest. Cette étape historique dans le processus de financement de projets pour la permanence aux Territoires du Nord-Ouest a été franchie grâce à une collaboration sans précédent et s’appuie sur la vision commune d’une approche inclusive et à long terme en ce qui concerne l’atténuation des changements climatiques, la gérance environnementale, les droits des Autochtones et la gouvernance collaborative. Toutes les parties continuent de faire des progrès en vue de conclure des accords définitifs en 2024.
Agrandissement des réserves nationales de faune et conservation de l’habitat des espèces en péril
En 2023-2024, ECCC a procédé à l’agrandissement de réserves nationales de faune (RNF) existantes afin de protéger d’importantes espèces sauvages et leur habitat, comme la RNF du Lac-Saint-François au Québec et la RNF du Ruisseau-Portobello au Nouveau-Brunswick. Ces mesures font progresser la réalisation de l’engagement du Canada à protéger 25 % de ses terres d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030. Treize parcelles de terrain ont été acquises en 2023-2024, et elles seront ajoutées à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
L’arrêt et l’inversion de la perte d’espèces ont continué d’être une priorité pour ECCC.
ECCC a continué de mener divers types d’initiatives de protection et de rétablissement de la biodiversité en 2023-2024, à la lumière des conclusions du rapport Espèces sauvages 2020, publié tous les cinq ans. Le ministère a par exemple investi 5,6 millions de dollars sur trois ans avec Canards Illimités Canada dans des projets visant à accroître les efforts de conservation de la biodiversité dans les milieux humides et côtiers au sud des six provinces de l’est du pays, de l’Ontario à Terre-Neuve-et-Labrador; et 585 000 dollars sur trois ans dans les efforts de conservation de la biodiversité dans la réserve de biosphère de la baie Georgienne.
ECCC et ses partenaires fédéraux ont continué de mettre en œuvre une entente de 50 millions de dollars avec la Colombie-Britannique pour protéger les forêts anciennes et les habitats contre l’exploitation forestière. En 2022, le gouvernement du Canada a mis en place un fonds pour la protection de la nature (BC Old Growth Nature Fund) de 50 millions de dollars, montant auquel s’ajoute un financement de contrepartie égal de la province de la Colombie-Britannique. Ce fonds protégera les terres forestières anciennes ayant la plus grande valeur pour la biodiversité, les espèces en péril et l’habitat faunique qui étaient menacées par l’exploitation forestière. Ce financement contribue directement aux engagements du gouvernement du Canada pris dans l’Accord-cadre tripartite sur la conservation de la nature annoncé le 3 novembre 2023. ECCC a adopté une approche qui associe les Premières Nations, les collectivités locales et les travailleurs à titre de partenaires dans la formulation de la voie à suivre pour protéger la nature. Récemment, le gouvernement de la Colombie-Britannique, de concert avec ECCC, Ressources naturelles Canada et sept fiducies foncières et organismes de conservation, a œuvré pour protéger les forêts anciennes et l’habitat essentiel d’espèces en péril dans huit sites totalisant 316 hectares.
Protection complète des oiseaux migrateurs
Le Ministère a établi, maintenu et appliqué une base de connaissances solide pour conserver les oiseaux migrateurs et d’autres éléments de la biodiversité grâce à des initiatives de conservation intégrées, ciblées et multi-espèces, à des mesures réglementaires efficaces et à la gestion des aires protégées. Pour mettre fin à la perte d’espèces d’ici 2030 et l’inverser d’ici 2050, il sera essentiel de conserver et de gérer les oiseaux migrateurs. La perte de trois milliards d’oiseaux en Amérique du Nord depuis les années 1970 souligne la nécessité d’un travail diligent pour atteindre ces objectifs. La conservation et la gestion des oiseaux migrateurs sont fondamentales pour le Ministère et sont liées à toutes les lois et à tous les règlements sur la biodiversité et la conservation qu’ECCC fait appliquer. En 2023-2024, le Ministère a continué de s’acquitter de la responsabilité du gouvernement du Canada à l’égard des oiseaux migrateurs en s’efforçant de maintenir et de restaurer leurs populations et leur habitat. Le Ministère s’en charge notamment en exécutant une série de programmes de surveillance et de recherche rigoureusement conçus qui orientent la conservation et la gestion adaptative des oiseaux migrateurs, ainsi que plusieurs autres priorités ministérielles telles que la planification des aires protégées, les activités de rétablissement des espèces en péril, les conseils relatifs aux évaluations d’impact et les interventions d’urgence.
Le Ministère a également continué de favoriser la collaboration au pays et à l’étranger, et de mobiliser les personnes et les collectivités afin d’obtenir des résultats de conservation plus avantageux pour les oiseaux migrateurs. ECCC a par exemple investi plus de cinq millions de dollars dans un large éventail de programmes gérés par Oiseaux Canada partout au pays pour la surveillance et la conservation des oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril. Les résultats de ces projets, guidés par la science citoyenne, ont aidé à rapprocher les Canadiens de la nature, à planifier le rétablissement des espèces en péril et à protéger l’habitat de ces espèces. Cet investissement montre l’engagement du Canada à prendre des décisions fondées sur la science pour la conservation des oiseaux migrateurs, au moyen d’un partenariat avec un organisme national et en incluant les Canadiens dans ces projets. De même, au cours des dernières années, ECCC a investi près de sept millions de dollars dans des initiatives de science ouverte afin de créer des plateformes pour héberger, gérer, analyser et communiquer des renseignements essentiels et fondamentaux sur la répartition et l’abondance des oiseaux migrateurs dans l’ensemble du pays afin qu’ils soient disponibles et accessibles aux décideurs et aux Canadiens.
Stratégie globale de protection des oiseaux migrateurs
ECCC a continué d’exécuter un plan d’action coordonné et complet pour protéger les oiseaux migrateurs et leur habitat en visant les objectifs suivants :
- Établir et maintenir une base de connaissances solide pour appuyer la conservation et la gestion des oiseaux migrateurs au Canada, y compris les espèces en péril, et de leur habitat : en mettant en œuvre des programmes de surveillance rentables des oiseaux migrateurs; en entreprenant des recherches prioritaires pour déterminer les causes des changements de population; et en intégrant les modes de connaissance des peuples autochtones et la science occidentale.
- Appliquer cette solide base de connaissances pour conserver les oiseaux migrateurs et d’autres éléments de la biodiversité au moyen d’initiatives de conservation ciblées et multi-espèces, de mesures réglementaires efficaces et de la gestion des aires protégées : en travaillant dans le cadre du processus de rétablissement des espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril afin d’améliorer la conservation des oiseaux migrateurs; en appuyant la gestion efficace et l’agrandissement du réseau d’aires protégées du Canada; et en mettant en œuvre un cadre réglementaire de conservation et de gestion des oiseaux migrateurs, portant notamment sur la récolte, la délivrance de permis et les travaux visant à élaborer un régime de délivrance de permis de prise fortuite.
- Favoriser la collaboration au pays et à l’étranger, et mobiliser les personnes et les collectivités afin d’obtenir des résultats de conservation plus avantageux pour les oiseaux migrateurs : en travaillant en collaboration pour intégrer les considérations relatives à la conservation des oiseaux migrateurs dans les politiques et les programmes de tous les ordres de gouvernement; en établissant et maintenant des relations significatives avec les peuples autochtones; en soutenant et encourageant la collaboration nationale avec les partenaires; en favorisant les partenariats internationaux pour assurer la conservation tout au long du cycle de vie annuel; et en mobilisant les individus et les communautés pour leur donner les moyens de prendre des mesures positives pour les oiseaux migrateurs.
Évaluer et prendre en charge la santé de la nature
ECCC s’est appuyé sur le modèle « Une seule santé » pour soutenir la santé de la faune. Ce modèle est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire qui reconnaît le lien entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement naturel commun. En 2023-2024, en collaboration avec d’autres ministères fédéraux, ses homologues provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones, ECCC a continué de fournir un soutien en matière de coordination, de planification, de recherche et de surveillance pour éclairer la prise de décisions sur les agents pathogènes émergents ainsi que sur les répercussions de multiples facteurs de stress et des effets cumulatifs sur la santé de la faune. Se fondant sur l’approche collaborative « Une seule santé », l’approche pancanadienne pour la santé de la faune a encouragé la collaboration et la coopération entre les secteurs des humains, des animaux et de l’environnement afin d’obtenir des avantages partagés. Elle a notamment compris une augmentation de la surveillance et de la préparation pour faire face aux changements environnementaux qui ont des répercussions sur tous les secteurs, et l’avancement des efforts visant à résoudre les problèmes liés à la salubrité et à la sécurité alimentaires des Autochtones et au maintien des modes de vie traditionnels. Grâce à une telle collaboration dans tous les secteurs, l’approche « Une seule santé » a permis d’obtenir les meilleurs résultats en matière de santé pour les personnes, les animaux et les plantes dans un environnement commun.
Le Ministère a investi 1,08 million de dollars sur deux ans dans l’Initiative boréale de l’Ouest afin d’évaluer, avec la Nation dénée, les effets cumulatifs des feux de forêt, de la prédation, des principaux ravageurs, des perturbations anthropiques et des changements climatiques sur les forêts boréales de l’Ouest du Canada. Cette initiative était une collaboration de provinces, de territoires et de gouvernements de Premières Nations visant à protéger les forêts boréales de l’Ouest du Canada, une vaste zone qui s’étend du 50e parallèle vers le nord jusqu’à la limite des arbres.
Faire progresser les solutions axées sur la nature pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
ECCC a continué de mettre en œuvre le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN) de 1,4 milliard de dollars pour appuyer des projets de conservation, de restauration et d’amélioration des milieux humides, des tourbières, des forêts et des prairies qui stockent et captent le carbone. En 2021, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds pour des solutions climatiques naturelles de quatre milliards de dollars sur 10 ans, sous la direction de Ressources naturelles Canada et en partenariat avec ECCC et Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour faire face à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Ce fonds s’axait notamment sur les recherches visant à favoriser des avantages optimaux en matière de biodiversité et de séquestration du carbone. Le budget de 2022 a annoncé un investissement supplémentaire de 780 millions de dollars dans le FSCAN pour réduire les émissions de GES grâce à des solutions axées sur la nature.
Volet de ce fonds plus vaste, le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN), dont l’enveloppe s’élève à 1,4 milliard de dollars, s’est axé sur trois objectifs principaux : la restauration des écosystèmes dégradés; l’amélioration des pratiques de gestion des terres, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et du développement urbain; et la conservation des écosystèmes riches en carbone risquant fortement d’être convertis à d’autres utilisations qui libéreraient le carbone qu’ils stockent. Le FSCAN comprend également le volet Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones, qui soutient les initiatives communautaires pour faire participer les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’élaboration et à l’avancement des activités de réduction des émissions de GES.
Conservation, restauration et amélioration des prairies et milieux humides essentiels dans les Prairies
Le gouvernement du Canada a investi plus de 25 millions de dollars sur trois ans pour conserver, restaurer et améliorer les prairies et les milieux humides essentiels dans les provinces des Prairies, soit un montant pouvant atteindre 19,28 millions de dollars pour Canards Illimités, 4,05 millions de dollars pour Conservation de la nature Canada et 2,4 millions de dollars pour la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba. Ces initiatives faisaient partie des quatorze projets qui ont reçu un financement du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Ensemble, ces projets devaient permettre de conserver jusqu’à 30 000 hectares, de restaurer jusqu’à 6 000 hectares et de contribuer à la gestion améliorée de jusqu’à 18 000 hectares de milieux humides, de prairies et de zones riveraines.
Les espèces en péril canadiennes sont rétablies
Protéger les espèces en péril
L’initiative Patrimoine naturel bonifié a encore appuyé la mise en œuvre continue de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada grâce à des investissements sur cinq ans. Depuis 2021-2022, des investissements de 209 millions de dollars ont été faits pour mettre en œuvre des mesures de conservation dans les lieux prioritaires, et des investissements de 377 millions de dollars ont été faits pour soutenir les mesures de rétablissement des espèces prioritaires, ce qui comprenait le financement disponible pour les peuples autochtones dans le cadre de l’initiative Partenariats autochtones pour les espèces en péril. L’initiative Patrimoine naturel bonifié établit une feuille de route pour protéger la biodiversité du Canada en protégeant les terres et les eaux, en effectuant des activités d’intendance sur le terrain et en assurant la conservation des espèces en péril. Grâce à cette initiative et au soutien du Fonds de la nature du Canada, l’approche pancanadienne a continué de promouvoir et de faciliter les efforts de conservation concertés axés sur un ensemble de lieux, d’espèces et de secteurs prioritaires communs partout au Canada. Cette approche stratégique consistait en grande partie à délaisser les mesures indépendantes portant sur une seule espèce pour passer à des efforts concertés qui visent de multiples espèces et à des actions écosystémiques plus larges menés en partenariat par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les intervenants.
Le gouvernement fédéral est responsable des oiseaux migrateurs, des espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), de la gestion des océans et du commerce international des espèces sauvages, et partage la responsabilité de la gestion des pêches, des espèces aquatiques et de la prévention de la pollution. En 2023-2024, afin de respecter les principaux engagements et obligations relatifs à la protection et au rétablissement des espèces en péril en vertu de la LEP, ECCC a fait progresser l’élaboration de politiques, d’outils et d’approches fondées sur les risques, amélioré l’efficacité des programmes pour appuyer l’évaluation et la gestion des effets des activités humaines sur la biodiversité (espèces en péril en vertu de la LEP, oiseaux migrateurs en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, milieux humides conformément à la Politique fédérale de la conservation des terres humides), et continué de moderniser son approche de conservation en faisant progresser la mise en œuvre de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada.
ECCC a continué de collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les scientifiques, l’industrie et d’autres intervenants pour exécuter les activités liées à la LEP, notamment au moyen du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril, qui a accordé 5,6 millions de dollars de financement à 100 projets pour appuyer les activités d’intendance favorisant le rétablissement d’espèces terrestres en péril. Le Ministère a continué d’évaluer et de recenser les espèces en péril pour s’assurer qu’elles peuvent bénéficier des instruments réglementaires et des obligations prévus par la LEP. La détermination et l’inscription des espèces en péril ont permis de planifier et de mettre en œuvre leur rétablissement en détaillant les besoins en matière d’habitat, les menaces et les objectifs de rétablissement, ce qui a favorisé la prise de mesures de gestion et de conservation plus ciblées. ECCC continue d’honorer ses engagements à mettre en œuvre les recommandations formulées par le commissaire à l’environnement et au développement durable afin d’améliorer la mise en œuvre de la LEP, un mécanisme clé pour l’application du Cadre mondial de la biodiversité.
ECCC a poursuivi la mise en œuvre de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada en appuyant le rétablissement et la conservation de six espèces prioritaires fédérales, provinciales et territoriales (caribou de la toundra [y compris la population de Dolphin-et-Union], caribou boréal, Tétras des armoises, caribou de Peary, caribou des montagnes du Sud et bison des bois) et d’autres espèces d’intérêt fédéral. Le Ministère a soutenu le rétablissement et la conservation des espèces grâce à des efforts de collaboration, y compris des investissements jumelés de la part de partenaires et des ententes intergouvernementales durables de planification de la conservation avec les scientifiques et les peuples autochtones. En 2023-2024, le financement dirigé pour les espèces prioritaires du volet 1, totalisant 37,5 millions de dollars, a appuyé 34 projets. ECCC facilite de nombreuses mesures de conservation sur le terrain, notamment l’établissement de relations avec les partenaires, l’amélioration de la capacité dans les communautés autochtones, la surveillance des populations et la production de rapports à ce sujet, et le soutien de l’amélioration de l’habitat essentiel. L’encadré sur la protection du caribou boréal rend compte des efforts soutenus par l’initiative sur les espèces prioritaires dans le contexte de l’élaboration d’accords de conservation en vertu des articles 10 et 11 de la LEP.
En 2023-2024, 75 projets totalisant 14 millions de dollars d’investissements ont porté sur 23 autres espèces prioritaires, dont le Pluvier siffleur, l’ours blanc, la Chouette tachetée, le grizzli, le caribou et le monarque. Les projets visaient à combler les lacunes dans les connaissances, à mettre en œuvre des mesures de conservation sur le terrain par la conservation de l’habitat et à réduire les menaces sur les espèces.
De plus, ECCC a continué d’investir dans des projets pour soutenir la conservation continue des espèces en péril, en allouant un montant pouvant atteindre 26,6 millions de dollars à 145 projets menés dans des lieux prioritaires partout au pays. Des fonds de contrepartie supplémentaires ont été obtenus des partenaires. Les projets sont réalisés dans 12 lieux prioritaires déterminés en collaboration par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et dans 17 lieux prioritaires désignés par des collectivités, établis à la suite d’appels de demandes ouverts. Un nouveau lieu prioritaire a été créé en 2023, le lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northern à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Ministère appuiera des efforts de conservation qui profiteront à environ 40 espèces en péril et à leur habitat essentiel, et englobe des écosystèmes arctiques-alpins uniques de la péninsule Great Northern de l’île de Terre-Neuve, comme des landes et des affleurements calcaires, des côtes et des îles calcaires ainsi que des hauts plateaux calcaires qui abritent une grande biodiversité, en particulier des plantes et des oiseaux.
Voici des exemples de projets menés en 2023-2024 qui appuient les objectifs des lieux prioritaires :
- Gestion d’habitat par l’installation d’infrastructures (p. ex. clôtures et signalisation) pour diminuer la mortalité routière des espèces d’amphibiens et de reptiles en péril, et adoption d’une approche coordonnée de sensibilisation et de communication entre les partenaires et le grand public dans le lieu prioritaire de la forêt Walsingham de Long Point, en Ontario.
- Prise en charge et protection permanente de terres privées contenant de l’habitat, en particulier de l’habitat essentiel, pour de multiples espèces en péril dans le lieu prioritaire de Kespukwitk/sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Le projet appuie également la sensibilisation et l’éducation ciblées des propriétaires fonciers privés dont les propriétés contiennent de l’habitat d’espèces en péril.
- Amélioration et protection de l’habitat indigène de prairie grâce à des pratiques de gestion bénéfiques, à la prise en charge durable de l’habitat d’espèces en péril et à la poursuite des relevés de référence et de surveillance des espèces en péril afin d’orienter l’élaboration d’un plan de gestion des aires de répartition et la mise en œuvre de pratiques de gestion bénéfiques dans le lieu prioritaire du sud-ouest du Manitoba.
ECCC a continué de collaborer avec les partenaires et les intervenants pour élaborer conjointement des plans d’action en matière de conservation des espèces en péril (des cadres stratégiques de conservation) avec les secteurs des forêts, de l’agriculture et du développement urbain. Les plans visent à faire progresser les occasions d’améliorer les résultats de conservation des espèces en péril et d’améliorer la durabilité des secteurs. En 2023-2024, le Cadre stratégique de conservation pour les espèces en péril – Secteur agricole a été achevé.
Protection du caribou boréal en Ontario
En 2022, le Canada et l’Ontario ont conclu un accord pour soutenir la conservation et le rétablissement du caribou boréal dans la province. Le caribou boréal est une espèce emblématique et une espèce prioritaire fédérale, provinciale et territoriale dans le cadre de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada. Il est inscrit sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral et de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. Ayant conclu un accord de conservation en vertu des articles 10 et 11 de la LEP, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont collaboré pour prendre des mesures importantes en faveur du caribou et de son rétablissement en Ontario. S’appuyant sur le programme permanent de conservation du caribou de l’Ontario et sur le plan d’action fédéral pour le caribou, l’accord comprenait des engagements visant :
- à planifier et à mettre en œuvre des activités de restauration de l’habitat;
- à accroître la protection de l’habitat du caribou boréal au moyen d’aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par zone;
- à utiliser des approches fondées sur des données probantes pour rendre les populations locales autosuffisantes;
- à surveiller les conditions actuelles et prévues de la population et de l’habitat et à produire des rapports à ce sujet;
- à mettre en œuvre d’autres mesures de conservation collaboratives établies à la lumière des avis des experts indépendants, des communautés et organisations autochtones et des intervenants.
ECCC a fait progresser les évaluations des menaces et des risques afin d’axer les efforts d’application de la loi sur les espèces inscrites à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Grâce à des partenariats renforcés avec d’autres ministères, les provinces et les territoires, ECCC a cerné des sources et des méthodes permettant de perturber et de décourager le commerce illégal d’espèces sauvages, en se concentrant sur l’obtention d’un accès à des bases de données supplémentaires de renseignements sur ce commerce.
Le Ministère a collaboré avec des partenaires aux États-Unis et au Mexique pour entreprendre une évaluation continentale de la biodiversité et des changements climatiques. Misant sur l’expertise des trois pays participants dans divers secteurs, ces travaux mèneront à une meilleure compréhension des façons dont les changements climatiques affectent la biodiversité et comprendront une évaluation des options stratégiques potentielles pour atténuer les impacts. Un rapport final est attendu en 2025.
Les peuples autochtones sont impliqués dans la conservation
Établissement de tables sur la nature fondées sur les distinctions
ECCC a collaboré avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour élaborer conjointement trois tables autochtones sur la nature fondées sur les distinctions dans le cadre de son nouveau modèle de mobilisation externe sur la nature. L’élaboration conjointe s’est poursuivie avec les partenaires inuits, et la table sur la nature des Premières Nations ainsi que la table sur la nature Strawberry Moon (Nation métisse) ont été établies, ce qui a donné au gouvernement du Canada et à ces partenaires autochtones la possibilité de commencer à déterminer les priorités communes de chaque table. ECCC est resté attaché à mobiliser significativement les peuples autochtones en mettant en œuvre des programmes qui ont appuyé la réconciliation et les mesures dirigées par les Autochtones en vue d’obtenir des résultats en matière de conservation. Le Ministère a continué de travailler au renouvellement des relations de nation à nation avec les peuples autochtones dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada et de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Dans le cadre du Fonds de la nature du Canada, les partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont fait progresser la conservation des espèces en péril d’une manière qui reconnaissait et permettait le leadership, les systèmes de connaissances et les intérêts des Autochtones en matière de gestion des terres. En 2023-2024, les projets ont contribué à renforcer la capacité des partenaires autochtones :
- à diriger l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de rétablissement et de protection pour les espèces en péril (y compris plusieurs espèces de caribous d’importance culturelle);
- à négocier et à mettre en œuvre des accords de conservation pour la conservation collaborative des espèces en péril;
- à soutenir une participation significative aux processus de consultation et de coopération de la Loi sur les espèces en péril.
Gardiens autochtones
ECCC a continué de mettre en œuvre l’investissement de 173 millions de dollars sur cinq ans dans les gardiens autochtones, qui appuie l’intendance des Autochtones dans la protection et la conservation des écosystèmes, l’autodétermination, le statut de nation et la réconciliation. Depuis 2021, cet investissement soutient les initiatives de gardiens nouvelles et existantes dirigées par des Autochtones ainsi que la création de réseaux nationaux de gardiens autochtones. Le financement des gardiens autochtones est prévu et offert conjointement avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis selon une approche fondée sur les distinctions. Le Ministère aide les nations, les collectivités et les organisations autochtones à protéger les zones et les espèces sensibles et importantes sur le plan culturel, à surveiller la santé écologique, à développer et à maintenir des économies durables, et à préserver les liens profonds entre les paysages naturels et les cultures autochtones.
Apprendre des partenaires autochtones
Les gardiens autochtones sont les yeux et les oreilles sur le terrain dans les territoires autochtones. Ils surveillent la santé écologique, entretiennent les sites culturels et protègent les zones et les espèces sensibles. Les initiatives des gardiens aident les peuples autochtones à protéger les terres, les eaux et les glaces dans leurs territoires traditionnels au moyen d’initiatives d’intendance communautaires sur le terrain. Les gardiens autochtones favorisent également le bien-être social et communautaire en misant sur les liens avec la terre et les eaux, la culture, la langue, la transmission intergénérationnelle de connaissances, ainsi que le développement et le maintien d’économies durables.
Le Réseau national des gardiens des Premières Nations constitue un mécanisme dirigé par les Premières Nations pour rationaliser le financement des gardiens au fil du temps, et un moyen pour les gardiens de communiquer les uns avec les autres afin de mettre en commun les pratiques exemplaires et d’accélérer le renforcement des capacités. Grâce à lui, le nombre d’initiatives de gardiens couronnées de succès continuera d’augmenter dans tout le pays, ce qui assurera la protection des écosystèmes, des espèces et des cultures pour les générations futures et à l’avantage de tous les Canadiens.
En 2023-2024, ECCC a continué de soutenir les communautés autochtones pour intégrer le savoir autochtone à quatre évaluations régionales menées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact :
- Forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador;
- Région du Cercle de feu en Ontario;
- Voie maritime du Saint-Laurent au Québec;
- Évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.
Ce travail a aidé à ce que les conseils d’ECCC tiennent mieux compte des droits, des valeurs et des intérêts des Autochtones en matière de décision. De plus, les efforts se sont poursuivis pour intégrer les connaissances traditionnelles autochtones aux évaluations des espèces faites par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Autres résultats ministériels
Les agents du Ministère chargés de l’application de la loi sur le terrain ont continué de vérifier la conformité aux lois sur les espèces sauvages et aux règlements connexes qui protègent les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, les espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce et les 177 milieux protégés d’ECCC. En collaboration avec ses partenaires, ECCC a continué d’établir l’ordre de priorité de ses activités en fonction du risque et des répercussions de la non-conformité, y compris pour les secteurs et les espèces préoccupantes qui sont vulnérables aux activités illégales.
Les inspections d’ECCC ont donné lieu à 153 nouvelles enquêtes en vertu de la réglementation sur les espèces sauvages et à la prise de 611 mesures d’application de la loi, y compris des avertissements, des sanctions administratives pécuniaires (SAP), des poursuites, des contraventions, des ordres d’exécution et des arrestations. Les enquêtes ont abouti à 10 condamnations et à 24 nouvelles poursuites. En 2023-2024, un total de 498 500 dollars en pénalités a résulté de poursuites. De plus, les sanctions pécuniaires découlant des SAP ont totalisé 242 450 dollars.
Le Ministère a continué de renforcer les capacités en intégrant et en formant les agents d’application de la loi nouvellement recrutés, et en offrant une formation de renouvellement de l’accréditation aux agents d’application de la loi désignés existants.
Principaux risques
Les efforts de conservation et de rétablissement de la nature d’ECCC sont fondés sur la science occidentale et autochtone. Il existe un risque que le Ministère soit incapable d’exploiter les sources d’information disponibles pour soutenir la prise de décisions fondées sur des données probantes en temps opportun, si le Ministère n’est pas en mesure d’accéder aux outils scientifiques et informatiques appropriés pour recueillir, communiquer et analyser les données à sa disposition, dont les volumes sont de plus en plus complexes. Pour atténuer ce risque, ECCC a continué d’investir dans son infrastructure de TI, y compris les technologies émergentes et des solutions infonuagiques.
Il existe également un risque que le Ministère ait de la difficulté à attirer, à former et à maintenir en poste des employés qualifiés pour soutenir ses efforts de conservation et de rétablissement, en partie en raison d’un marché du travail hautement concurrentiel et en transformation, ainsi que des défis dans les processus du Ministère liés à la planification de la relève, à la classification et à la dotation. Pour atténuer ce risque, ECCC a continué, en 2023-2024, de mettre en œuvre des stratégies de recrutement ciblées dans des domaines clés et d’harmoniser ces stratégies grâce à des initiatives de planification des ressources humaines, de planification de la relève et de gestion des talents, afin de maintenir en poste et d’attirer une main-d’œuvre qualifiée.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 6 : Aperçu des ressources requises pour Conservation de la nature
Le tableau 6 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.
| Ressources | Prévues | Réelles |
|---|---|---|
| Dépenses | 677 409 744 $ | 720 108 036 $ |
| Équivalents temps plein | 1 243 | 1 568 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Priorités pangouvernementales connexes
Analyse comparative entre les sexes Plus
ECCC a continué de travailler à l’atteinte des objectifs de protection et de rétablissement des espèces, tout en reconnaissant que les réserves et les terres des Autochtones offrent souvent un refuge important aux espèces en péril et aux oiseaux migrateurs et que les peuples autochtones du Canada sont également les détenteurs de connaissances traditionnelles autochtones essentielles à l’atteinte de ces objectifs. Afin de réduire la lassitude à l’égard des consultations, résultat de la collecte répétée de connaissances traditionnelles autochtones sur les espèces, le Ministère a axé ses efforts sur des approches de conservation écosystémiques et plurispécifiques, et sur l’amélioration de la coordination entre les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Tout en travaillant à respecter les engagements du Canada en matière de biodiversité, ECCC s’est efforcé d’accroître sa capacité à conserver la biodiversité au Canada, notamment en augmentant la participation des communautés autochtones aux initiatives de conservation. Par le processus d’évaluation fédéral, le Ministère a continué de fournir des conseils d’experts et des connaissances pour appuyer les décisions relatives à l’exploitation des ressources qui atténuent les répercussions négatives sur les populations touchées de façon disproportionnée et sur tous les Canadiens. ECCC a également continué d’améliorer ses pratiques d’embauche pour accroître la représentation de la population canadienne au sein de son effectif d’application de la loi.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et Objectifs de développement durable des Nations Unies
Plus de renseignements sur l’apport d’ECCC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable.
Innovation
Investir dans la nature et les solutions climatiques naturelles
Afin d’aider le Canada à mieux progresser vers l’atteinte des objectifs de conservation, nous avons sondé 97 organismes de conservation de partout au Canada au sujet de leur expérience du Programme des dons écologiques et de leur connaissance des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Cette étude a révélé que pour ces organisations, les principaux obstacles à la prise en charge et à la gestion des terres sont le manque de capacité et de temps, ainsi que les contraintes financières. Les organisations font état d’expériences très positives avec le Programme des dons écologiques, mais ont de la difficulté à joindre et à cerner les donateurs potentiels au programme. De plus, elles ont signalé de faibles niveaux d’expérience, de sensibilisation et de compréhension en ce qui concerne les AMCEZ. Les résultats de l’étude ont aidé à formuler des recommandations visant à améliorer les communications afin d’accroître la transparence du programme en ce qui concerne les exigences de temps et les étapes à suivre. Ils ont également fourni des renseignements précieux aux gestionnaires de programme sur la façon de joindre les donateurs plus efficacement.
Répertoire des programmes
La responsabilité essentielle Conservation de la nature est appuyée des programmes suivants :
- Espèces en péril
- Oiseaux migrateurs et autres espèces sauvages
- Conservation et protection des habitats
- Politiques et partenariats sur la biodiversité
- Évaluation environnementale
- Promotion de la conformité et application de la loi – Faune
Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour Conservation de la nature se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
Description
Fournir des prévisions, des avertissements, des données et des services d’information faisant autorité en matière de conditions météorologiques, hydrologiques et environnementales en utilisant un large éventail de systèmes de diffusion pour aider les Canadiens, les autorités publiques et les secteurs ciblés sensibles aux conditions météorologiques à prendre des décisions éclairées en matière de santé, de sécurité et de prospérité économique. Pour y parvenir, il faudra : surveiller les conditions météorologiques, la quantité d d’eau, les glaces, la qualité de l’air et le climat; mener des activités de recherche et de développement visant une amélioration continue; exploiter des modèles intégrés avancés de prévision météorologique et environnementale à l’aide de plateformes de calcul à haute performance; échanger des données en temps quasi réel, de façon continue, avec les membres de l’Organisation météorologique mondiale afin de garantir des prévisions précises et opportunes; et collaborer étroitement avec les institutions météorologiques et hydrologiques d’autres pays, ainsi qu’avec les organisations internationales, afin d’améliorer les services offerts aux citoyens où qu’ils se trouvent.
Progrès à l’égard des résultats
Cette section présente les mesures prises par le ministère pour atteindre les résultats et les cibles relativement à Prévisions des conditions météorologiques et environnementales. Les renseignements sont présentés par résultat ministériel.
Tableau 7 : Cibles et résultats relativement à Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
Le tableau 7 fournit un résumé des cibles et des résultats réels pour chaque indicateur associé aux résultats liés à Prévisions des conditions météorologiques et environnementales.
| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Indice de rapidité et de précision des avertissements de temps violent sur une échelle de 0 à 10 | Au moins 8,4 | Juin 2024 | 2021-2022 : 8,8Note de bas de page 39 2022-2023 : 8,7Note de bas de page 40 2023-2024 : 8,7Note de bas de page 41 |
| Pourcentage des partenaires du programme qui donne une note de satisfaction des services hydrologique d’ECCC de 8 sur 10 ou plus | 80 % | Mai 2024Note de bas de page 42 | 2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2022-2023. La première année de déclaration sera pour 2022-2023. 2022-2023 : 69 % 2023-2024 : 91 % |
Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC.
Renseignements sur les résultats
La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à Prévisions des conditions météorologiques et environnementales en 2023‑2024 en les comparant aux résultats prévus dans le Plan ministériel d’ECCC pour l’exercice.
Les Canadiens utilisent des renseignements météorologiques et des informations connexes faisant autorité pour prendre des décisions éclairées pour leur santé et leur sécurité
Surveillance et prévisions météorologiques de grande qualité en temps opportun
ECCC a continué d’améliorer ses services météorologiques grâce à son expertise scientifique, à l’application d’une approche de pointe en matière de gestion des données et à l’accent continu que le Ministère met sur les besoins changeants de ses clients et des intervenants. À mesure que le climat continue de changer, causant des événements météorologiques à fortes répercussions plus fréquents et plus intenses, la prestation de services météorologiques de grande qualité en temps opportun est devenue de plus en plus importante. En 2023-2024, ECCC a continué de fournir des services de prévision en tout temps à ses clients et partenaires. Cette capacité de prévision en tout temps est ce qui permet d’anticiper les événements météorologiques et environnementaux suffisamment à l’avance pour communiquer de l’information et réagir à la menace.
Les météorologues et les scientifiques du Ministère, qui travaillent dans des centres de prévision et des groupes scientifiques partout au pays, transforment les résultats des modèles de prévision numériques exécutés sur le système de calcul de haute performance d’ECCC en avertissements, prévisions et conseils d’experts sur les conditions météorologiques, hydriques et environnementales. Les autorités publiques, comme les gestionnaires de mesures d’urgence et les autorités de l’aviation civile, de même que le public canadien, s’y fient pour prendre des décisions.
Calcul de haute performance
Le système de calcul de haute performance du Canada se compose de superordinateurs figurant parmi les plus rapides au monde. Il est utilisé pour exécuter des modèles mathématiques de l’atmosphère et des océans afin de prédire les conditions météorologiques et de faire des projections du climat futur. Il permet à ECCC de se fonder quotidiennement sur environ 13 millions d’observations provenant du Canada et du monde entier pour prévoir les conditions météorologiques et environnementales à l’aide de ses systèmes de prévision numériques. Grâce aux progrès technologiques et scientifiques, ECCC a pu aller au-delà des prévisions météorologiques traditionnelles et s’intéresser à d’autres applications environnementales, comme les prévisions relatives à la qualité de l’air, à l’hydrologie, à l’océanographie, à la glace de mer, aux vagues et au niveau des eaux côtières. Par exemple, il prévoit maintenant les concentrations d’oxydes d’azote, d’ozone et de particules nocives découlant des feux de forêt qui contribuent à une mauvaise qualité de l’air et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Le Ministère fournit également des prévisions climatiques saisonnières jusqu’à un an à l’avance.
Le Ministère a continué d’investir dans la modernisation de l’infrastructure et d’innover pour améliorer ses systèmes de surveillance et de prévisions météorologiques et environnementales. ECCC a continué d’investir dans des modèles de prévisions météorologiques et environnementales, notamment pour les inondations et les conditions météorologiques à fortes répercussions, ainsi que pour l’élaboration d’un système national de prévision hydrologique. Le Ministère a également continué de mettre à l’essai et d’employer des innovations techniques pour la surveillance, par exemple en améliorant la durabilité environnementale des réseaux d’observation d’ECCC grâce à l’essai de nouveaux capteurs lidars et de solutions d’alimentation hors réseau. Des investissements dans la capacité d’essai des laboratoires et des sites sur le terrain ont été faits pour accélérer l’adoption de nouvelles technologies.
Le Ministère a poursuivi la modernisation de son réseau de surveillance de la haute atmosphère en installant des systèmes automatisés modernes de lancement de ballons météorologiques. À ce jour, six systèmes ont été déployés dans le pays. Les activités quotidiennes sur ces sites ne nécessitent plus d’interventions manuelles de la part des opérateurs contractuels. À présent, le système ne requiert qu’une visite mensuelle pour préparer les lancements à venir, de sorte que les activités sur ces sites sont moins susceptibles d’être affectées par les ordres d’évacuation locaux. De plus, les demandes de données supplémentaires des partenaires pour le suivi des ouragans, des tempêtes violentes ou des feux de forêt peuvent maintenant être traitées à distance avec les systèmes automatisés.
Aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées sur les conditions météorologiques
Les feux de forêt qui ont battu des records en 2023 ont donné aux Canadiens une véritable expérience des vastes répercussions des changements climatiques sur leur vie quotidienne. En effet, la saison des feux de forêt de 2023 et la mauvaise qualité de l’air qui en a résulté au Canada ont mis en évidence les risques des changements climatiques pour la santé et la sécurité de nombreux Canadiens. La fréquence et l’intensité de ces phénomènes météorologiques importants perturbés par les changements climatiques ont continué d’augmenter.
ECCC a continué de tirer parti des médias sociaux et des alertes d’urgence pour informer les Canadiens et les aider à prendre des décisions éclairées afin d’atténuer les risques liés aux conditions météorologiques et aux changements climatiques pour la vie, les biens et l’environnement. Ses systèmes de prévisions météorologiques à la fine pointe de la technologie ont continué d’alerter les Canadiens de l’approche de phénomènes météorologiques à fortes répercussions, comme les tempêtes violentes, les vagues de chaleur, les rivières atmosphériques, les blizzards et les ouragans. Plus précisément, les Canadiens ont continué d’avoir accès à des prévisions et à des avertissements à jour sur le site Web météorologique d’ECCC et l’application MétéoCAN, et par l’abonnement aux bulletins électroniques sur les ouragans d’ECCC. Les météorologues ont continué de concentrer leur attention sur les événements météorologiques qui ont touché le Canada, comme la saison historique des feux de forêt de 2023 et la tempête post-tropicale Lee qui a traversé le Canada atlantique en septembre 2023. Les deux événements ont été coûteux et mortels, et ont montré l’importance de fournir des prévisions et des avertissements précis en temps opportun.
De plus, ECCC a continué de mettre au point des produits météorologiques adaptés pour son application MétéoCAN, notamment une option offrant aux Canadiens de fixer le niveau de risque lié à la qualité de l’air pour lequel ils souhaitent recevoir un avis de l’application. Conjointement avec la fonctionnalité de diffusion immédiate d’EnAlerte et le service téléphonique automatisé Bonjour Météo, les outils d’ECCC ont continué de fournir aux Canadiens de l’information sur les phénomènes météorologiques à fortes répercussions.
Diffusion des données météorologiques
Chaque jour, ECCC répond à 65 à 75 millions de demandes automatisées de données météorologiques et environnementales et de produits de données générés à l’interne. Les plateformes de données ouvertes du Ministère permettent aux particuliers et aux entreprises du Canada d’accéder aux observations météorologiques et environnementales et aux données des modèles de prévision. Les données diffusées par ces plateformes sont exploitées pour effectuer des enquêtes, concevoir des innovations favorisant la croissance économique et l’efficacité, et prendre des décisions opérationnelles concernant la santé, la sécurité et la préservation des biens. Afin de servir ses clients et ses partenaires, le Ministère a continué d’améliorer l’accessibilité et la fiabilité de son offre de données.
Le Ministère a amélioré la diffusion des données météorologiques au Canada et dans la communauté internationale. En 2023-2024, ECCC a été l’architecte principal de l’élaboration et de la mise en œuvre du nouveau système d’information de l’Organisation météorologique mondiale (WIS 2.0), qui est le système par lequel tous les centres météorologiques nationaux du monde entier communiquent leurs données. S’appuyant sur les leçons tirées de l’offre par le Ministère de données ouvertes sur les prévisions météorologiques et environnementales, le WIS 2.0 permet aux services météorologiques du monde entier d’échanger des données et des renseignements fiables de manière simple, transparente et rapide. Ce nouveau système a amélioré la capacité des pays en développement à communiquer leurs données, renforçant ainsi le leadership du Canada au sein de la communauté internationale des prévisions météorologiques.
Programme de remplacement des radars météorologiques
ECCC a terminé le Programme de remplacement des radars météorologiques gouvernement du Canada d’une valeur de 180,4 millions de dollars qui visait à remplacer la technologie désuète par 33 nouveaux radars de pointe. En date du 31 mars 2024, les 33 nouveaux radars à double polarisation en bande S étaient entièrement intégrés au processus de prévision. Les radars sont les principaux outils utilisés par les météorologues pour prévoir les phénomènes météorologiques violents à court terme associés aux orages, aux tornades, aux tempêtes de verglas et aux blizzards. Les nouveaux radars utilisent la technologie la plus moderne disponible pour fournir des renseignements plus détaillés sur le type de précipitations et la structure des tempêtes, et permettront à ECCC de donner aux Canadiens plus de temps pour se protéger et protéger leurs biens. Avec les nouveaux radars, la zone de couverture est passée d’un peu plus d’un million de kilomètres carrés à plus de quatre millions de kilomètres carrés, ce qui fait en sorte que 99 % des Canadiens vivent à moins de 330 kilomètres d’un radar canadien.
Technologies émergentes dans les prévisions météorologiques
ECCC surveille de près le développement de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (AM) dans le domaine de la modélisation et de la prévision des conditions météorologiques. Les modèles fondés sur l’IA pourraient produire certains types de prévisions qui se comparent favorablement aux modèles conventionnels de prévisions météorologiques. Par conséquent, ECCC explore ces modèles et les compare aux modèles conventionnels. En 2023-2024, le Ministère a élaboré une feuille de route sur l’IA qui décrit la voie à suivre pour intégrer l’IA aux systèmes de prévisions météorologiques et environnementales, dans le but d’améliorer ses services d’information et d’avertissement météorologiques de haute qualité en temps opportun. Par exemple, les modèles fondés sur l’IA ou l’AM pourraient être intégrés de manière hybride à des modèles physiques conventionnels pour vérifier, enrichir et améliorer les prévisions. L’intégration et l’utilisation de ces technologies seront conformes aux lignes directrices pangouvernementales pour l’utilisation responsable de l’IA.
Investir dans la surveillance de l’eau pour les Canadiens
Étant donné que les changements climatiques augmentent la fréquence des sécheresses et des inondations, ECCC a investi dans la modernisation de la surveillance nationale de l’eau pour les Canadiens. La surveillance systématique des niveaux et des débits d’eau a toujours été une priorité au Canada et a continué d’être de plus en plus importante, car le climat canadien se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Un climat plus chaud signifie un plus grand nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations. ECCC a fourni des données et des renseignements de grande qualité sur les niveaux et les débits d’eau en temps réel à des partenaires provinciaux et territoriaux, comme des organismes de gestion des urgences, des organismes de prévision des débits et l’industrie. Ces données, ainsi que les archives de données hydrologiques à long terme, ont aidé ces intervenants à se préparer aux événements météorologiques, comme les inondations et les sécheresses, et à devenir plus résilients aux conséquences des changements climatiques.
Grâce à un investissement de 89,9 millions de dollars qui a commencé en 2018, les Services hydrologiques nationaux d’ECCC ont terminé la modernisation et l’amélioration prévues de leur programme de surveillance de la quantité d’eau afin d’appuyer plus efficacement la gestion de l’évolution des ressources en eau du Canada. Cet investissement visait quatre volets principaux, qui se sont terminés en mars 2023 (Renforcement des capacités et Prévisions) et en mars 2024 (Infrastructure et Innovation). En 2023-2024, ECCC a commencé à offrir de nouveaux produits de prévisions liées à l’eau pour aider les partenaires provinciaux et territoriaux à publier de meilleures prévisions des inondations et des sécheresses.
De nouveaux investissements ont permis d’appliquer une approche continue de gestion du cycle de vie pour entretenir l’infrastructure hydrométrique et améliorer la conformité environnementale. En 2023-2024, les Services hydrologiques nationaux ont réparé ou remplacé plus de 270 téléphériques hydrométriques et assaini plus de 60 sites où l’environnement était contaminé. Ils ont également permis de mettre en œuvre des technologies novatrices qui ont amélioré l’efficacité et la qualité des données. Huit nouvelles technologies de terrain sont passées de la phase de conception à celle de mise en œuvre (p. ex. caméras de station et systèmes de télémétrie améliorés pour les stations), et trois d’entre elles sont devenues pleinement opérationnelles (p. ex. services de données infonuagiques).
Le Ministère a continué de rehausser la pertinence, l’efficacité, la capacité et le rendement de ses services hydrologiques nationaux. À la lumière des observations et des recommandations de l’évaluation sommative des Services hydrologiques nationaux de 2023, ECCC s’est engagé à améliorer la mobilisation des groupes autochtones et la collaboration avec eux aux fins de la gestion du programme. En 2023-2024, le Ministère a commencé à élaborer une stratégie de mobilisation des Autochtones pour le programme.
Soutenir les Canadiens en cas d’urgence
En 2023-2024, ECCC a continué de travailler avec les partenaires pour appuyer la Stratégie de sécurité civile pour le Canada, la cartographie des inondations et d’autres efforts de préparation et de résilience aux urgences. Le Ministère a soutenu la priorité du gouvernement du Canada d’améliorer la résilience des collectivités les plus exposées aux inondations en contribuant à diverses initiatives de la Stratégie de sécurité civile de 2019. Le Ministère a terminé l’élaboration d’un système national de prévision capable de produire des prévisions et des alertes en cas d’inondation côtière, en réponse à la fréquence et à la gravité croissantes des ondes de tempête. Ce système fournira des prévisions fondées sur une plage de niveaux d’eau potentiels afin de permettre aux collectivités de mieux se préparer aux répercussions possibles des inondations côtières. ECCC a également terminé la mobilisation de quatre provinces, et il est prévu que la gamme de produits sera prête à être offerte en 2024.
De plus, le Ministère fournit un soutien scientifique et technique à Ressources naturelles Canada en ce qui a trait à la détermination des inondations et à la cartographie des dangers. Des accords de financement ont appuyé la recherche visant à faire progresser la cartographie des plaines inondables et l’élaboration de nouvelles lignes directrices techniques pour renforcer la capacité scientifique de cartographie des plaines inondables au Canada. Dans le cadre de la Stratégie nationale d’adaptation (SNA), publiée en juin 2023, le gouvernement du Canada a investi 164,2 millions de dollars supplémentaires pour fournir cinq années de financement supplémentaires à des projets visant à augmenter la couverture cartographique des inondations à l’échelle nationale et à communiquer les renseignements accessibles sur les risques d’inondation avec les Canadiens. Trois millions de dollars en financement de la SNA ont été accordés sous forme de subventions et de contributions à des universités et à des organismes à but non lucratif. En date d’avril 2024, 21 accords avaient été conclus pour plus de 200 projets, dans plus de 300 endroits à risque élevé au Canada.
Fournir des conseils d’experts sur l’eau
ECCC a également continué de fournir des conseils d’experts et des recommandations aux offices intergouvernementaux et internationaux des eaux. En 2023-2024, Le Ministère a continué de fournir un leadership et un soutien technique à des offices et à des comités internationaux des eaux. Ces activités donnent suite aux engagements pris dans le protocole d’entente avec la Commission mixte internationale (CMI) ainsi que dans d’autres protocoles d’entente interprovinciaux et internationaux. ECCC fournit un soutien en matière de données, de techniques, d’ingénierie et de communication aux conseils et comités de la CMI, et participe en tout à 17 conseils et comités de la CMI, à 3 comités internationaux non-membres de la CMI et à 3 organismes canadiens de gestion des eaux.
Principaux risques
Pour s’acquitter de son mandat et fournir aux Canadiens des services de prévisions météorologiques et environnementales essentiels à la mission, le Ministère compte sur ses immobilisations et son infrastructure technologique, qui nécessitent un entretien et des investissements durables pour éviter la détérioration, maximiser les avantages des progrès technologiques, assurer la fonctionnalité dans le contexte de systèmes de plus en plus complexes et de notre climat en évolution, et répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Pour se prémunir contre les risques dans ces domaines, ECCC a investi considérablement dans son infrastructure et amélioré ses capacités de planification afin de mieux évaluer les déficits à l’échelle de l’organisation, d’harmoniser les besoins de financement avec les priorités et de garantir l’expertise. En parallèle, le Ministère a investi dans l’élargissement des partenariats et de la collaboration externe pour accéder aux données d’autres fournisseurs.
La capacité du Ministère d’accéder à des données de plus en plus volumineuses et complexes, de les recueillir, de les communiquer, de les analyser et de les utiliser est également essentielle pour soutenir les activités de base et assurer la mise à disposition en temps opportun de renseignements et de services météorologiques, environnementaux et hydrologiques de calibre mondial pour les Canadiens. L’accès continu à une infrastructure de calcul de haute performance permet à ECCC d’exploiter les systèmes de modélisation complexes sur lesquels reposent les avis et avertissements météorologiques, climatiques et liés aux conditions météorologiques qui sont essentiels à la mission et qu’il diffuse en tout temps. En 2023-2024, pour se prémunir contre tout risque qui pourrait entraver ces capacités, ECCC a continué d’investir dans le calcul de haute performance, a exploré et mis en œuvre des stratégies pour améliorer la gouvernance et la transparence des données, a permis une structure de données durable et a promu une culture des données dans l’ensemble de l’organisation. Le Ministère a également envisagé d’acquérir des systèmes et des outils de gestion de l’information qui peuvent améliorer la gestion des données et permettre l’exploration des données, l’interopérabilité des directions générales et l’échange d’information entre les directions générales.
ECCC est la source d’information faisant autorité en ce qui concerne les conditions météorologiques, la quantité d’eau, le climat, la glace et la qualité de l’air au Canada. Il est essentiel de fournir aux Canadiens des renseignements exacts et opportuns, y compris des prévisions et des avertissements, pour maintenir cette réputation. De ce fait, le Ministère s’est assuré de continuer à suivre un cycle de planification régulier pour des investissements périodiques axés sur les domaines prioritaires et un système rigoureux de gestion de la qualité certifié par l’Organisation internationale de normalisation.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 8 : Aperçu des ressources requises pour Prévisions des conditions météorologiques et environnementales
Le tableau 8 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.
| Ressources | Prévues | Réelles |
|---|---|---|
| Dépenses | 229 586 460 $ | 281 191 207 $ |
| Équivalents temps plein | 1 566 | 1 733 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Priorités pangouvernementales connexes
Analyse comparative entre les sexes Plus
ECCC a continué d’adapter ses prévisions météorologiques, ses avertissements et ses conseils d’experts concernant les phénomènes météorologiques extrêmes et les événements environnementaux (comme les inondations, les vagues de chaleur et les feux de forêt) aux besoins des Canadiens, y compris les habitants des régions nordiques et rurales, les Canadiens âgés et les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation d’itinérance. Afin d’améliorer la portée de son information, le Ministère a adopté des stratégies pour mieux communiquer les risques à un large éventail de Canadiens et préparer ces derniers aux répercussions potentielles des conditions météorologiques dangereuses. ECCC a continué de fournir de l’information météorologique et environnementale au moyen d’une vaste gamme de plateformes, notamment l’application MétéoCAN, le site Web sur la météo, le système téléphonique automatisé Bonjour Météo et les radios météorologiques. Les autorités provinciales et territoriales, les collectivités nordiques, autochtones et éloignées et d’autres clients spécialisés ont également utilisé les données hydrométriques d’ECCC combinées à des données socioéconomiques pour déterminer les répercussions potentielles des dangers liés à l’eau sur divers groupes et mettre en œuvre des mesures d’atténuation en conséquence. De plus, le Ministère a continué d’améliorer l’accessibilité et la documentation de ses données et services météorologiques et environnementaux, en fonction des résultats de la mobilisation des intervenants.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et Objectifs de développement durable des Nations Unies
Plus de renseignements sur l’apport d’ECCC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable.
Répertoire des programmes
La responsabilité essentielle Prévisions des conditions météorologiques et environnementales est appuyée des programmes suivants :
- Observations, prévisions et avertissements météorologiques et environnementaux
- Services hydrologiques
Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour Prévisions des conditions météorologiques et environnementales se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.
Services internes
Description
Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse respecter ses obligations intégrées et exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes :
- services de gestion et de surveillance;
- services de communication;
- services juridiques;
- services de gestion des ressources humaines;
- services de gestion des finances;
- services de gestion de l’information;
- services des technologies de l’information;
- services de gestion des biens immobiliers;
- services de gestion du matériel;
- services de gestion des acquisitions.
Progrès à l’égard des résultats
Cette section présente les mesures prises par le ministère pour atteindre les résultats et les cibles en ce qui a trait aux services internes.
Accessibilité
ECCC a continué de fournir des conseils et une orientation sur l’adaptation, la prise en charge des handicaps et les outils d’accessibilité à ses employés. À la suite de la publication du plan d’accessibilité du Ministère en 2022, les employés d’ECCC ont été invités en avril 2023 à participer à un sondage sur l’accessibilité afin de recueillir des commentaires et de déterminer les prochaines étapes pour accroître la sensibilisation et améliorer l’accessibilité. En janvier 2024, le Ministère a publié son rapport d’étape de 2023 sur la mise en œuvre de son plan d’accessibilité, ce qui a aidé à évaluer l’engagement des employés à exécuter le plan. La collaboration permettant de mettre en commun les expériences, les méthodes et les outils est avantageuse pour tout le monde et aide à éliminer les obstacles et à favoriser l’inclusion.
Renforcer le Ministère grâce à la diversité
Le Ministère a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie sur la diversité, l’inclusion et l’équité en matière d’emploi. ECCC a continué de collaborer avec des réseaux et des comités dirigés par les employés qui défendent et soutiennent les politiques et les initiatives enrichissant la diversité, l’inclusion et l’équité en matière d’emploi dans l’ensemble de l’organisation, et qui contribuent à celles-ci. Cette collaboration a donné lieu au lancement du calendrier culturel et commémoratif d’ECCC, qui témoigne de notre volonté à célébrer la riche mosaïque de diversité culturelle qui existe parmi nous et qui enrichit nos expériences collectives. Ce calendrier fait connaître d’importantes dates culturelles et commémoratives tout au long de l’année, aidant à promouvoir diverses traditions et divers moments d’importance pour les nombreuses communautés qui composent le Ministère.
Le deuxième rapport annuel sur la Stratégie sur la diversité, l’inclusion et l’équité en matière d’emploi pour 2021-2024 a été mis à la disposition des employés d’ECCC en novembre 2023. Il offre des données complètes sur toutes les mesures prises par ECCC, donnant une image claire des progrès réalisés par le Ministère par rapport aux engagements énoncés, qui portent sur le recrutement, le perfectionnement et le maintien en poste des employés, l’éducation et la sensibilisation, et le soutien à la gouvernance.
ECCC a continué de mettre en œuvre et de renouveler son plan d’embauche des Inuits conformément au Plan d’embauche des Inuits pangouvernemental. Le Ministère a établi des objectifs importants et pris des mesures concrètes pour se conformer aux obligations de l’article 23 de l’Accord du Nunavut.
Le Ministère a également continué de promouvoir la présence des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) par l’intermédiaire d’un Comité des femmes en sciences et en technologie revigoré qui a vu ses membres augmenter en nombre pour inclure tous les genres et représenter tous les secteurs du Ministère à l’administration centrale et dans les régions.
Appuyer nos fonctionnaires
ECCC a continué de soutenir les employés touchés par l’initiative pangouvernementale de transformation de l’administration de la paye et a aidé Services publics et Approvisionnement Canada à s’attaquer à l’arriéré des problèmes de rémunération. Le Ministère a continué de contribuer aux efforts pangouvernementaux de stabilisation des ressources humaines à la paye, y compris diverses initiatives en matière de ressources humaines et de système de paye.
Le Ministère a continué de s’adapter à un milieu de travail post-COVID-19 en harmonisant les politiques sur le lieu de travail aux directives de santé publique et en continuant d’investir dans sa transformation numérique. Au début de la pandémie, ECCC a mis en œuvre des stratégies pour renforcer sa transformation numérique afin de soutenir le travail virtuel. Le Ministère a notamment investi dans sa connectivité réseau et dans l’utilisation intensive de MS 365 et des outils de collaboration infonuagiques.
Renouvellement de la stratégie relative aux données et à l’analyse
Dans le cadre de son objectif de devenir une organisation davantage axée sur les données, ECCC a réalisé des progrès importants vers le renouvellement de sa stratégie relative aux données et à l’analyse en 2023-2024. Ayant terminé l’évaluation de son paysage de données actuel et formulé une nouvelle vision pour l’avenir, le Ministère élabore sa nouvelle stratégie, qui sera harmonisée aux derniers développements en matière de données, d’analyse et d’intelligence artificielle, y compris la Stratégie relative aux données de 2023-2026 pour la fonction publique fédérale. La stratégie renouvelée devrait être publiée et lancée en 2024-2025.
Modernisation des services numériques
En 2023-2024, le Ministère en était à la troisième année d’une feuille de route quinquennale pour la modernisation numérique qui vise quatre objectifs : moderniser les services pour les rendre numériques; devenir une organisation axée sur les données; activer les plateformes de ressources numériques; et avoir une main-d’œuvre moderne. Plusieurs investissements dans l’initiative de plateforme de l’organisation avaient été priorisés pour moderniser les principaux domaines d’intérêt à l’appui de vastes capacités opérationnelles, telles que les rapports réglementaires et la gestion des intervenants.
ECCC a lancé sa Boîte à outils d’accessibilité numérique en février 2024. La Boîte à outils est le résultat d’un effort déployé par plusieurs organisations du gouvernement du Canada pour fournir un répertoire complet de connaissances, d’outils et de pratiques exemplaires visant à rendre le contenu numérique et les communications du Ministère universellement accessibles. Qu’il s’agisse de créer des documents, de coder des pages Web, de concevoir des produits ou simplement d’envoyer des courriels, la Boîte à outils fournit aux employés les ressources essentielles pour veiller à ce que chacun, quelles que soient ses capacités, puisse interagir avec le contenu du Ministère.
Faire progresser la politique jeunesse pour le Canada
En 2023-2024, ECCC et le ministre ont continué de mobiliser les jeunes, par l’intermédiaire du Conseil des jeunes d’ECCC, sur des sujets importants tels que :
- la participation du Canada à la CdP28 de la CCNUCC;
- l’élaboration d’une stratégie de la biodiversité 2030 du Canada;
- les initiatives de communication sur le climat d’ECCC, la conscience de l’environnement, la justice environnementale et le racisme environnemental;
- le Programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes.
Afin de promouvoir et de maintenir une culture de mobilisation significative des jeunes, le Ministère a mis à jour son cadre de mobilisation des jeunes pour 2024-2027, lequel fournit des outils, des conseils, des ressources et des recommandations pratiques sur la façon de mobiliser les jeunes au Canada et au sein du Ministère.
Transition vers la carboneutralité
ECCC est demeuré déterminé à passer à des opérations carboneutres et résilientes au climat, tout en réduisant d’autres effets environnementaux, notamment sur les déchets, l’eau et la biodiversité. Le Ministère a continué de mettre en œuvre des mesures et d’évaluer son rendement pour appuyer l’objectif pangouvernemental de réduire les émissions de GES liées à l’énergie provenant des activités du gouvernement du Canada de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2025. ECCC a également continué de travailler à la transition vers une économie circulaire en détournant au moins 75 % des déchets opérationnels et plastiques non dangereux et 90 % des déchets de construction et de démolition des sites d’enfouissement d’ici 2030, conformément à la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada. ECCC a continué de surveiller les taux de réacheminement des déchets dans les bâtiments et de faire progresser son Plan ministériel d’achats écologiques, qui comprenait la promotion de l’utilisation de plastique durable dans les biens et l’élaboration de critères pour réduire l’impact environnemental des décisions d’approvisionnement. En 2023-2024, le Ministère a offert aux employés une formation sur les pratiques d’achats écologiques et continué de mettre en œuvre le plan d’action ministériel de gestion des déchets afin de réduire la production de déchets opérationnels non dangereux et d’en augmenter le réacheminement.
Le Ministère a également évalué les possibilités de déployer de l’électricité propre sur place dans ses bâtiments, et acheté de l’électricité propre hors site pour aider à atteindre une consommation d’électricité propre de 100 % d’ici 2025 au plus tard. De plus, ECCC a pris des mesures pour réduire la consommation d’énergie dans son parc de véhicules grâce au partage de celui-ci et à l’achat de véhicules zéro émission (VZE), en visant à ce que son parc de véhicules légers soit composé à 80 % de VZE d’ici 2030 et, dans la mesure du possible, en fournissant des bornes de recharge pour VZE dans ses installations.
Assainissement des sites contaminés
ECCC a continué de faire des progrès dans l’évaluation et l’assainissement des sites contaminés dont il est responsable. En 2023-2024, le Ministère a terminé les activités d’évaluation sur 8 sites et les activités d’assainissement et de gestion des risques sur 10 sites.
Amélioration continue
La Stratégie pour les sciences 2024 à 2029 d’ECCC a été publiée en février 2024 pour guider les activités scientifiques du Ministère au cours des prochaines années. La Stratégie a été élaborée dans le cadre d’une mobilisation à l’échelle du Ministère, guidée par les mécanismes de gouvernance scientifique d’ECCC et examinée par les syndicats et d’autres ministères et organismes à vocation scientifique dans les objectifs suivants :
- Appuyer la modernisation et l’amélioration continue de la façon dont le Ministère mène, utilise, encadre et communique la science en son sein afin de suivre l’évolution rapide de l’environnement;
- Tenir compte de l’interconnectivité des divers défis environnementaux et reconnaître la nécessité d’une collaboration et l’importance d’intégrer la science autochtone au même niveau que la science occidentale, afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions efficaces;
- Articuler une nouvelle vision scientifique pour mieux appuyer la réponse du Ministère aux défis environnementaux urgents et la nature horizontale de ses travaux.
L’incidence des efforts scientifiques d’ECCC est également renforcée lorsque l’information et les conseils scientifiques, ainsi que les incertitudes connexes, sont faciles d’accès et faciles à comprendre par les décideurs et le public canadien. S’harmonisant aux efforts pangouvernementaux, l’approche d’ECCC à l’égard d’une science fédérale ouverte et accessible est en place depuis le Plan d’action pour la science ouverte : 2021-2026. Conformément à ces efforts, en janvier 2024, le Ministère a été un chef de file et un contributeur clé au lancement du Dépôt fédéral de science ouverte du Canada, et l’un des premiers ministères et organismes scientifiques participants à y verser un grand nombre de ses publications. Cette plateforme Web héberge les résultats de recherche des ministères et organismes scientifiques participants, fournissant un outil sécurisé et transparent pour accéder aux données scientifiques fédérales sans frais pour les utilisateurs finaux.
En 2023-2024, le Secrétariat du Comité d’avancement professionnel (CAP) d’ECCC a entrepris un examen d’ACS Plus du Cadre de promotion des chercheurs scientifiques, montrant ainsi l’engagement du Ministère à l’égard de la science inclusive et de l’équité. Durant cet examen exhaustif, des renseignements ont été obtenus au moyen de groupes de discussion, de questionnaires en ligne et de réunions avec des gestionnaires de recherche (REM) et des chercheurs scientifiques (RES). Des questions ouvertes et des questions de sondage ont été posées, ce qui aide à comprendre les divers points de vue et expériences. L’examen a permis aux décideurs principaux de reconnaître les obstacles systémiques auxquels font face les groupes visés par l’équité en matière d’emploi dans la communauté RES et REM. Le Secrétariat du CAP a été chargé d’élaborer un plan pour répondre aux principales préoccupations et promouvoir l’équité et l’inclusion à l’avenir.
Soutenir la sensibilisation aux Autochtones
ECCC a travaillé avec le Réseau des employés autochtones et d’autres intervenants dans l’ensemble de l’organisation pour accroître la sensibilisation aux cultures autochtones et faire progresser la réconciliation. En 2023-2024, ECCC a fait la promotion d’activités marquant des occasions commémoratives, comme la Journée nationale des peuples autochtones et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, pour n'en nommer que quelques-unes. Les messages sur la réconciliation avec les Autochtones ont également été intégrés à divers autres produits et activités tout au long de l’année, y compris des événements et des messages de sous-ministres, des articles de presse et plus encore. Tirant parti des voies de communication les plus visibles d’ECCC, ces activités aident à sensibiliser davantage les employés aux cultures autochtones, à la colonisation et à nos engagements à l’égard de la réconciliation, préparant ainsi le terrain pour un travail plus précis visant à mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à ECCC.
Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus
Tableau 9 : Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus en ce qui a trait aux services internes pour l’exercice
Le tableau 9 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des ETP requis pour obtenir ces résultats.
| Ressources | Prévues | Réelles |
|---|---|---|
| Dépenses | 241 892 170 $ | 318 605 055 $ |
| Équivalents temps plein | 1 787 | 1 880 |
Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.
Marchés attribués à des entreprises autochtones
Chaque année, les ministères du gouvernement du Canada doivent respecter la cible de 5 % de la valeur totale des marchés en ce qui concerne l’attribution de marchés à des entreprises autochtones. Cet engagement doit être entièrement mis en œuvre d’ici la fin de l’exercice 2024‑2025.
Environnement et Changement climatique Canada est un ministère faisant partie de la phase 3 qui vise à atteindre la cible minimale de 5 % d’ici la fin de l’exercice 2024-2025.
Le Ministère a déployé des efforts pour s’assurer que les entreprises autochtones se voient attribuer au moins 5 % de la valeur totale de tous les contrats au cours d’un exercice donné. En septembre 2023, ECCC a déclaré pour la première fois avoir attribué 5,5 % de tous les contrats à des entreprises appartenant à des Autochtones ou dirigées par des Autochtones, selon les données de 2022-2023.
Pour 2023-24, le ministère prévoit qu'environ 7 % de tous les contrats auront été attribués à des entreprises autochtones. Cette amélioration par rapport à l'année précédente est le résultat d'un plus grand nombre de contrats réservés ou attribués par incident à des fournisseurs autochtones. ECCC vise à continuer d’atteindre et de dépasser la cible minimale de 5 % en concentrant ses efforts sur certains types de biens et de services, en particulier l’achat d’équipement informatique, les vols affrétés, les services professionnels, le mobilier, la construction et les contrats attribués dans une région géographique assujettie à une entente sur les revendications territoriales globales ou à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
De plus, le Ministère a mis en œuvre une stratégie de communication sur l’approvisionnement, qui comprenait la distribution de divers types de communications aux clients par différents moyens, comme des courriels, des bulletins d’information, des séances de formation sur mesure et des vidéos. Afin d’améliorer davantage la capacité ministérielle et de promouvoir la participation des entreprises autochtones, le Ministère a fait du cours « Considérations autochtones en matière d’approvisionnement » une exigence obligatoire du plan de formation des agents d’approvisionnement. Enfin, les tableaux de bord sur les renseignements opérationnels d’ECCC permettent un suivi continu des contrats attribués aux entreprises autochtones. Ces tableaux de bord accélèrent la reddition de comptes sur l’approvisionnement auprès des Autochtones et aideront à cerner les lacunes et les mesures correctives en la matière.
Contrôles internes et passation de marchés
Alors que le Ministère continue de moderniser et de renforcer son modèle d’exécution pour des services financiers et d’approvisionnement efficaces, les risques inhérents sont pris en compte et des stratégies d’atténuation sont mises en œuvre. Les contrôles clés continuent d’être évalués en :
- Examinant la pertinence des procédures de surveillance établies sur les zones touchées pour améliorer le suivi;
- Restant vigilant concernant les risques de fraude financière et de cybervulnérabilité;
- Documentant et en communiquant les résultats de l’évaluation des processus et des contrôles et aider les employés d’ECCC à y répondre;
- Mettant à jour l’évaluation des risques de fraude d’ECCC et renforcer les contrôles de détection de la fraude en fonction des scénarios identifiés.
De plus, à la suite de la vérification ArriveCan de la vérificatrice générale, ECCC a effectué un examen des contrôles des processus d’approvisionnement et de paiement. L’examen a mis en évidence les possibilités d’améliorer la documentation et le suivi de la prestation des services conformément aux recommandations de la vérification.
Dépenses et ressources humaines
Dans la présente section
Dépenses
Cette section présente un aperçu des dépenses prévues et réelles du ministère de 2021‑2022 à 2026‑2027.
Sommaire du rendement budgétaire
Tableau 11 : Dépenses réelles de trois exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau 11 indique la somme d’argent dépensée par ECCC au cours des trois derniers exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes.
| Responsabilités essentielles et services internes | Budget principal des dépenses 2023 2024 | Autorisations totales pouvant être utilisées pour 2023 2024 | Dépenses réelles de trois exercices (autorisations utilisées) |
|---|---|---|---|
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques |
876 753 252 |
990 930 506 |
2021-2022 : 381 382 505 2022-2023 : 407 374 384 2023-2024 : 570 748 742 |
Prévention et gestion de la pollution |
420 436 048 |
490 243 117 |
2021-2022 : 380 061 047 2022-2023 : 390 259 703 2023-2024 : 471 476 416 |
Conservation de la nature |
677 409 744 |
738 696 713 |
2021-2022 : 413 663 898 2022-2023 : 576 201 081 2023-2024 : 720 108 036 |
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales |
229 586 460 |
312 607 216 |
2021-2022 : 274 731 867 2022-2023 : 257 185 465 2023-2024 : 281 191 207 |
Total partiel |
2 204 185 504 |
2 532 477 552 |
2021-2022 : 1 449 839 317 2022-2023 : 1 631 020 633 2023-2024 : 2 043 524 401 |
Services internes |
241 892 170 |
322 146 060 |
2021-2022 : 263 049 348 2022-2023 : 298 661 385 2023-2024 : 318 605 055 |
Total |
2 446 077 674 |
2 854 623 612 |
2021-2022 : 1 712 888 665 2022-2023 : 1 929 682 018 2023-2024 : 2 362 129 456 |
Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices
Les autorisations totales pouvant être utilisées pour 2023-2024 comprennent tous les éléments approuvés dans le cadre des processus budgétaires pour l’exercice 2023-2024. L’écart global de 492,5 millions de dollars entre les autorisations totales pouvant être utilisées pour 2023-2024 (2 854,6 millions de dollars) et les dépenses réelles de 2023-2024 (2 362,1 millions de dollars) est principalement attribuable à des dépenses moins élevées que prévu pour :
- le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, à la suite d’une réaffectation de fonds précédemment annoncés;
- la conservation des terres et de l’eau douce du Canada, la protection des espèces, l’avancement de la réconciliation avec les Autochtones et l’amélioration de l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié), en raison de retards dans des projets sur les espèces en péril et dans les processus d’assurance d’acquisition de terres de conservation;
- plusieurs autres initiatives, comme les collectivités arctiques et nordiques dynamiques (station météorologique Eureka au Nunavut), pour lesquelles des dépenses moins élevées que prévu ont été causées par des retards dans les activités de mise hors service dans le Nord.
L’augmentation globale de 432,5 millions de dollars entre les dépenses réelles de 1 929,7 millions de dollars en 2022-2023 et les dépenses réelles de 2 362,1 millions de dollars en 2023-2024 est principalement attribuable aux écarts de financement suivants :
- Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques : Les dépenses réelles pour 2023-2024 sont plus élevées qu’en 2022-2023, principalement en raison de la distribution aux provinces des revenus provenant des paiements de la redevance pour les émissions excédentaires dans le cadre du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement, et de l’augmentation des dépenses pour le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et pour soutenir les pays les moins avancés au moyen du Programme international de financement climatique du Canada.
- Prévention et gestion de la pollution : Les dépenses réelles pour 2023-2024 sont plus élevées qu’en 2022-2023, principalement en raison de diverses dépenses courantes telles que les dépenses salariales et les paiements rétroactifs associés aux conventions collectives nouvellement signées, des accords de financement avec les groupes autochtones admissibles pour la réalisation de l’initiative sur les effets cumulatifs terrestres du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, et des travaux visant à favoriser une économie circulaire des plastiques au Canada, à mettre en œuvre un plan d’action renforcé sur l’eau douce et à établir l’Agence de l’eau du Canada.
- Conservation de la nature : Les dépenses réelles pour 2023-2024 sont plus élevées qu’en 2022-2023, principalement en raison d’une augmentation des dépenses en subventions et contributions pour conserver les terres et l’eau douce du Canada, protéger les espèces, faire progresser la réconciliation avec les Autochtones et améliorer l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié), le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, l’Old Growth Nature Fund de la Colombie-Britannique et la mise en œuvre de la prochaine phase du Plan de protection des océans. Ces augmentations sont compensées par une diminution des dépenses due à l’expiration du financement pour protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (Patrimoine naturel) et pour la participation d’ECCC à la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP15) en 2022-2023.
- Prévisions des conditions météorologiques et environnementales : Les dépenses réelles pour 2023-2024 sont plus élevées qu’en 2022-2023, principalement en raison de diverses dépenses courantes, telles que les dépenses salariales et les paiements rétroactifs associés aux conventions collectives nouvellement signées, les paiements aux organisations internationales et les ingénieurs-conseils. Celles-ci sont compensées par une diminution des dépenses due à l’expiration du financement pour la revitalisation des services météorologiques du Canada.
- Services internes : Les dépenses réelles pour 2023-2024 sont plus élevées qu’en 2022-2023, principalement en raison de l’augmentation de diverses dépenses courantes telles que les salaires et les paiements rétroactifs associés aux conventions collectives nouvellement signées.
Veuillez consulter le Rapport sur les résultats ministériels 2022 à 2023 pour obtenir plus des renseignements détaillés sur les écarts de dépenses réelles d’une année à l’autre entre 2021-2022 et 2022-2023.
Des renseignements financiers plus détaillés des exercices précédents se trouvent dans la section Finances de l’InfoBase du GC.
Tableau 12 : Dépenses prévues au cours des trois prochains exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau 12 indique la somme d’argent qu’ECCC prévoit dépenser au cours des trois prochains exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes.
| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses prévues 2024-2025 | Dépenses prévues 2025-2026 | Dépenses prévues 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 1 036 877 580 | 479 096 757 | 436 256 363 |
| Prévention et gestion de la pollution | 450 317 681 | 415 301 040 | 405 051 667 |
| Conservation de la nature | 736 720 545 | 711 691 087 | 360 774 223 |
| Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | 271 887 076 | 262 687 420 | 256 346 437 |
| Total partiel | 2 495 802 882 | 1 868 776 304 | 1 458 428 690 |
| Services internes | 265 166 344 | 257 881 973 | 241 053 281 |
| Total | 2 760 969 226 | 2 126 658 277 | 1 699 481 971 |
Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices
Un financement total d’environ 2 761,0 millions de dollars est prévu pour 2024-2025. L’augmentation de 82,3 millions de dollars des dépenses prévues de 2023-2024 aux dépenses prévues de 2024-2025 est principalement attribuable à un profil de financement croissant pour la Stratégie nationale d’adaptation du Canada, pour mettre en œuvre un plan d’action renforcé sur l’eau douce et pour établir l’Agence de l’eau du Canada. Cette augmentation est partiellement compensée par le budget de 2023, qui recentre les réductions des dépenses gouvernementales, ainsi que par l’absence, dans le budget principal des dépenses de 2024-2025, de revenus législatifs à distribuer issus du Système de tarification fondé sur le rendement. Ces revenus seront compris dans les estimations futures en 2024-2025.
Dans l’ensemble, il y a une diminution des dépenses prévues au cours de l’horizon de planification 2024-2025 à 2026-2027 présenté dans le tableau sommaire. Cette diminution résulte d’initiatives temporaires dont le financement arrive à échéance et du recentrage des réductions des dépenses gouvernementales dans le budget de 2023. Les demandes de financement pour les initiatives temporaires dépendent de décisions du gouvernement et seront prises en compte dans les exercices budgétaires et les documents budgétaires futurs.
Les principales initiatives dont le profil de financement diminuera considérablement ou dont le financement prendra fin en 2025-2026 comprennent :
- une diminution associée à la Stratégie nationale d’adaptation du Canada, en raison du versement ponctuel au Fonds municipal vert;
- la fin du financement la phase IV du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux;
- la fin du financement du Old Growth Nature Fund de la Colombie-Britannique;
- une diminution des contributions à la Stratégie emploi et compétences jeunesse;
- la fin du financement de l’agrandissement du réseau de Trans Mountain.
Les principales initiatives dont le profil de financement diminuera considérablement ou dont le financement prendra fin en 2026-2027 comprennent :
- la fin du financement de l’initiative visant à conserver les terres et l’eau douce du Canada, à protéger les espèces, à faire progresser la réconciliation avec les Autochtones, à améliorer l’accès à la nature et à poursuivre les efforts pour protéger les espèces en péril (Patrimoine naturel bonifié);
- la fin du financement du programme international de financement climatique du Canada.
Des renseignements financiers plus détaillés des exercices précédents se trouvent dans la section Finances de l’InfoBase du GC.
Tableau 13 : Résumé budgétaire des dépenses brutes réelles et des dépenses nettes prévues (en dollars)
Le tableau 13 fait le rapprochement des dépenses brutes prévues et des dépenses nettes pour 2023‑2024.
| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses brutes réelles 2023 2024 | Revenus réels affectés aux dépenses 2023 2024 | Dépenses nettes réelles (autorisations utilisées) 2023 2024 |
|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 570 748 742 | 0 | 570 748 742 |
| Prévention et gestion de la pollution | 487 078 681 | 15 602 265 | 471 476 416 |
| Conservation de la nature | 724 546 901 | 4 438 865 | 720 108 036 |
| Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | 335 490 309 | 54 299 102 | 281 191 207 |
| Total partiel | 2 117 864 633 | 74 340 232 | 2 043 524 401 |
| Services internes | 319 531 676 | 926 621 | 318 605 055 |
| Total | 2 437 396 309 | 75 266 853 | 2 362 129 456 |
Analyse du résumé budgétaire des dépenses brutes réelles et des dépenses nettes prévues
Les principales sources de revenus affectés aux dépenses d’Environnement et Changement climatique Canada sont les suivantes :
- Les provinces recevant des services de surveillance de la quantité d’eau (hydrométriques);
- NAV CANADA, à qui ECCC fournit des services de météorologie aéronautique;
- Les tiers auxquels ECCC fournit des services de projets scientifiques et analytiques et loue des installations non destinées à la recherche;
- Le ministère de la Défense nationale, qui reçoit des services météorologiques détaillés à l’appui de ses opérations militaires;
- L’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui finance le Plan de mise en œuvre conjoint du Canada et de l’Alberta pour la surveillance visant les sables bitumineux;
- La Garde côtière canadienne, qui reçoit des prévisions et des services de surveillance maritime et des glaces;
- Les tiers auxquels ECCC accorde des permis pour l’immersion de substances non dangereuses dans la mer.
Des renseignements sur les crédits organisationnels d’ECCC figurent dans le budget principal des dépenses 2024-2025.
Des renseignements sur l’harmonisation des dépenses d’ECCC avec les dépenses et les activités du gouvernement du Canada figurent dans l’InfoBase du GC.
Financement
Cette section présente un aperçu du financement voté et législatif du ministère par rapport à ses responsabilités essentielles et à ses services internes. Pour en savoir plus sur les autorisations de financement, consulter les budgets et dépenses du gouvernement du Canada.
Graphique 1 : Financement approuvé (législatif et voté) pour une période de six exercices
Le graphique 1 résume le financement voté et législatif du ministère pour la période de 2021‑2022 à 2026‑2027.

Description longue
| Exercice | Total | Crédits votés |
Postes législatifs |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 |
1 712 888 665 |
1 611 358 900 |
101 529 765 |
| 2022-2023 |
1 929 682 018 |
1 806 143 889 |
123 538 129 |
| 2023-2024 |
2 362 129 456 |
2 152 273 874 |
209 855 583 |
| 2024-2025 |
2 760 969 226 |
2 638 596 171 |
122 373 055 |
| 2025-2026 |
2 126 658 277 |
2 006 182 060 |
120 476 217 |
| 2026-2027 |
1 699 481 971 |
1 588 613 205 |
110 868 766 |
Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices
Les dépenses réelles d’Environnement et Changement climatique Canada pour 2023-2024 étaient de 2 362,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d’une année à l’autre de 432,4 millions de dollars (22 %) par rapport aux dépenses réelles de 2022-2023. Cette augmentation est principalement attribuable à ce qui suit :
- une augmentation du financement pour conserver les terres et l’eau douce du Canada, protéger les espèces, faire progresser la réconciliation avec les Autochtones et améliorer l’accès à la nature (Patrimoine naturel bonifié);
- une augmentation des versements pour les dépenses salariales et les paiements rétroactifs en 2023-2024 à la suite des conventions collectives nouvellement signées;
- distribution aux provinces des revenus provenant des paiements de la redevance pour les émissions excédentaires, pour les contributions à l’appui du Fonds issu des produits du système de tarification fondé sur le rendement;
- le renouvellement et le report du financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone;
- un nouveau financement pour le Fonds pour des solutions climatiques naturelles.
Voir le Rapport sur les résultats ministériels 2022 à 2023 pour obtenir des renseignements détaillés sur les écarts de dépenses réelles d’une année à l’autre entre 2021-2022 et 2022-2023.
Pour en savoir plus sur les dépenses votées et législatives d’ECCC, consulter les Comptes publics du Canada.
Faits saillants des états financiers
Les états financiers d’ECCC (non audités) pour l’exercice terminé le 31 mars 2024 sont publiés sur le site Web du ministère.
Tableau 14 : État condensé des résultats (audité ou non) terminé le 31 mars 2024 (en dollars)
Le tableau 14.1 résume les charges et les revenus pour 2023-2024 qui affectent le coût de fonctionnement avant le financement du gouvernement et les transferts.
| Renseignements financiers | Résultats réels 2023-2024 | Résultats prévus 2023-2024 | Différence (2023-2024 moins 2022-2023) |
|---|---|---|---|
| Total des charges | 2 647 017 312 | 2 603 121 998 | 43 895 314 |
| Total des revenus | 91 134 382 | 105 119 050 | (13 984 668) |
| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 2 555 882 930 | 2 498 002 948 | 57 879 982 |
Les renseignements sur les résultats prévus pour 2023-2024 proviennent de l’état des résultats prospectif et les notes de 2023‑2024 d’ECCC.
Le tableau 14.2 résume les charges et les revenus réels affectant le coût de fonctionnement avant le financement du gouvernement et les transferts.
| Renseignements financiers | Résultats réels 2023-2024 | Résultats prévus 2023-2024 | Différence (2023-2024 moins 2022-2023) |
|---|---|---|---|
| Total des charges | 2 647 017 312 | 2 106 684 988 | 540 332 324 |
| Total des revenus | 91 134 382 | 206 533 022 | (115 398 640) |
| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 2 555 882 930 | 1 900 151 966 | 655 730 964 |
Tableau 15 : État condensé de la situation financière (audité ou non) au 31 mars 2024 (en dollars)
Le tableau 15 fournit un résumé des passifs (ce qu’il doit) et des actifs (ce qu’il possède) du Ministère, qui aident à déterminer la capacité de celui‑ci à mettre en œuvre des programmes et des services.
| Renseignements financiers | Exercice en cours (2023-2024) | Exercice précédent (2022‑2023) | Différence (2023-2024 moins 2022-2023) |
|---|---|---|---|
| Total du passif net | 1 407 484 413 | 1 095 472 223 | 312 012 190 |
| Total des actifs financiers nets | 929 241 972 | 731 259 344 | 197 982 128 |
| Dette nette du ministère | 478 242 441 | 364 212 879 | 114 030 062 |
| Total des actifs non financiers | 704 605 488 | 653 579 061 | 51 026 427 |
| Situation financière nette du ministère | 226 363 047 | 289 366 182 | (63 003 635) |
Ressources humaines
Cette section présente un aperçu des ressources humaines réelles et prévues du ministère pour la période de 2021‑2022 à 2026‑2027.
Tableau 16 : Ressources humaines réelles pour les responsabilités essentielles et les services internes
Le tableau 16 fournit un résumé des ressources humaines, en équivalents temps plein, lesquels sont associés aux responsabilités essentielles et aux services internes d’ECCC pour les trois derniers exercices.
| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein réels 2021-2022 | Équivalents temps plein réels 2022-2023 | Équivalents temps plein réels 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 744 | 883 | 1 056 |
| Prévention et gestion de la pollution | 2 229 | 2 255 | 2 334 |
| Conservation de la nature | 1 302 | 1 487 | 1 568 |
| Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | 1 714 | 1 722 | 1 733 |
| Total partiel | 5 989 | 6 347 | 6 691 |
| Services internes | 1 698 | 1 797 | 1 880 |
| Total | 7 687 | 8 144 | 8 571 |
Analyse des ressources humaines des trois derniers exercices
Pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, les chiffres indiqués représentent les ETP réels, tels qu’ils ont été déclarés dans les rapports sur les résultats ministériels précédents.
L’augmentation globale de 427 ETP entre 2022-2023 et 2023-2024 est le résultat de l’augmentation des activités au sein du Ministère, telles que :
- la mise en œuvre de la prochaine phase du Plan de protection des océans;
- l’élaboration, la mise en œuvre et l’administration continues de la tarification du carbone et du Règlement sur les combustibles propres;
- le renouvellement et le report du financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone;
- la promotion d’une économie circulaire des plastiques au Canada;
- le renouvellement de la Loi sur l’évaluation d’impact;
- le financement complémentaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature;
- l’appui aux modifications de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- la nouvelle Stratégie nationale d’adaptation du Canada, y compris le Centre canadien des services climatiques.
Tableau 17 : Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes
Le tableau 17 présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein réels, pour chaque responsabilité essentielle et les services internes d’ECCC au cours des trois prochains exercices. Les ressources humaines pour l’exercice en cours sont prévues en fonction des données de l’exercice à ce jour.
| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein prévus en 2024-2025 | Équivalents temps plein prévus en 2025-2026 | Équivalents temps plein prévus en 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques | 1 120 | 1 050 | 808 |
| Prévention et gestion de la pollution | 2 148 | 2 078 | 2 071 |
| Conservation de la nature | 1 449 | 1 423 | 1 143 |
| Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | 1 641 | 1 635 | 1 640 |
| Total partiel | 6 358 | 6 186 | 5 661 |
| Services internes | 1 847 | 1 809 | 1 741 |
| Total | 8 205 | 7 995 | 7 402 |
Analyse des ressources humaines pour les trois prochains exercices
Un ETP équivaut à une personne qui travaille 37,5 heures par semaine de travail durant toute l’année, ou à un nombre quelconque d’employés à temps partiel dont les heures de travail combinées équivalent à un ETP.
Dans l’ensemble, il y a une tendance à la baisse du nombre d’ETP prévus au cours de l’horizon de planification de 2024-2025 à 2026-2027. Cette tendance découle d’initiatives temporaires dotées d’un financement temporaire. Les demandes de financement pour de telles initiatives dépendent de décisions du gouvernement et seront prises en compte dans les exercices budgétaires et les documents budgétaires futurs.
La diminution globale de 210 ETP entre les ETP prévus de 2024-2025 et de 2025-2026 est le résultat d’une diminution du profil de financement et d’initiatives temporaires financées de manière temporaire se rapportant à ce qui suit :
- L’administration de la restitution des produits de la redevance sur les combustibles, la restitution des produits de la tarification de la pollution par le carbone, l’élaboration de communications, de produits d’information du public et d’annonces publicitaires liés aux changements climatiques, et le soutien du groupe consultatif pour la carboneutralité, dans le cadre de la responsabilité essentielle Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques;
- L’administration du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux, dans le cadre de la responsabilité essentielle Prévention et gestion de la pollution;
- Les consultations sur le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, dans le cadre de la responsabilité essentielle Conservation de la nature;
- Le soutien du calcul de haute performance, dans le cadre de la responsabilité essentielle Prévisions des conditions météorologiques et environnementales.
La diminution globale de 593 ETP entre les ETP prévus de 2025-2026 et de 2026-2027 est le résultat d’initiatives temporaires financées de manière temporaire se rapportant à ce qui suit :
- Le soutien à l’administration de la conservation des terres et de l’eau douce du Canada, à la protection des espèces, à l’avancement de la réconciliation avec les Autochtones, à l’amélioration de l’accès à la nature et aux efforts continus pour protéger les espèces en péril (Patrimoine naturel bonifié), dans le cadre de la responsabilité essentielle Conservation de la nature;
- L’élaboration de règlements à l’appui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et des déchets, l’administration du retour des produits de la tarification de la pollution par le carbone, l’amélioration de la capacité de politique en matière de changements climatiques et la mise en œuvre de l’optique des changements climatiques, dans le cadre de la responsabilité essentielle Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques.
Renseignements ministériels
Profil du ministère
Ministre(s) de tutelle :
L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Administrateur général :
Jean-François Tremblay
Portefeuille ministériel :
Environnement et Changement Climatique Canada
Instrument(s) habilitant(s) :
- Loi sur le ministère de l’Environnement, 1971
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Loi sur les pêches, 1985 (administration et application des dispositions sur la prévention de la pollution)
- Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2018 (responsabilité partagée avec le ministère des Finances)
- Loi sur les espèces en péril, 2004
- Loi sur les additifs à base de manganèse, 1997
- Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, 2003
- Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, 2008
- Loi sur les espèces sauvages du Canada, 1985
- Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
- Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, 1992
- Loi sur la semaine de la protection de la faune, 1985
- Loi sur les ressources en eau du Canada, 1985
- Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, 1985
- Loi de 1921 pour le contrôle du lac des Bois
- Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, 2005
- Loi sur les renseignements en matière de modification du temps, 1985
- Loi sur la semaine canadienne de l’environnement, 1985
- Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales, 2010
- Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, 2009
- Loi fédérale sur le développement durable, 2008
- Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure, 2017
- Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, 1985
- Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, 2012
- Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, 2001
- Loi sur les opérations pétrolières au Canada, 1985
- Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, 1987
- Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, 1988
- Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, 1985
- Loi de l’impôt sur le revenu, 1985
- Loi sur la responsabilité en matière maritime, 2001
- Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, 2013
- Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles, 1985
- Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, 2003
Année de constitution ou de création : 1971
Coordonnées du ministère
Adresse postale :
Environnement et Changement climatique Canada
Centre de renseignements à la population
Édifice Place Vincent-Massey
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Numéro de téléphone : 1-800-668-6767
Téléimprimeur (ATS) :
Numéro de télécopieur :
Adresse courriel : enviroinfo@ec.gc.ca
Site(s) Web : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
Tableaux de renseignements supplémentaires
Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web d’ECCC :
- Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
- Analyse comparative entre les sexes Plus
- Réponse aux comités parlementaires et aux audits externes
- Initiatives horizontales
- Financement pluriannuel initial
Dépenses fiscales fédérales
Il est possible de recourir au système fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’imposition, des exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Ce rapport fournit aussi des renseignements détaillés sur les dépenses fiscales, dont des descriptions, des objectifs, des données historiques et des renvois aux programmes de dépenses fédérales connexes ainsi qu’aux évaluations et aux résultats de l’ACS Plus liés aux dépenses fiscales.
Définitions
Liste de termes
analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) (Gender-based analysis plus [GBA Plus])
Outil analytique servant à soutenir l’élaboration de politiques, de programmes et d’autres initiatives et à évaluer les répercussions des politiques, des programmes ethj des initiatives sur divers ensembles de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre. L’ACS Plus est un processus permettant de comprendre qui est touché par l’occasion ou l’enjeu évalué par l’initiative, d’établir comment l’initiative pourrait être adaptée pour répondre aux divers besoins des personnes les plus touchées ainsi que de déterminer et de réduire tout obstacle à l’accès ou au bénéfice de l’initiative. L’ACS Plus est une analyse intersectionnelle qui va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour tenir compte d’autres facteurs, comme l’âge, les handicaps, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle.
cadre ministériel des résultats (departmental results framework)
Cadre qui établit un lien entre les responsabilités essentielles et les résultats ministériels ainsi que les indicateurs de résultat ministériel d’un ministère.
cible (target)
Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’un ministère, un programme ou une initiative prévoit d’atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.
crédit (appropriation)
Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.
dépenses budgétaires (budgetary expenditures)
Dépenses de fonctionnement et en capital, paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers ainsi que paiements à des sociétés d’État.
dépenses législatives (statutory expenditures)
Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
dépenses non budgétaires (non-budgetary expenditures)
Recettes et décaissements nets au titre de prêts, d’investissements et d’avances qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.
dépenses prévues (planned spending)
En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses prévues s’entendent des montants présentés dans le budget principal des dépenses.
Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur les résultats ministériels.
dépenses votées (voted expenditures)
Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.
entreprise autochtone (Indigenous business)
Organisation qui, aux fins de l’Annexe E – Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement ainsi que de l’engagement du gouvernement du Canada d’attribuer obligatoirement au moins 5 % de la valeur totale des marchés à des entreprises autochtones, correspond à la définition et aux exigences définies dans le Répertoire des entreprises autochtones.
équivalent temps plein (ETP) (full‑time equivalent [FTE])
Mesure utilisée pour représenter une année‑personne complète d’un employé dans le budget ministériel. Pour un poste donné, le nombre d’équivalents temps plein représente le rapport entre le nombre d’heures travaillées par une personne, divisé par le nombre d’heures normales prévues dans sa convention collective.
indicateur de rendement (performance indicator)
Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le rendement d’un ministère, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus.
indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)
Mesure quantitative des progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.
initiative horizontale (horizontal initiative)
Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.
plan (plan)
Exposé des choix stratégiques qui montre comment un ministère entend respecter ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous‑tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.
Plan ministériel (Departmental Plan)
Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires au cours d’une période de trois ans. Les Plans ministériels sont habituellement présentés au Parlement au printemps.
priorité ministérielle (departmental priority)
Plan ou projet qu’un ministère a choisi de cibler et dont il rendra compte au cours de la période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être réalisé en premier pour obtenir les résultats ministériels attendus.
priorités pangouvernementales (government-wide priorities)
Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2023‑2024, les priorités pangouvernementales correspondent aux thèmes de haut niveau qui décrivent le programme du gouvernement dans le discours du Trône du 23 novembre 2021 : bâtir un présent et un avenir plus sains, faire croître la croissance d’une économie plus résiliente, mener une action climatique audacieuse, travailler plus fort pour rendre les collectivités sécuritaires, défendre la diversité et l’inclusion, avancer plus rapidement sur la voie de la réconciliation et lutter pour un monde plus sûr, plus juste et plus équitable.
programme (program)
Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de service.
rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)
Rapport qui présente les réalisations réelles d’un ministère par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant.
rendement (performance)
Utilisation qu’un ministère a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que le ministère souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons ont été dégagées.
répertoire des programmes (program Inventory)
Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère et description de la manière dont les ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et aux résultats du ministère.
responsabilité essentielle (core responsibility)
Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.
résultat (result)
Conséquence attribuable en partie à un ministère, une politique, un programme ou une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’un ministère, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence du ministère.
résultat ministériel (departmental result)
Conséquence ou résultat qu’un ministère cherche à atteindre. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats des programmes.
